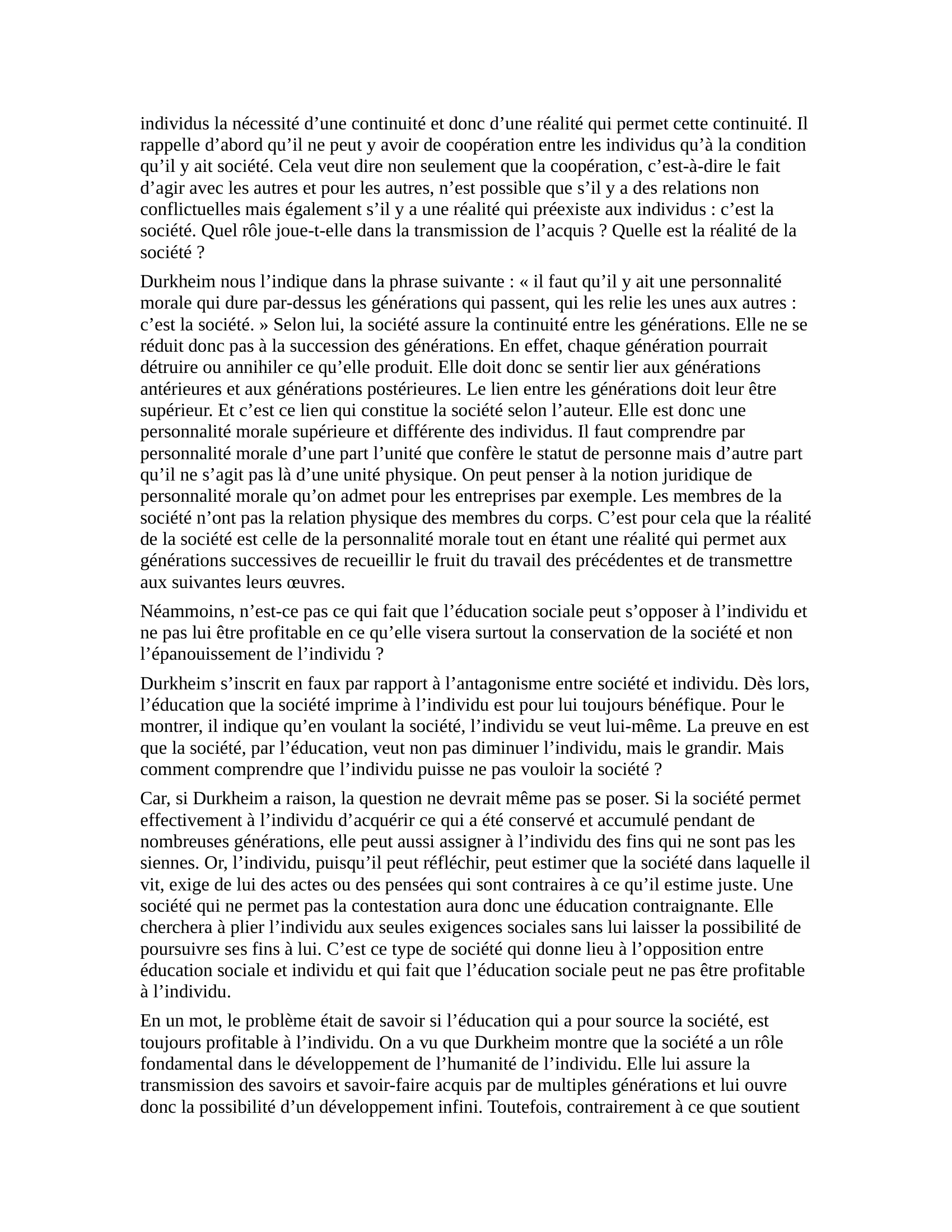Durkhein
Publié le 06/03/2017
Extrait du document
«
individus la nécessité d’une continuité et donc d’une réalité qui permet cette continuité.
Il
rappelle d’abord qu’il ne peut y avoir de coopération entre les individus qu’à la condition
qu’il y ait société.
Cela veut dire non seulement que la coopération, c’est-à-dire le fait
d’agir avec les autres et pour les autres, n’est possible que s’il y a des relations non
conflictuelles mais également s’il y a une réalité qui préexiste aux individus : c’est la
société.
Quel rôle joue-t-elle dans la transmission de l’acquis ? Quelle est la réalité de la
société ?
Durkheim nous l’indique dans la phrase suivante : « il faut qu’il y ait une personnalité
morale qui dure par-dessus les générations qui passent, qui les relie les unes aux autres :
c’est la société.
» Selon lui, la société assure la continuité entre les générations.
Elle ne se
réduit donc pas à la succession des générations.
En effet, chaque génération pourrait
détruire ou annihiler ce qu’elle produit.
Elle doit donc se sentir lier aux générations
antérieures et aux générations postérieures.
Le lien entre les générations doit leur être
supérieur.
Et c’est ce lien qui constitue la société selon l’auteur.
Elle est donc une
personnalité morale supérieure et différente des individus.
Il faut comprendre par
personnalité morale d’une part l’unité que confère le statut de personne mais d’autre part
qu’il ne s’agit pas là d’une unité physique.
On peut penser à la notion juridique de
personnalité morale qu’on admet pour les entreprises par exemple.
Les membres de la
société n’ont pas la relation physique des membres du corps.
C’est pour cela que la réalité
de la société est celle de la personnalité morale tout en étant une réalité qui permet aux
générations successives de recueillir le fruit du travail des précédentes et de transmettre
aux suivantes leurs œ uvres.
Néammoins, n’est-ce pas ce qui fait que l’éducation sociale peut s’opposer à l’individu et
ne pas lui être profitable en ce qu’elle visera surtout la conservation de la société et non
l’épanouissement de l’individu ?
Durkheim s’inscrit en faux par rapport à l’antagonisme entre société et individu.
Dès lors,
l’éducation que la société imprime à l’individu est pour lui toujours bénéfique.
Pour le
montrer, il indique qu’en voulant la société, l’individu se veut lui-même.
La preuve en est
que la société, par l’éducation, veut non pas diminuer l’individu, mais le grandir.
Mais
comment comprendre que l’individu puisse ne pas vouloir la société ?
Car, si Durkheim a raison, la question ne devrait même pas se poser.
Si la société permet
effectivement à l’individu d’acquérir ce qui a été conservé et accumulé pendant de
nombreuses générations, elle peut aussi assigner à l’individu des fins qui ne sont pas les
siennes.
Or, l’individu, puisqu’il peut réfléchir, peut estimer que la société dans laquelle il
vit, exige de lui des actes ou des pensées qui sont contraires à ce qu’il estime juste.
Une
société qui ne permet pas la contestation aura donc une éducation contraignante.
Elle
cherchera à plier l’individu aux seules exigences sociales sans lui laisser la possibilité de
poursuivre ses fins à lui.
C’est ce type de société qui donne lieu à l’opposition entre
éducation sociale et individu et qui fait que l’éducation sociale peut ne pas être profitable
à l’individu.
En un mot, le problème était de savoir si l’éducation qui a pour source la société, est
toujours profitable à l’individu.
On a vu que Durkheim montre que la société a un rôle
fondamental dans le développement de l’humanité de l’individu.
Elle lui assure la
transmission des savoirs et savoir-faire acquis par de multiples générations et lui ouvre
donc la possibilité d’un développement infini.
Toutefois, contrairement à ce que soutient.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓