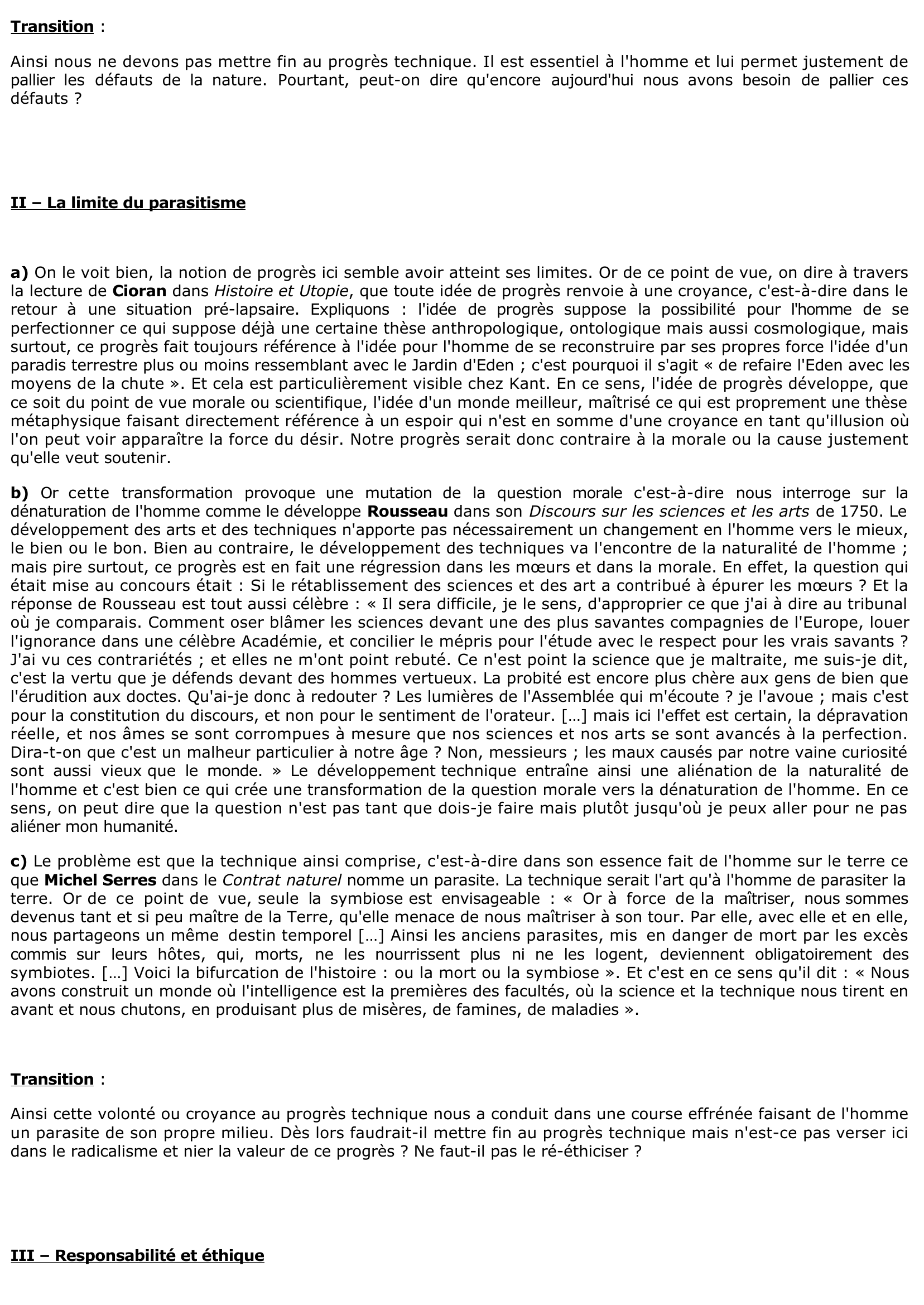Doit-on mettre fin au progrès technique ?
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
Transition :
Ainsi nous ne devons pas mettre fin au progrès technique.
Il est essentiel à l'homme et lui permet justement depallier les défauts de la nature.
Pourtant, peut-on dire qu'encore aujourd'hui nous avons besoin de pallier cesdéfauts ?
II – La limite du parasitisme
a) On le voit bien, la notion de progrès ici semble avoir atteint ses limites.
Or de ce point de vue, on dire à traversla lecture de Cioran dans Histoire et Utopie , que toute idée de progrès renvoie à une croyance, c'est-à-dire dans le retour à une situation pré-lapsaire.
Expliquons : l'idée de progrès suppose la possibilité pour l'homme de seperfectionner ce qui suppose déjà une certaine thèse anthropologique, ontologique mais aussi cosmologique, maissurtout, ce progrès fait toujours référence à l'idée pour l'homme de se reconstruire par ses propres force l'idée d'unparadis terrestre plus ou moins ressemblant avec le Jardin d'Eden ; c'est pourquoi il s'agit « de refaire l'Eden avec lesmoyens de la chute ».
Et cela est particulièrement visible chez Kant.
En ce sens, l'idée de progrès développe, quece soit du point de vue morale ou scientifique, l'idée d'un monde meilleur, maîtrisé ce qui est proprement une thèsemétaphysique faisant directement référence à un espoir qui n'est en somme d'une croyance en tant qu'illusion oùl'on peut voir apparaître la force du désir.
Notre progrès serait donc contraire à la morale ou la cause justementqu'elle veut soutenir.
b) Or cette transformation provoque une mutation de la question morale c'est-à-dire nous interroge sur ladénaturation de l'homme comme le développe Rousseau dans son Discours sur les sciences et les arts de 1750.
Le développement des arts et des techniques n'apporte pas nécessairement un changement en l'homme vers le mieux,le bien ou le bon.
Bien au contraire, le développement des techniques va l'encontre de la naturalité de l'homme ;mais pire surtout, ce progrès est en fait une régression dans les mœurs et dans la morale.
En effet, la question quiétait mise au concours était : Si le rétablissement des sciences et des art a contribué à épurer les mœurs ? Et laréponse de Rousseau est tout aussi célèbre : « Il sera difficile, je le sens, d'approprier ce que j'ai à dire au tribunaloù je comparais.
Comment oser blâmer les sciences devant une des plus savantes compagnies de l'Europe, louerl'ignorance dans une célèbre Académie, et concilier le mépris pour l'étude avec le respect pour les vrais savants ?J'ai vu ces contrariétés ; et elles ne m'ont point rebuté.
Ce n'est point la science que je maltraite, me suis-je dit,c'est la vertu que je défends devant des hommes vertueux.
La probité est encore plus chère aux gens de bien quel'érudition aux doctes.
Qu'ai-je donc à redouter ? Les lumières de l'Assemblée qui m'écoute ? je l'avoue ; mais c'estpour la constitution du discours, et non pour le sentiment de l'orateur.
[…] mais ici l'effet est certain, la dépravationréelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection.Dira-t-on que c'est un malheur particulier à notre âge ? Non, messieurs ; les maux causés par notre vaine curiositésont aussi vieux que le monde.
» Le développement technique entraîne ainsi une aliénation de la naturalité del'homme et c'est bien ce qui crée une transformation de la question morale vers la dénaturation de l'homme.
En cesens, on peut dire que la question n'est pas tant que dois-je faire mais plutôt jusqu'où je peux aller pour ne pasaliéner mon humanité.
c) Le problème est que la technique ainsi comprise, c'est-à-dire dans son essence fait de l'homme sur le terre ceque Michel Serres dans le Contrat naturel nomme un parasite.
La technique serait l'art qu'à l'homme de parasiter la terre.
Or de ce point de vue, seule la symbiose est envisageable : « Or à force de la maîtriser, nous sommesdevenus tant et si peu maître de la Terre, qu'elle menace de nous maîtriser à son tour.
Par elle, avec elle et en elle,nous partageons un même destin temporel […] Ainsi les anciens parasites, mis en danger de mort par les excèscommis sur leurs hôtes, qui, morts, ne les nourrissent plus ni ne les logent, deviennent obligatoirement dessymbiotes.
[…] Voici la bifurcation de l'histoire : ou la mort ou la symbiose ».
Et c'est en ce sens qu'il dit : « Nousavons construit un monde où l'intelligence est la premières des facultés, où la science et la technique nous tirent enavant et nous chutons, en produisant plus de misères, de famines, de maladies ».
Transition :
Ainsi cette volonté ou croyance au progrès technique nous a conduit dans une course effrénée faisant de l'hommeun parasite de son propre milieu.
Dès lors faudrait-il mettre fin au progrès technique mais n'est-ce pas verser icidans le radicalisme et nier la valeur de ce progrès ? Ne faut-il pas le ré-éthiciser ?
III – Responsabilité et éthique.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les progrès de la connaissance scientifique peuvent-ils mettre fin aux croyances ?
- Le progrès technique est-il sans fin ?
- Lire un récit policier (4) : étudier la progression du récit 2 Découvrir L'évolution des personnages Mettre en évidence qu'entre le début et la fin du roman, beaucoup de choses ont changé : les personnages ne sont plus tout à fait les mêmes, les rôles se sont parfois inversés.
- Pour mettre fin à la monarchie absolue, une Révolution éclate entre 1789 et 1815.
- Quelles sont les contraintes du progrès technique ? Quelles sont les privilèges du progrès technique ?