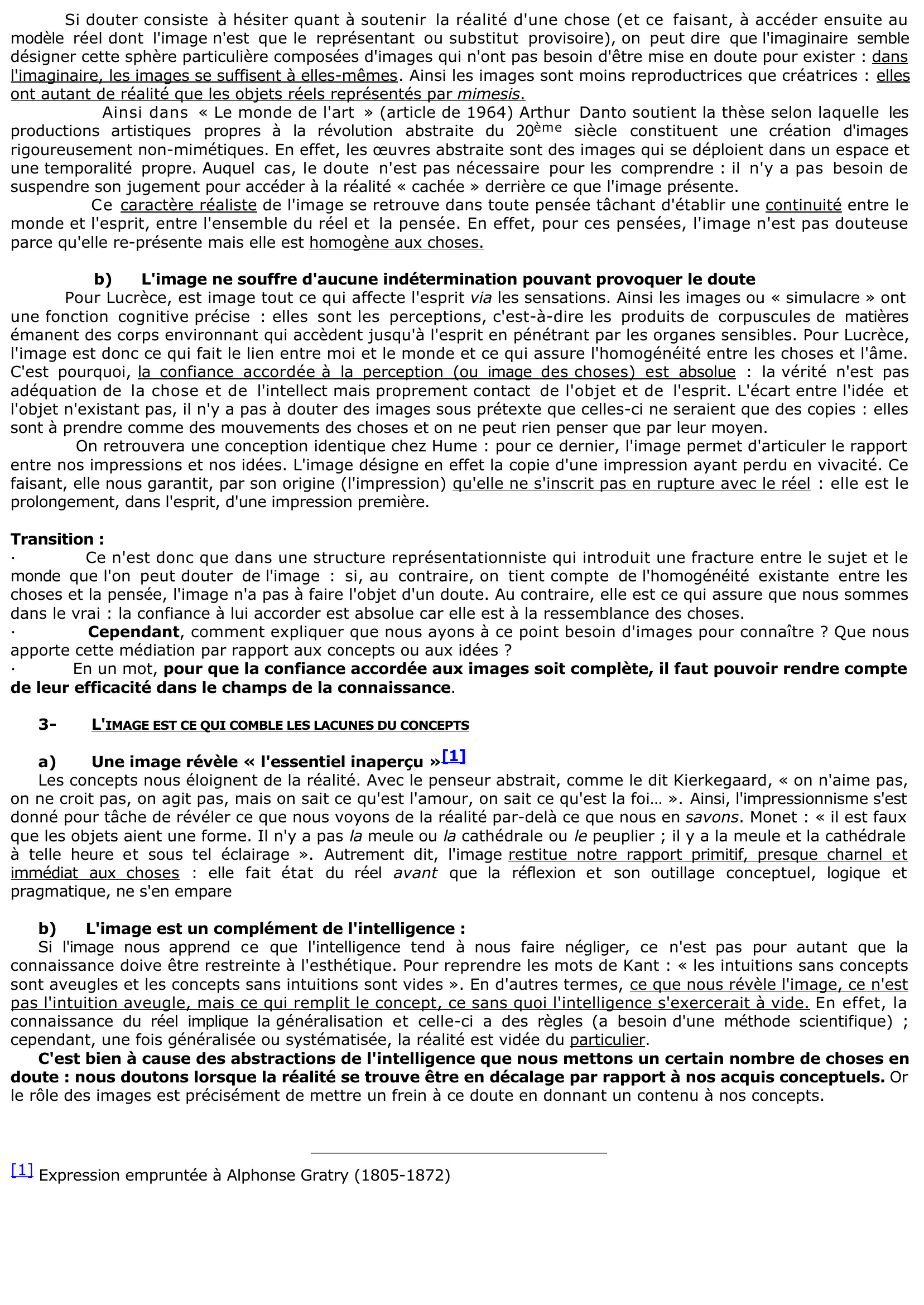doit on douter de l'image ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
L’image est bien souvent, au regard des discours écrits ou des calculs de la science, dévalorisée : on doute que l’on puisse apprendre quelque chose de l’image. Pourtant l’exemple des illustrations dans les livres pour enfants, les schémas représentant le fonctionnement de certaines machines, les cartes ou même l’art en général, nous montrent que l’image possède une certaine valeur heuristique. Ainsi, faut-il douter de l’image ou lui faire confiance, c’est-à-dire la tenir pour un instrument suffisamment efficace pour déterminer un jugement ou une connaissance ?
«
Si douter consiste à hésiter quant à soutenir la réalité d'une chose (et ce faisant, à accéder ensuite au modèle réel dont l'image n'est que le représentant ou substitut provisoire), on peut dire que l'imaginaire sembledésigner cette sphère particulière composées d'images qui n'ont pas besoin d'être mise en doute pour exister : dans l'imaginaire, les images se suffisent à elles-mêmes .
Ainsi les images sont moins reproductrices que créatrices : elles ont autant de réalité que les objets réels représentés par mimesis . Ainsi dans « Le monde de l'art » (article de 1964) Arthur Danto soutient la thèse selon laquelle lesproductions artistiques propres à la révolution abstraite du 20 ème siècle constituent une création d'images rigoureusement non-mimétiques.
En effet, les œuvres abstraite sont des images qui se déploient dans un espace etune temporalité propre.
Auquel cas, le doute n'est pas nécessaire pour les comprendre : il n'y a pas besoin desuspendre son jugement pour accéder à la réalité « cachée » derrière ce que l'image présente.
Ce caractère réaliste de l'image se retrouve dans toute pensée tâchant d'établir une continuité entre le monde et l'esprit, entre l'ensemble du réel et la pensée.
En effet, pour ces pensées, l'image n'est pas douteuseparce qu'elle re-présente mais elle est homogène aux choses. b) L'image ne souffre d'aucune indétermination pouvant provoquer le doute Pour Lucrèce, est image tout ce qui affecte l'esprit via les sensations.
Ainsi les images ou « simulacre » ont une fonction cognitive précise : elles sont les perceptions, c'est-à-dire les produits de corpuscules de matièresémanent des corps environnant qui accèdent jusqu'à l'esprit en pénétrant par les organes sensibles.
Pour Lucrèce,l'image est donc ce qui fait le lien entre moi et le monde et ce qui assure l'homogénéité entre les choses et l'âme.C'est pourquoi, la confiance accordée à la perception (ou image des choses) est absolue : la vérité n'est pas adéquation de la chose et de l'intellect mais proprement contact de l'objet et de l'esprit.
L'écart entre l'idée etl'objet n'existant pas, il n'y a pas à douter des images sous prétexte que celles-ci ne seraient que des copies : ellessont à prendre comme des mouvements des choses et on ne peut rien penser que par leur moyen.
On retrouvera une conception identique chez Hume : pour ce dernier, l'image permet d'articuler le rapportentre nos impressions et nos idées.
L'image désigne en effet la copie d'une impression ayant perdu en vivacité.
Cefaisant, elle nous garantit, par son origine (l'impression) qu'elle ne s'inscrit pas en rupture avec le réel : elle est le prolongement, dans l'esprit, d'une impression première.
Transition :· Ce n'est donc que dans une structure représentationniste qui introduit une fracture entre le sujet et le monde que l'on peut douter de l'image : si, au contraire, on tient compte de l'homogénéité existante entre leschoses et la pensée, l'image n'a pas à faire l'objet d'un doute.
Au contraire, elle est ce qui assure que nous sommesdans le vrai : la confiance à lui accorder est absolue car elle est à la ressemblance des choses.· Cependant , comment expliquer que nous ayons à ce point besoin d'images pour connaître ? Que nous apporte cette médiation par rapport aux concepts ou aux idées ?· En un mot, pour que la confiance accordée aux images soit complète, il faut pouvoir rendre compte de leur efficacité dans le champs de la connaissance . 3- L'IMAGE EST CE QUI COMBLE LES LACUNES DU CONCEPTS a) Une image révèle « l'essentiel inaperçu » [1]
Les concepts nous éloignent de la réalité.
Avec le penseur abstrait, comme le dit Kierkegaard, « on n'aime pas, on ne croit pas, on agit pas, mais on sait ce qu'est l'amour, on sait ce qu'est la foi… ». Ainsi, l'impressionnisme s'est donné pour tâche de révéler ce que nous voyons de la réalité par-delà ce que nous en savons .
Monet : « il est faux que les objets aient une forme.
Il n'y a pas la meule ou la cathédrale ou le peuplier ; il y a la meule et la cathédrale à telle heure et sous tel éclairage ».
Autrement dit, l'image restitue notre rapport primitif, presque charnel et immédiat aux choses : elle fait état du réel avant que la réflexion et son outillage conceptuel, logique et pragmatique, ne s'en empare b) L'image est un complément de l'intelligence : Si l'image nous apprend ce que l'intelligence tend à nous faire négliger, ce n'est pas pour autant que la connaissance doive être restreinte à l'esthétique.
Pour reprendre les mots de Kant : « les intuitions sans conceptssont aveugles et les concepts sans intuitions sont vides ».
En d'autres termes, ce que nous révèle l'image, ce n'est pas l'intuition aveugle, mais ce qui remplit le concept, ce sans quoi l'intelligence s'exercerait à vide. En effet, la connaissance du réel implique la généralisation et celle-ci a des règles (a besoin d'une méthode scientifique) ;cependant, une fois généralisée ou systématisée, la réalité est vidée du particulier . C'est bien à cause des abstractions de l'intelligence que nous mettons un certain nombre de choses en doute : nous doutons lorsque la réalité se trouve être en décalage par rapport à nos acquis conceptuels. Or le rôle des images est précisément de mettre un frein à ce doute en donnant un contenu à nos concepts.
[1] Expression empruntée à Alphonse Gratry (1805-1872).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- j'aime presque autant douter que savoir
- une bonne image suffit elle au succes de l entreprise
- Etude de doc d'histoire Image d'épinal Ch. Pellerin
- L'image de la femme dans la société
- Peut-on douter de tout ?