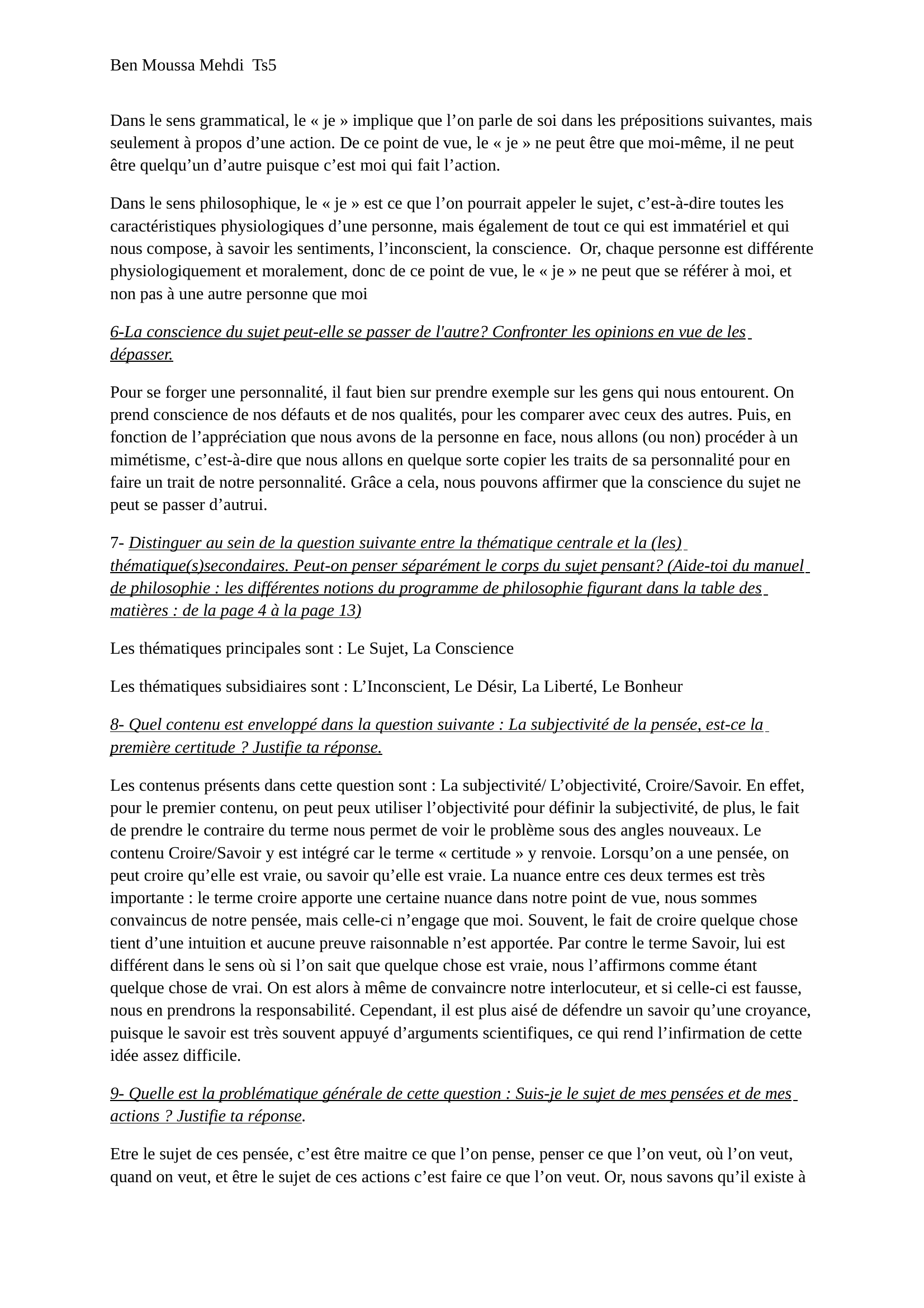dm philosophie
Publié le 01/11/2014
Extrait du document


«
Ben Moussa Mehdi Ts5
Dans le sens grammatical, le « je » implique que l’on parle de soi dans les prépositions suivantes, mais
seulement à propos d’une action.
De ce point de vue, le « je » ne peut être que moi-même, il ne peut
être quelqu’un d’autre puisque c’est moi qui fait l’action.
Dans le sens philosophique, le « je » est ce que l’on pourrait appeler le sujet, c’est-à-dire toutes les
caractéristiques physiologiques d’une personne, mais également de tout ce qui est immatériel et qui
nous compose, à savoir les sentiments, l’inconscient, la conscience.
Or, chaque personne est différente
physiologiquement et moralement, donc de ce point de vue, le « je » ne peut que se référer à moi, et
non pas à une autre personne que moi
6-La conscience du sujet peut-elle se passer de l'autre? Confronter les opinions en vue de les
dépasser.
Pour se forger une personnalité, il faut bien sur prendre exemple sur les gens qui nous entourent.
On
prend conscience de nos défauts et de nos qualités, pour les comparer avec ceux des autres.
Puis, en
fonction de l’appréciation que nous avons de la personne en face, nous allons (ou non) procéder à un
mimétisme, c’est-à-dire que nous allons en quelque sorte copier les traits de sa personnalité pour en
faire un trait de notre personnalité.
Grâce a cela, nous pouvons affirmer que la conscience du sujet ne
peut se passer d’autrui.
7- Distinguer au sein de la question suivante entre la thématique centrale et la (les)
thématique(s)secondaires.
Peut-on penser séparément le corps du sujet pensant? (Aide-toi du manuel
de philosophie : les différentes notions du programme de philosophie figurant dans la table des
matières : de la page 4 à la page 13)
Les thématiques principales sont : Le Sujet, La Conscience
Les thématiques subsidiaires sont : L’Inconscient, Le Désir, La Liberté, Le Bonheur
8- Quel contenu est enveloppé dans la question suivante : La subjectivité de la pensée, est-ce la
première certitude ? Justifie ta réponse.
Les contenus présents dans cette question sont : La subjectivité/ L’objectivité, Croire/Savoir.
En effet,
pour le premier contenu, on peut peux utiliser l’objectivité pour définir la subjectivité, de plus, le fait
de prendre le contraire du terme nous permet de voir le problème sous des angles nouveaux.
Le
contenu Croire/Savoir y est intégré car le terme « certitude » y renvoie.
Lorsqu’on a une pensée, on
peut croire qu’elle est vraie, ou savoir qu’elle est vraie.
La nuance entre ces deux termes est très
importante : le terme croire apporte une certaine nuance dans notre point de vue, nous sommes
convaincus de notre pensée, mais celle-ci n’engage que moi.
Souvent, le fait de croire quelque chose
tient d’une intuition et aucune preuve raisonnable n’est apportée.
Par contre le terme Savoir, lui est
différent dans le sens où si l’on sait que quelque chose est vraie, nous l’affirmons comme étant
quelque chose de vrai.
On est alors à même de convaincre notre interlocuteur, et si celle-ci est fausse,
nous en prendrons la responsabilité.
Cependant, il est plus aisé de défendre un savoir qu’une croyance,
puisque le savoir est très souvent appuyé d’arguments scientifiques, ce qui rend l’infirmation de cette
idée assez difficile.
9- Quelle est la problématique générale de cette question : Suis-je le sujet de mes pensées et de mes
actions ? Justifie ta réponse .
Etre le sujet de ces pensée, c’est être maitre ce que l’on pense, penser ce que l’on veut, où l’on veut,
quand on veut, et être le sujet de ces actions c’est faire ce que l’on veut.
Or, nous savons qu’il existe à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'oisiveté est la mère de la philosophie (Hobbes)
- Philosophie marc aurele
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- À propos de l'histoire de la philosophie (I).
- Philosophie Post-moderne