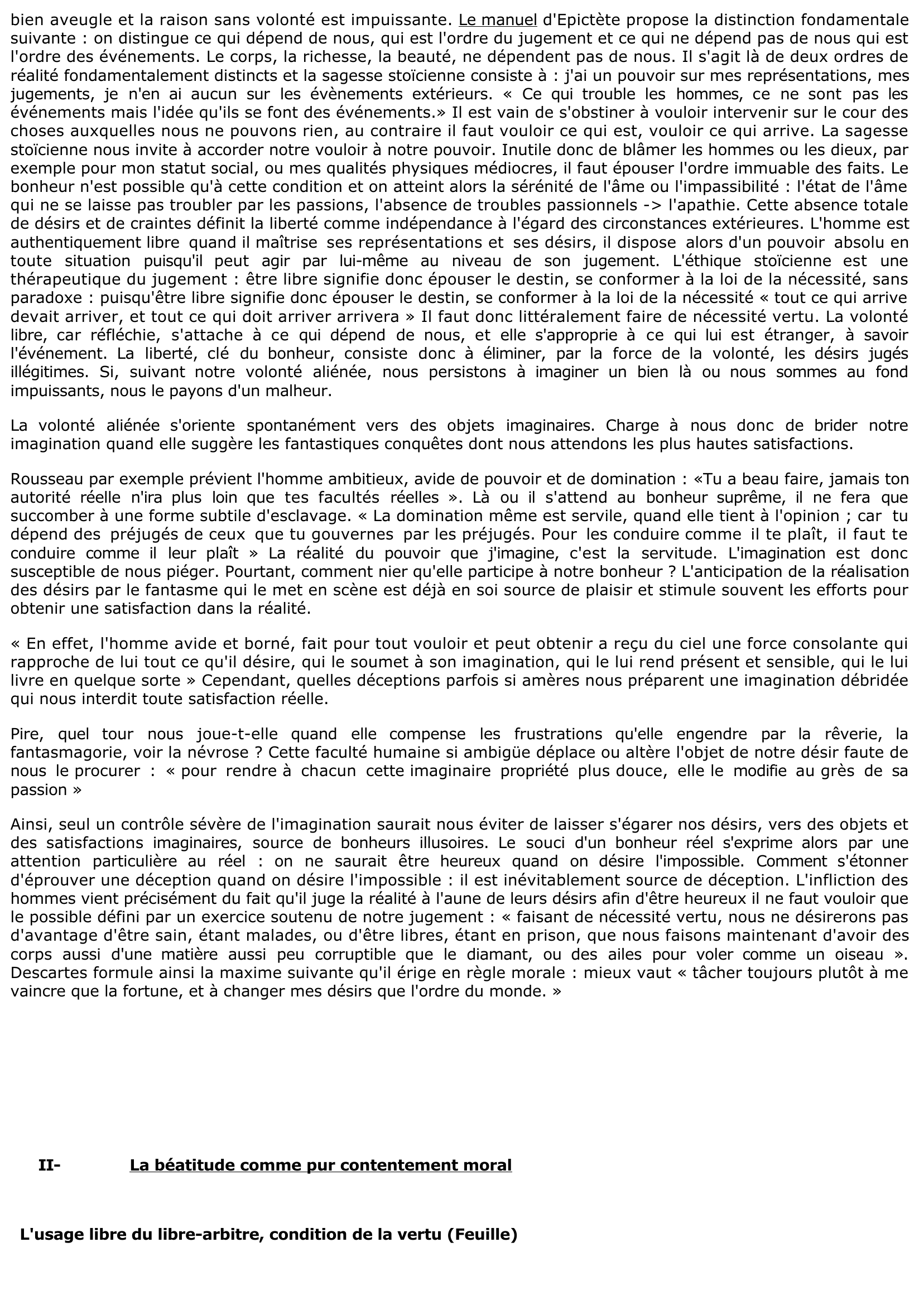Dépend-il de nous d’être heureux ?
Publié le 06/05/2011
Extrait du document
Introduction :
Ce sujet invite à s’interroger sur les conditions de notre bonheur et sur la possibilité d’être heureux. Le bonheur est un état de plénitude durable, où tous nos désirs et nos attentes sont satisfaits. On pourrait croire que le bonheur est possible grâce à notre raison qui va être en mesure de contrôler nos mauvais désirs et nous permettre d’être heureux, cependant autrui intervient toujours dans notre vie et peut alors influencer notre capacité à être heureux. Mais le bonheur est il une fin en soi ? Est-il le but ultime de la vie humaine ?
Dans un premier temps, il est indispensable de s’interroger sur la rationalisation des désirs et de définir l’ataraxie et l’aponie qui vont permettre le bonheur selon Epicure. Mais il faut ensuite admettre qu’autrui influence sur nos actes et sur les événements qui s’imposent à nous. Enfin, nous pouvons nous demander si ce bonheur est vraiment possible et si l’être humain cherche réellement à accéder au bonheur ?
«
bien aveugle et la raison sans volonté est impuissante.
Le manuel d'Epictète propose la distinction fondamentale suivante : on distingue ce qui dépend de nous, qui est l'ordre du jugement et ce qui ne dépend pas de nous qui estl'ordre des événements.
Le corps, la richesse, la beauté, ne dépendent pas de nous.
Il s'agit là de deux ordres deréalité fondamentalement distincts et la sagesse stoïcienne consiste à : j'ai un pouvoir sur mes représentations, mesjugements, je n'en ai aucun sur les évènements extérieurs.
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas lesévénements mais l'idée qu'ils se font des événements.» Il est vain de s'obstiner à vouloir intervenir sur le cour deschoses auxquelles nous ne pouvons rien, au contraire il faut vouloir ce qui est, vouloir ce qui arrive.
La sagessestoïcienne nous invite à accorder notre vouloir à notre pouvoir.
Inutile donc de blâmer les hommes ou les dieux, parexemple pour mon statut social, ou mes qualités physiques médiocres, il faut épouser l'ordre immuable des faits.
Lebonheur n'est possible qu'à cette condition et on atteint alors la sérénité de l'âme ou l'impassibilité : l'état de l'âmequi ne se laisse pas troubler par les passions, l'absence de troubles passionnels -> l'apathie.
Cette absence totalede désirs et de craintes définit la liberté comme indépendance à l'égard des circonstances extérieures.
L'homme estauthentiquement libre quand il maîtrise ses représentations et ses désirs, il dispose alors d'un pouvoir absolu entoute situation puisqu'il peut agir par lui-même au niveau de son jugement.
L'éthique stoïcienne est unethérapeutique du jugement : être libre signifie donc épouser le destin, se conformer à la loi de la nécessité, sansparadoxe : puisqu'être libre signifie donc épouser le destin, se conformer à la loi de la nécessité « tout ce qui arrivedevait arriver, et tout ce qui doit arriver arrivera » Il faut donc littéralement faire de nécessité vertu.
La volontélibre, car réfléchie, s'attache à ce qui dépend de nous, et elle s'approprie à ce qui lui est étranger, à savoirl'événement.
La liberté, clé du bonheur, consiste donc à éliminer, par la force de la volonté, les désirs jugésillégitimes.
Si, suivant notre volonté aliénée, nous persistons à imaginer un bien là ou nous sommes au fondimpuissants, nous le payons d'un malheur.
La volonté aliénée s'oriente spontanément vers des objets imaginaires.
Charge à nous donc de brider notreimagination quand elle suggère les fantastiques conquêtes dont nous attendons les plus hautes satisfactions.
Rousseau par exemple prévient l'homme ambitieux, avide de pouvoir et de domination : «Tu a beau faire, jamais tonautorité réelle n'ira plus loin que tes facultés réelles ».
Là ou il s'attend au bonheur suprême, il ne fera quesuccomber à une forme subtile d'esclavage.
« La domination même est servile, quand elle tient à l'opinion ; car tudépend des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés.
Pour les conduire comme il te plaît, il faut teconduire comme il leur plaît » La réalité du pouvoir que j'imagine, c'est la servitude.
L'imagination est doncsusceptible de nous piéger.
Pourtant, comment nier qu'elle participe à notre bonheur ? L'anticipation de la réalisationdes désirs par le fantasme qui le met en scène est déjà en soi source de plaisir et stimule souvent les efforts pourobtenir une satisfaction dans la réalité.
« En effet, l'homme avide et borné, fait pour tout vouloir et peut obtenir a reçu du ciel une force consolante quirapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et sensible, qui le luilivre en quelque sorte » Cependant, quelles déceptions parfois si amères nous préparent une imagination débridéequi nous interdit toute satisfaction réelle.
Pire, quel tour nous joue-t-elle quand elle compense les frustrations qu'elle engendre par la rêverie, lafantasmagorie, voir la névrose ? Cette faculté humaine si ambigüe déplace ou altère l'objet de notre désir faute denous le procurer : « pour rendre à chacun cette imaginaire propriété plus douce, elle le modifie au grès de sapassion »
Ainsi, seul un contrôle sévère de l'imagination saurait nous éviter de laisser s'égarer nos désirs, vers des objets etdes satisfactions imaginaires, source de bonheurs illusoires.
Le souci d'un bonheur réel s'exprime alors par uneattention particulière au réel : on ne saurait être heureux quand on désire l'impossible.
Comment s'étonnerd'éprouver une déception quand on désire l'impossible : il est inévitablement source de déception.
L'infliction deshommes vient précisément du fait qu'il juge la réalité à l'aune de leurs désirs afin d'être heureux il ne faut vouloir quele possible défini par un exercice soutenu de notre jugement : « faisant de nécessité vertu, nous ne désirerons pasd'avantage d'être sain, étant malades, ou d'être libres, étant en prison, que nous faisons maintenant d'avoir descorps aussi d'une matière aussi peu corruptible que le diamant, ou des ailes pour voler comme un oiseau ».Descartes formule ainsi la maxime suivante qu'il érige en règle morale : mieux vaut « tâcher toujours plutôt à mevaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde.
»
II- La béatitude comme pur contentement moral
A) L'usage libre du libre-arbitre, condition de la vertu (Feuille).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- le bonheur: Dépend-il de nous d’être heureux ?
- Dépend-il de nous d’être heureux?
- Dépend t-il de nous d'être heureux ?
- Dépend-il de nous d’être heureux ?
- Dépend-il de nous d être heureux ?