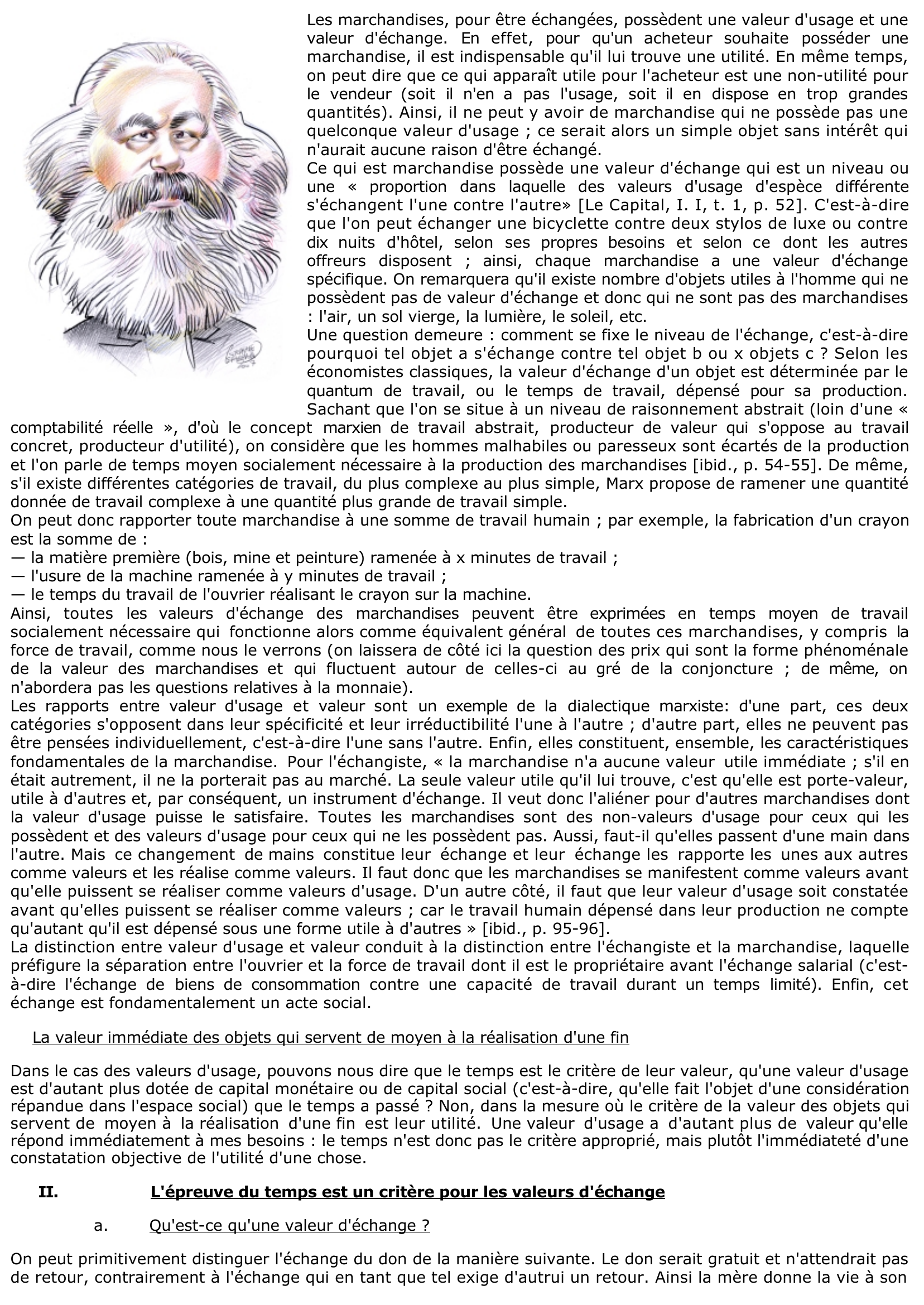Dans quelle mesure l'épreuve du temps est-elle un critère de valeur ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Comme le déclare le personnage de l’archéologue français dans Indiana Jones et l’arche perdue : « Prenez cette montre, à la sauvette, elle ne vaut que deux ou trois dollars. Mais si je la plonge dans le sable, dans cent ans, dans mille ans, elle vaudra de l’or, des hommes comme vous et moi tueront pour l’avoir «. L’objet de cette citation est de montrer qu’un objet sans valeur peut en acquérir avec le temps, que le temps dont nous allons voir s’il est un critère de valeur, peut déjà être un pourvoyeur de la valeur d’une chose.
Par épreuve du temps, nous voulons dire le passage des années, passage présupposé fort long. L’épreuve du temps est donc cette inscription d’une chose dans la durée, chose qui, lorsque nous la considérons après un long moment de cette durée, est sensée être différente de ce qu’elle était lors de sa naissance.
Le terme de « valeur «, quant à lui, est moins univoque. Car nous pouvons dire d’une chose qu’elle a de la valeur ou qu’elle est une valeur. Lorsque nous disons qu’elle a de la valeur, nous entendons par là qu’elle peut servir à satisfaire nos besoins : soit par elle-même, en tant qu’elle assouvit le manque que nous avons ; soit par la médiation d’une autre chose, qu’elle nous permet d’obtenir au moyen d’un échange. Mais lorsque nous disons d’une chose qu’elle est une valeur, ce dernier terme doit s’entendre d’une manière parfaitement différente : nous disons alors que cette chose mérite d’être suivie comme principe, ou poursuivie comme fin de l’action humaine. Il peut s’agir alors d’un idéal (comme la liberté ou le bonheur) d’une norme (telle que l’égalité ou la justice) ou bien d’une institution (par exemple, la famille ou l’État).
Quand nous demandons si une chose est un critère de valeur pour une autre, nous nous demandons si nous pouvons déterminer la valeur d’usage, la valeur d’échange ou la valeur morale de la seconde en fonction de la première. Le présupposé de notre question est que plus le temps passe, plus nous sommes à même de déterminer la valeur de quelque chose.
Tout le problème est donc de qualifier plus précisément ce « quelque chose «. Car nous ne pouvons répondre à la question posée sans distinguer entre valeur d’usage, d’échange et valeur morale.
«
Les marchandises, pour être échangées, possèdent une valeur d'usage et unevaleur d'échange.
En effet, pour qu'un acheteur souhaite posséder unemarchandise, il est indispensable qu'il lui trouve une utilité.
En même temps,on peut dire que ce qui apparaît utile pour l'acheteur est une non-utilité pourle vendeur (soit il n'en a pas l'usage, soit il en dispose en trop grandesquantités).
Ainsi, il ne peut y avoir de marchandise qui ne possède pas unequelconque valeur d'usage ; ce serait alors un simple objet sans intérêt quin'aurait aucune raison d'être échangé.Ce qui est marchandise possède une valeur d'échange qui est un niveau ouune « proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'espèce différentes'échangent l'une contre l'autre» [Le Capital, I.
I, t.
1, p.
52].
C'est-à-direque l'on peut échanger une bicyclette contre deux stylos de luxe ou contredix nuits d'hôtel, selon ses propres besoins et selon ce dont les autresoffreurs disposent ; ainsi, chaque marchandise a une valeur d'échangespécifique.
On remarquera qu'il existe nombre d'objets utiles à l'homme qui nepossèdent pas de valeur d'échange et donc qui ne sont pas des marchandises: l'air, un sol vierge, la lumière, le soleil, etc.Une question demeure : comment se fixe le niveau de l'échange, c'est-à-direpourquoi tel objet a s'échange contre tel objet b ou x objets c ? Selon leséconomistes classiques, la valeur d'échange d'un objet est déterminée par lequantum de travail, ou le temps de travail, dépensé pour sa production.Sachant que l'on se situe à un niveau de raisonnement abstrait (loin d'une « comptabilité réelle », d'où le concept marxien de travail abstrait, producteur de valeur qui s'oppose au travailconcret, producteur d'utilité), on considère que les hommes malhabiles ou paresseux sont écartés de la productionet l'on parle de temps moyen socialement nécessaire à la production des marchandises [ibid., p.
54-55].
De même,s'il existe différentes catégories de travail, du plus complexe au plus simple, Marx propose de ramener une quantitédonnée de travail complexe à une quantité plus grande de travail simple.On peut donc rapporter toute marchandise à une somme de travail humain ; par exemple, la fabrication d'un crayonest la somme de :— la matière première (bois, mine et peinture) ramenée à x minutes de travail ;— l'usure de la machine ramenée à y minutes de travail ;— le temps du travail de l'ouvrier réalisant le crayon sur la machine.Ainsi, toutes les valeurs d'échange des marchandises peuvent être exprimées en temps moyen de travailsocialement nécessaire qui fonctionne alors comme équivalent général de toutes ces marchandises, y compris laforce de travail, comme nous le verrons (on laissera de côté ici la question des prix qui sont la forme phénoménalede la valeur des marchandises et qui fluctuent autour de celles-ci au gré de la conjoncture ; de même, onn'abordera pas les questions relatives à la monnaie).Les rapports entre valeur d'usage et valeur sont un exemple de la dialectique marxiste: d'une part, ces deuxcatégories s'opposent dans leur spécificité et leur irréductibilité l'une à l'autre ; d'autre part, elles ne peuvent pasêtre pensées individuellement, c'est-à-dire l'une sans l'autre.
Enfin, elles constituent, ensemble, les caractéristiquesfondamentales de la marchandise.
Pour l'échangiste, « la marchandise n'a aucune valeur utile immédiate ; s'il enétait autrement, il ne la porterait pas au marché.
La seule valeur utile qu'il lui trouve, c'est qu'elle est porte-valeur,utile à d'autres et, par conséquent, un instrument d'échange.
Il veut donc l'aliéner pour d'autres marchandises dontla valeur d'usage puisse le satisfaire.
Toutes les marchandises sont des non-valeurs d'usage pour ceux qui lespossèdent et des valeurs d'usage pour ceux qui ne les possèdent pas.
Aussi, faut-il qu'elles passent d'une main dansl'autre.
Mais ce changement de mains constitue leur échange et leur échange les rapporte les unes aux autrescomme valeurs et les réalise comme valeurs.
Il faut donc que les marchandises se manifestent comme valeurs avantqu'elle puissent se réaliser comme valeurs d'usage.
D'un autre côté, il faut que leur valeur d'usage soit constatéeavant qu'elles puissent se réaliser comme valeurs ; car le travail humain dépensé dans leur production ne comptequ'autant qu'il est dépensé sous une forme utile à d'autres » [ibid., p.
95-96].La distinction entre valeur d'usage et valeur conduit à la distinction entre l'échangiste et la marchandise, laquellepréfigure la séparation entre l'ouvrier et la force de travail dont il est le propriétaire avant l'échange salarial (c'est-à-dire l'échange de biens de consommation contre une capacité de travail durant un temps limité).
Enfin, cetéchange est fondamentalement un acte social.
b.
La valeur immédiate des objets qui servent de moyen à la réalisation d'une fin
Dans le cas des valeurs d'usage, pouvons nous dire que le temps est le critère de leur valeur, qu'une valeur d'usageest d'autant plus dotée de capital monétaire ou de capital social (c'est-à-dire, qu'elle fait l'objet d'une considérationrépandue dans l'espace social) que le temps a passé ? Non, dans la mesure où le critère de la valeur des objets quiservent de moyen à la réalisation d'une fin est leur utilité.
Une valeur d'usage a d'autant plus de valeur qu'ellerépond immédiatement à mes besoins : le temps n'est donc pas le critère approprié, mais plutôt l'immédiateté d'uneconstatation objective de l'utilité d'une chose.
II.
L'épreuve du temps est un critère pour les valeurs d'échange
a.
Qu'est-ce qu'une valeur d'échange ?
On peut primitivement distinguer l'échange du don de la manière suivante.
Le don serait gratuit et n'attendrait pasde retour, contrairement à l'échange qui en tant que tel exige d'autrui un retour.
Ainsi la mère donne la vie à son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DANS QUELLE MESURE L'ÉPREUVE DU TEMPS EST-ELLE UN CRITÈRE DE VALEUR ?
- L'épreuve du temps est-elle un critère de valeur dans le domaine esthétique ?
- L'épreuve du temps est-elle un critère de valeur et de vérité ?
- La distension de l'âme et la mesure du temps chez SAINT AUGUSTIN
- L’espace et le temps : les comparer; établir dans quelle mesure ils sont innés ou acquis. PLAN.