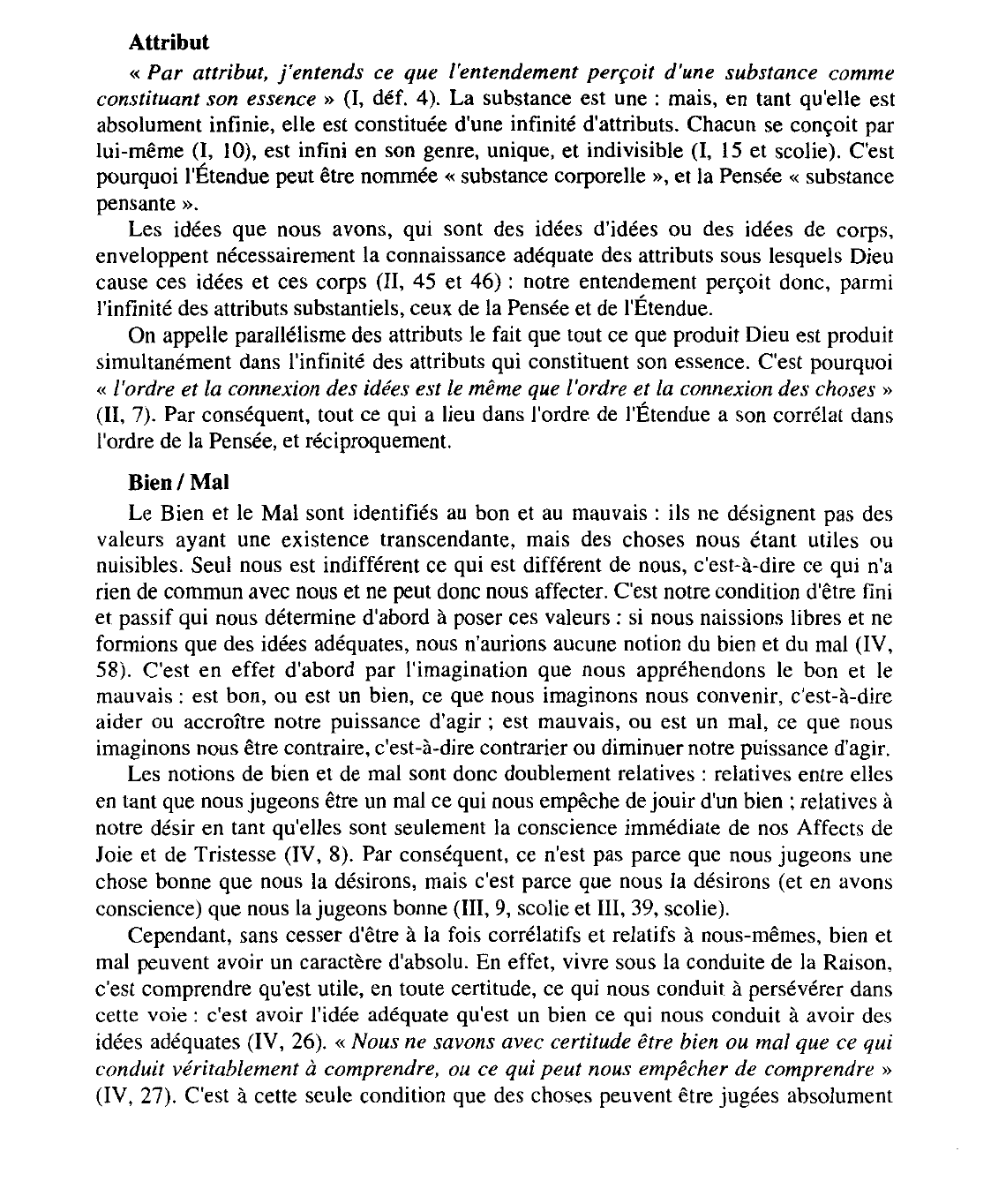concepts de la philosophie de Spinoza
Publié le 23/03/2015
Extrait du document

L'Être est puissance ; Dieu est action pure. Chaque chose singulière, étant un mode d'expression précis et déterminé de Dieu, affirme d'une manière précise et déterminée l'infinie puissance de Dieu (III, 6, démo.). Chaque chose est donc en elle-même une partie de cette action pure : elle est puissance d'agir.
Cette action, ou puissance, de chaque chose, est ce que Spinoza appelle son Conatus. On traduit d'ordinaire ce terme par « effort «. C'est sans doute la moins mauvaise traduction, puisque chaque chose s'affirme contre ce qui lui est contraire : le conatus est donc bien un effort, physique et mental, de résistance active à tout ce qui s'oppose à lui, c'est-à-dire effort pour vaincre les résistances extérieures. Mais cet effort ne doit pas être pensé comme une activité dépourvue de la puissance nécessaire pour atteindre son but (toute puissance est en acte, et il n'y a pas d'acte sans puissance). Autrement dit, tout effort est affirmation de puissance pour se conserver, et il n'y a pas de différence entre faire effort pour persévérer dans son être, et le faire bien (IV, 21, démo.) : s'efforcer d'agir, c'est agir. (III, 7, démo : agit, vel agere conatur). Si le mode humain en arrive à se négliger (voire à se suicider), ce n'est pas parce qu'il fait effort contre lui-même, mais parce qu'il fait effort pour lui-même et que la puissance de cet effort est limitée et contrariée par la puissance d'un effort opposé. Cette passivité est la marque de notre finitude ontologique (IV, 2 et 3).
Le conatus s'identifie à l'essence actuelle, ou donnée, de la chose (III, 7) : c'est-à-dire à l'essence de la chose, une fois que cette chose existe, et étant donné les affections qui disposent de telle ou telle manière sa quantité de puissance. D'elle se déduisent les actes qui servent à sa conservation (III, 9, scolie).

«
Vocabulaire 51
Attribut
« Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit d'une substance comme
constituant son
essence» (1, déf.
4).
La substance est une: mais, en tant qu'elle est
absolument infinie, elle est constituée d'une infinité d'attributs.
Chacun
se conçoit par
lui-même
(1, 10), est infini en son genre, unique, et indivisible (1, 15 et scolie).
C'est
pourquoi !'Étendue peut être nommée
« substance corporelle »,et la Pensée « substance
pensante».
Les idées que nous avons, qui sont des idées d'idées ou des idées de corps,
enveloppent nécessairement la connaissance adéquate des attributs sous lesquels Dieu
cause ces idées et ces corps (Il,
45 et 46) : notre entendement perçoit donc, parmi
l'infinité des attributs substantiels, ceux de la
Pensée et de !'Étendue.
On appelle parallélisme des attributs Je fait que tout ce que produit Dieu est produit
simultanément dans l'infinité des attributs qui constituent son essence.
C'est pourquoi
« l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses »
(Il, 7).
Par conséquent, tout ce qui a lieu dans l'ordre de !'Étendue a son corrélat dans
l'ordre
de la Pensée, et réciproquement.
Bien/Mal
Le Bien et Je Mal sont identifiés au bon et au mauvais : ils ne désignent pas des
valeurs ayant une existence transcendante, mais des choses nous étant utiles ou
nuisibles.
Seul nous est indifférent ce qui est différent de nous, c'est-à-dire ce qui n'a
rien
de commun avec nous et ne peut donc nous affecter.
C'est notre condition d'être fini
et passif qui nous détermine d'abord à poser ces valeurs :
si nous naissions libres et ne
formions que des idées adéquates, nous n'aurions aucune notion du bien et du mal (IV,
58).
C'est en effet d'abord par l'imagination que nous appréhendons le bon et le
mauvais : est bon, ou est
un bien, ce que nous imaginons nous convenir, c'est-à-dire
aider ou accroître notre puissance d'agir ; est mauvais, ou est un mal, ce que nous
imaginons nous être contraire, c'est-à-dire contrarier ou diminuer notre puissance d'agir.
Les notions de bien et de mal sont donc doublement relatives: relatives entre elles
en tant que nous jugeons être
un mal ce qui nous empêche de jouir d'un bien ; relatives à
notre désir en tant qu'elles sont seulement la conscience immédiate de nos Affects de
Joie et de Tristesse (IV, 8).
Par conséquent, ce n'est pas parce que nous jugeons une
chose bonne que nous la désirons, mais c'est parce que nous la désirons (et en avons
conscience) que nous la jugeons bonne (III,
9, scolie et Ill, 39, scolie).
Cependant, sans cesser d'être à la fois corrélatifs et relatifs à nous-mêmes, bien et
mal peuvent avoir
un caractère d'absolu.
En effet, vivre sous la conduite de la Raison,
c'est comprendre qu'est utile, en toute certitude, ce qui nous conduit
à persévérer dans
cette voie : c'est avoir l'idée adéquate qu'est
un bien ce qui nous conduit à avoir des
idées adéquates (IV, 26).
«Nous ne savons avec certitude être bien ou mal que ce qui
conduit véritablement à comprendre, ou ce qui
peut nous empêcher de comprendre »
(IV, 27).
C'est à cette seule condition que des choses peuvent être jugées absolument.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les concepts de la philosophie de Sartre
- Les concepts de la philosophie de Montesquieu
- Merleau-Ponty: sa philosophie et ses concepts
- Les concepts de la philosophie de Rousseau
- SPINOZA OU UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE GALILÉENNE