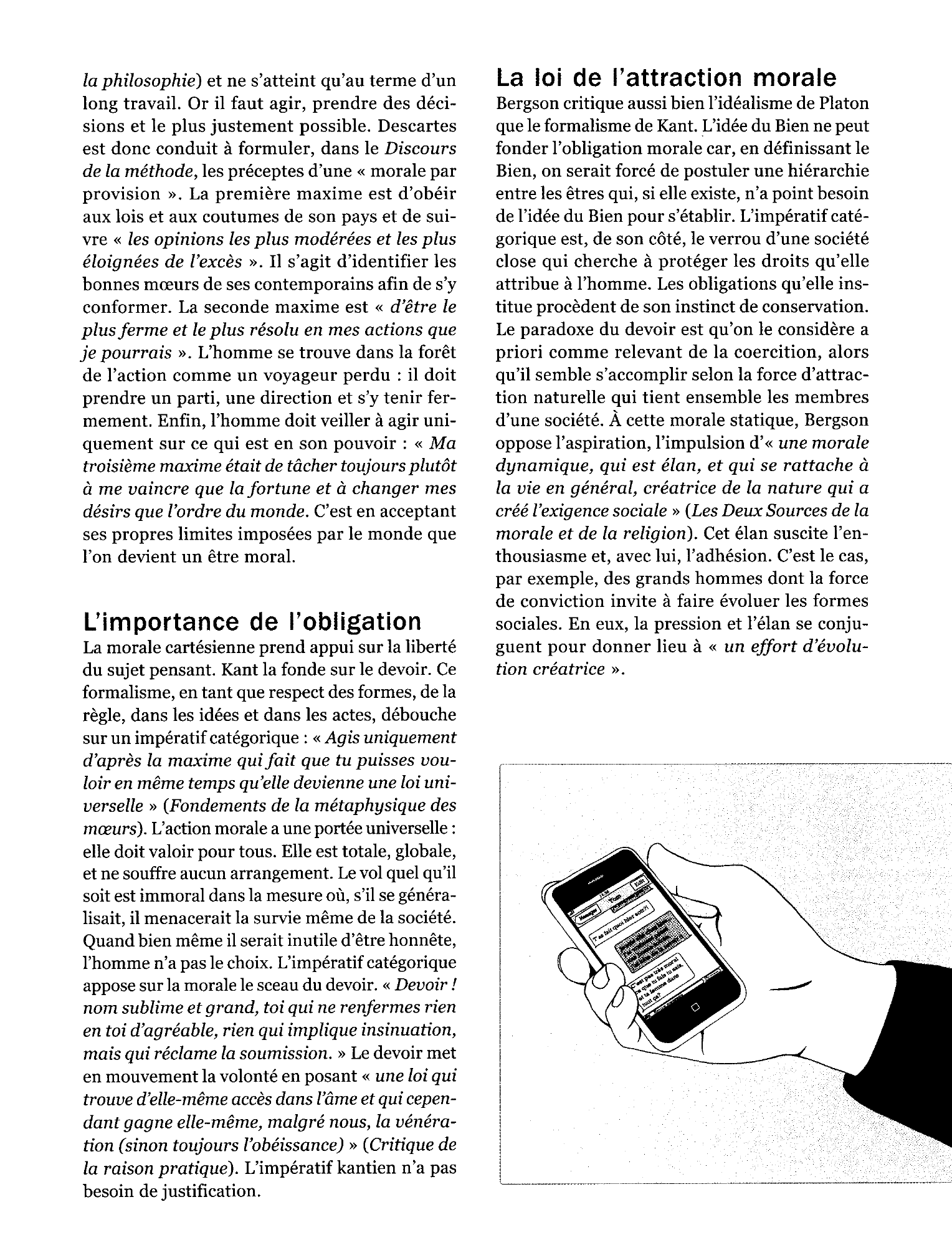Comment naît une morale ?
Publié le 29/01/2013
Extrait du document

Bergson critique aussi bien l'idéalisme de Platon que le formalisme de Kant. L'idée du Bien ne peut fonder l'obligation morale car, en définissant le Bien, on serait forcé de postuler une hiérarchie entre les êtres qui, si elle existe, n'a point besoin de l'idée du Bien pour s'établir. L'impératif catégorique est, de son côté, le verrou d'une société close qui cherche à protéger les droits qu'elle attribue à l'homme. Les obligations qu'elle institue procèdent de son instinct de conservation. Le paradoxe du devoir est qu'on le considère a priori comme relevant de la coercition, alors qu'il semble s'accomplir selon la force d'attraction naturelle qui tient ensemble les membres d'une société.

«
LES DOSSIERS PHILO
la philosophie) et ne s'atteint qu'au terme d'un
long travail.
Or il faut agir, prendre des déci
sions
et le plus justement possible.
Descartes
est donc conduit à formuler, dans le Discours
de
la méthode, les préceptes d'une « morale par
provision ».
La première maxime est d'obéir
aux lois et aux coutumes de son pays et de sui
vre
« les opinions les plus modérées et les plus
éloignées de l'excès
».
Il s'agit d'identifier les
bonnes
mœurs de ses contemporains afin de s'y
conformer.
La seconde maxime
est « d'être le
plus
ferme et le plus résolu en mes actions que
je pourrais ».
L'homme se trouve dans la forêt
de l'action comme
un voyageur perdu : il doit
prendre un parti, une direction et s'y tenir fer
mement.
Enfin, l'homme doit veiller
à agir uni
quement sur ce qui est en son pouvoir : « Ma
troisième maxime était de tâcher toujours plutôt
à me vaincre que la fortune et à changer mes
désirs que l'ordre du monde.
C'est en acceptant
ses propres limites imposées
par le monde que
l'on devient
un être moral.
L'importance de l'obligation
La morale cartésienne prend appui sur la liberté
du sujet pensant.
Kant la fonde
sur le devoir.
Ce
formalisme, en tant que respect des formes, de la
règle, dans les idées
et dans les actes, débouche
sur un impératif catégorique : « Agis uniquement
d'après
la maxime qui fait que tu puisses vou
loir en même temps qu'elle devienne une loi uni
verselle
» (Fondements de la métaphysique des
mœurs).
L'action morale a une portée universelle:
elle doit valoir pour tous.
Elle est totale, globale,
et ne souffre aucun arrangement.
Le vol quel qu'il
soit est immoral dans la mesure où, s'il se généra
lisait,
il menacerait la survie même de la société.
Quand bien même il serait inutile d'être honnête,
l'homme n'a pas le choix.
L'impératif catégorique
appose sur la morale le sceau du devoir.
« Devoir!
nom sublime
et grand, toi qui ne renfermes rien
en toi d'agréable, rien qui implique insinuation,
mais qui réclame
la soumission.
» Le devoir met
en mouvement la volonté en posant
« une loi qui
trouve d'elle-même accès dans l'âme et qui cepen
dant gagne elle-même, malgré nous,
la vénéra
tion (sinon toujours l'obéissance)
» (Critique de
la raison pratique).
L'impératif kantien n'a pas
besoin de justification.
La loi de l'attraction morale
Bergson critique aussi bien l'idéalisme de Platon
que le formalisme de Kant.
L'idée du Bien ne peut
fonder l'obligation morale car,
en définissant le
Bien,
on serait forcé de postuler une hiérarchie
entre les êtres qui, si elle existe, n'a point besoin
de l'idée du Bien pour s'établir.
L'impératif caté
gorique est, de son côté, le verrou
d'une société
close
qui cherche à protéger les droits qu'elle
attribue à l'homme.
Les obligations qu'elle ins
titue procèdent de son instinct de conservation.
Le paradoxe du devoir est qu'on le considère a
priori comme relevant de la coercition, alors
qu'il semble s'accomplir selon
la force d'attrac
tion naturelle qui tient ensemble les membres
d'une société.
À cette morale statique, Bergson
oppose l'aspiration, l'impulsion
d'« une morale
dynamique, qui est élan, et qui se rattache à
la vie en général, créatrice de la nature qui a
créé l'exigence sociale
» (Les Deux Sources de la
morale et de la religion).
Cet élan suscite l'en
thousiasme et, avec lui, l'adhésion.
C'est le cas,
par exemple, des grands hommes dont la force
de conviction invite
à faire évoluer les formes
sociales.
En eux, la pression
et l'élan se conju
guent pour donner lieu à « un effort d'évolu
tion créatrice
».
37.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- La morale et l'amour, un mariage impossible avec le roman le diable au corps de raymond radiguet
- La morale de Sartre
- La réflexion sur la morale
- La morale peut-elle s’enseigner ?