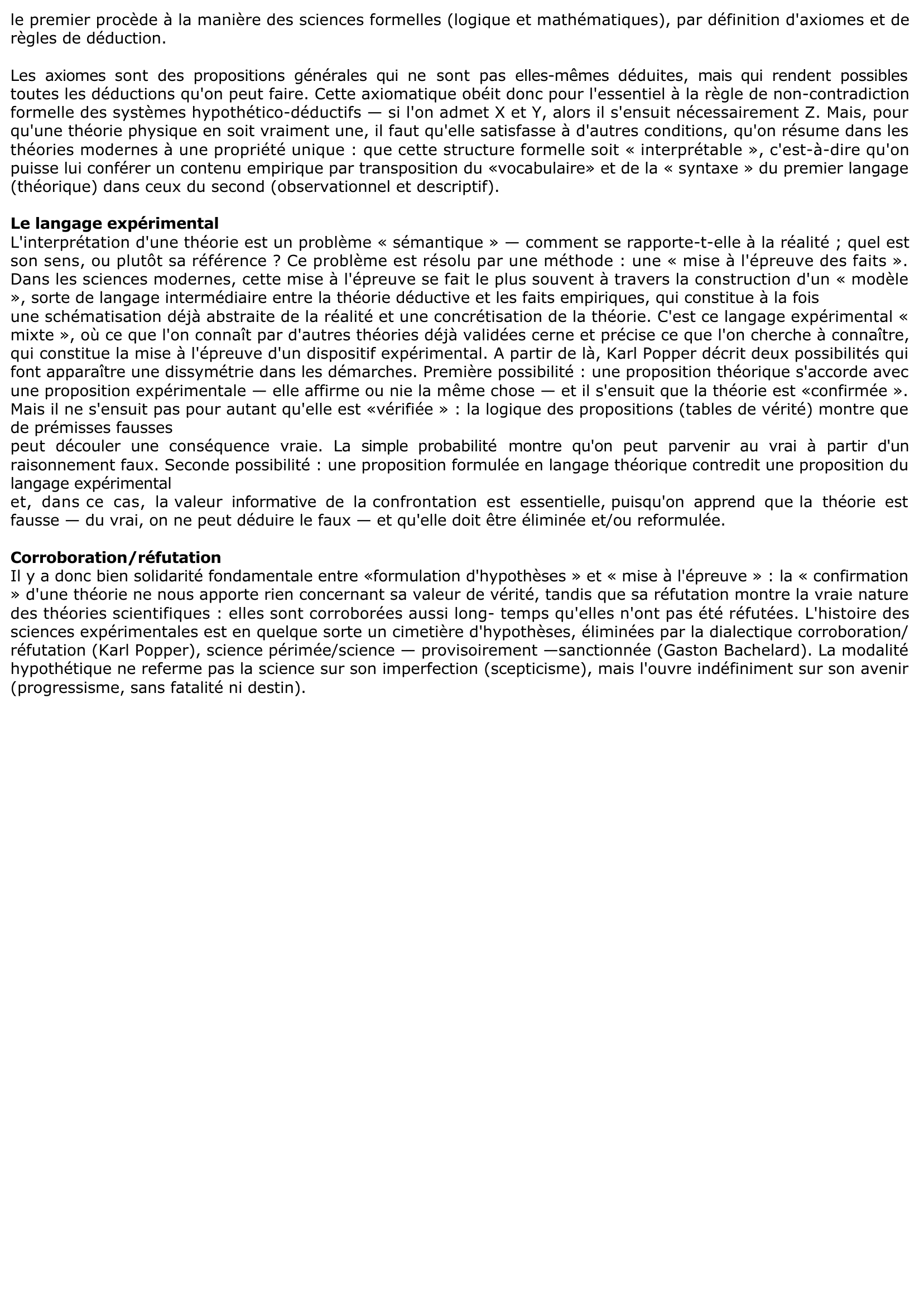Comment l'hypothèse vient-elle à l'esprit du savant ?
Publié le 14/02/2004
Extrait du document


«
le premier procède à la manière des sciences formelles (logique et mathématiques), par définition d'axiomes et derègles de déduction.
Les axiomes sont des propositions générales qui ne sont pas elles-mêmes déduites, mais qui rendent possiblestoutes les déductions qu'on peut faire.
Cette axiomatique obéit donc pour l'essentiel à la règle de non-contradictionformelle des systèmes hypothético-déductifs — si l'on admet X et Y, alors il s'ensuit nécessairement Z.
Mais, pourqu'une théorie physique en soit vraiment une, il faut qu'elle satisfasse à d'autres conditions, qu'on résume dans lesthéories modernes à une propriété unique : que cette structure formelle soit « interprétable », c'est-à-dire qu'onpuisse lui conférer un contenu empirique par transposition du «vocabulaire» et de la « syntaxe » du premier langage(théorique) dans ceux du second (observationnel et descriptif).
Le langage expérimentalL'interprétation d'une théorie est un problème « sémantique » — comment se rapporte-t-elle à la réalité ; quel estson sens, ou plutôt sa référence ? Ce problème est résolu par une méthode : une « mise à l'épreuve des faits ».Dans les sciences modernes, cette mise à l'épreuve se fait le plus souvent à travers la construction d'un « modèle», sorte de langage intermédiaire entre la théorie déductive et les faits empiriques, qui constitue à la foisune schématisation déjà abstraite de la réalité et une concrétisation de la théorie.
C'est ce langage expérimental «mixte », où ce que l'on connaît par d'autres théories déjà validées cerne et précise ce que l'on cherche à connaître,qui constitue la mise à l'épreuve d'un dispositif expérimental.
A partir de là, Karl Popper décrit deux possibilités quifont apparaître une dissymétrie dans les démarches.
Première possibilité : une proposition théorique s'accorde avecune proposition expérimentale — elle affirme ou nie la même chose — et il s'ensuit que la théorie est «confirmée ».Mais il ne s'ensuit pas pour autant qu'elle est «vérifiée » : la logique des propositions (tables de vérité) montre quede prémisses faussespeut découler une conséquence vraie.
La simple probabilité montre qu'on peut parvenir au vrai à partir d'unraisonnement faux.
Seconde possibilité : une proposition formulée en langage théorique contredit une proposition dulangage expérimentalet, dans ce cas, la valeur informative de la confrontation est essentielle, puisqu'on apprend que la théorie estfausse — du vrai, on ne peut déduire le faux — et qu'elle doit être éliminée et/ou reformulée.
Corroboration/réfutationIl y a donc bien solidarité fondamentale entre «formulation d'hypothèses » et « mise à l'épreuve » : la « confirmation» d'une théorie ne nous apporte rien concernant sa valeur de vérité, tandis que sa réfutation montre la vraie naturedes théories scientifiques : elles sont corroborées aussi long- temps qu'elles n'ont pas été réfutées.
L'histoire dessciences expérimentales est en quelque sorte un cimetière d'hypothèses, éliminées par la dialectique corroboration/réfutation (Karl Popper), science périmée/science — provisoirement —sanctionnée (Gaston Bachelard).
La modalitéhypothétique ne referme pas la science sur son imperfection (scepticisme), mais l'ouvre indéfiniment sur son avenir(progressisme, sans fatalité ni destin)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment l'hypothèse naît-elle dans l'esprit du savant ?
- D où vient, aux yeux du savant, la valeur privilégiée de l expérimentation?
- Celui qui pourrait regarder à l'intérieur d'un cerveau en pleine activité, suivre le va-et-vient des atomes et interpréter tout ce qu'ils font, celui-là saurait sans doute quelque chose de ce qui se passe dans l'esprit, mais il n'en saurait que peu de chose.
- L'?uvre d'art vient donc de l'esprit et existe pour l'esprit,
- « Est ce le doute ou la certitude qui constitue l'état d'esprit du savant ? »