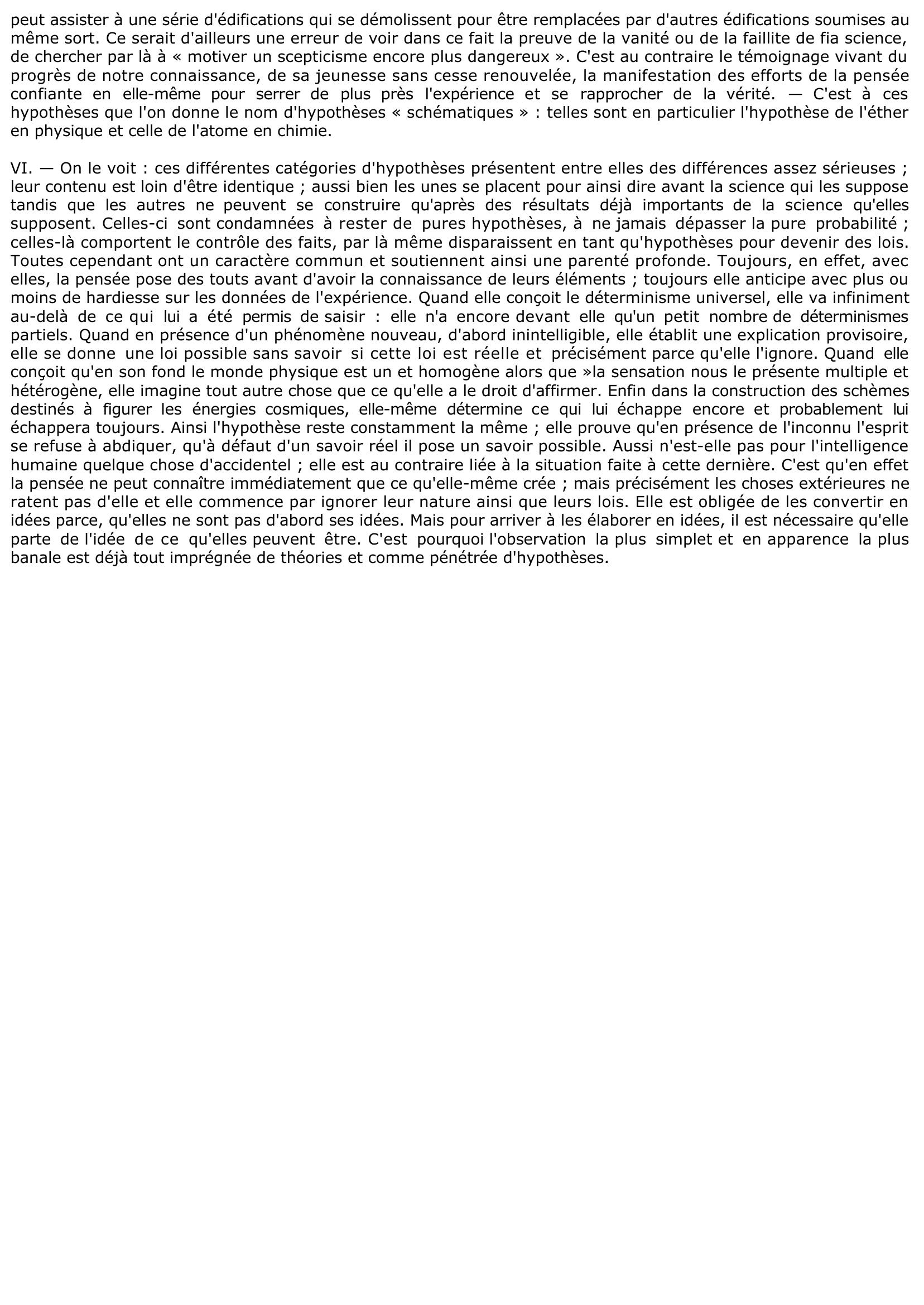Combien peut-on distinguer d'espèces d'hypothèses et quel est le caractère commun qui en fait l'unité ?
Publié le 05/03/2011
Extrait du document
I. — Il ne saurait être question de construire à priori les sciences du monde concret ; l'observation des faits est pour elles un moment absolument indispensable. Toutefois ce serait une erreur de croire que pour les constituer c'est assez de l'expérience. A. Comte et Cl. Bernard l'ont également proclamé : le pur empirisme est stérile. Il faut que la pensée intervienne, qu'elle anticipe sur ce qu'elle ne connaît pas encore, supplée aux lacunes et aux insuffisances de ce qui lui est donné, fasse des suppositions : c'est précisément là le rôle de l'hypothèse.
«
peut assister à une série d'édifications qui se démolissent pour être remplacées par d'autres édifications soumises aumême sort.
Ce serait d'ailleurs une erreur de voir dans ce fait la preuve de la vanité ou de la faillite de fia science,de chercher par là à « motiver un scepticisme encore plus dangereux ».
C'est au contraire le témoignage vivant duprogrès de notre connaissance, de sa jeunesse sans cesse renouvelée, la manifestation des efforts de la penséeconfiante en elle-même pour serrer de plus près l'expérience et se rapprocher de la vérité.
— C'est à ceshypothèses que l'on donne le nom d'hypothèses « schématiques » : telles sont en particulier l'hypothèse de l'étheren physique et celle de l'atome en chimie.
VI.
— On le voit : ces différentes catégories d'hypothèses présentent entre elles des différences assez sérieuses ;leur contenu est loin d'être identique ; aussi bien les unes se placent pour ainsi dire avant la science qui les supposetandis que les autres ne peuvent se construire qu'après des résultats déjà importants de la science qu'ellessupposent.
Celles-ci sont condamnées à rester de pures hypothèses, à ne jamais dépasser la pure probabilité ;celles-là comportent le contrôle des faits, par là même disparaissent en tant qu'hypothèses pour devenir des lois.Toutes cependant ont un caractère commun et soutiennent ainsi une parenté profonde.
Toujours, en effet, avecelles, la pensée pose des touts avant d'avoir la connaissance de leurs éléments ; toujours elle anticipe avec plus oumoins de hardiesse sur les données de l'expérience.
Quand elle conçoit le déterminisme universel, elle va infinimentau-delà de ce qui lui a été permis de saisir : elle n'a encore devant elle qu'un petit nombre de déterminismespartiels.
Quand en présence d'un phénomène nouveau, d'abord inintelligible, elle établit une explication provisoire,elle se donne une loi possible sans savoir si cette loi est réelle et précisément parce qu'elle l'ignore.
Quand elleconçoit qu'en son fond le monde physique est un et homogène alors que »la sensation nous le présente multiple ethétérogène, elle imagine tout autre chose que ce qu'elle a le droit d'affirmer.
Enfin dans la construction des schèmesdestinés à figurer les énergies cosmiques, elle-même détermine ce qui lui échappe encore et probablement luiéchappera toujours.
Ainsi l'hypothèse reste constamment la même ; elle prouve qu'en présence de l'inconnu l'espritse refuse à abdiquer, qu'à défaut d'un savoir réel il pose un savoir possible.
Aussi n'est-elle pas pour l'intelligencehumaine quelque chose d'accidentel ; elle est au contraire liée à la situation faite à cette dernière.
C'est qu'en effetla pensée ne peut connaître immédiatement que ce qu'elle-même crée ; mais précisément les choses extérieures neratent pas d'elle et elle commence par ignorer leur nature ainsi que leurs lois.
Elle est obligée de les convertir enidées parce, qu'elles ne sont pas d'abord ses idées.
Mais pour arriver à les élaborer en idées, il est nécessaire qu'elleparte de l'idée de ce qu'elles peuvent être.
C'est pourquoi l'observation la plus simplet et en apparence la plusbanale est déjà tout imprégnée de théories et comme pénétrée d'hypothèses..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Qu'ont gagné nos législateurs à distinguer cent mille espèces et faits particuliers et à y attacher cent mille lois ?
- Poisson-loup tacheté Une baveuse géante et bien armée Les poissons-loups ou blennies-chats, dont 5 espèces seulement sont connues, doivent leur nom commun à l'aspect peu engageant de leur gueule armée à l'avant de puissantes dents en forme de crocs.
- L'UNITÉ DE ROUSSEAU: Peut-on trouver un principe commun qui explique et comprenne les oeuvres si diverses de Rousseau ?
- Distinguer le bien Particulier et le bien Commun ?
- pou. pou, nom commun de plusieurs espèces de petits insectes aptères