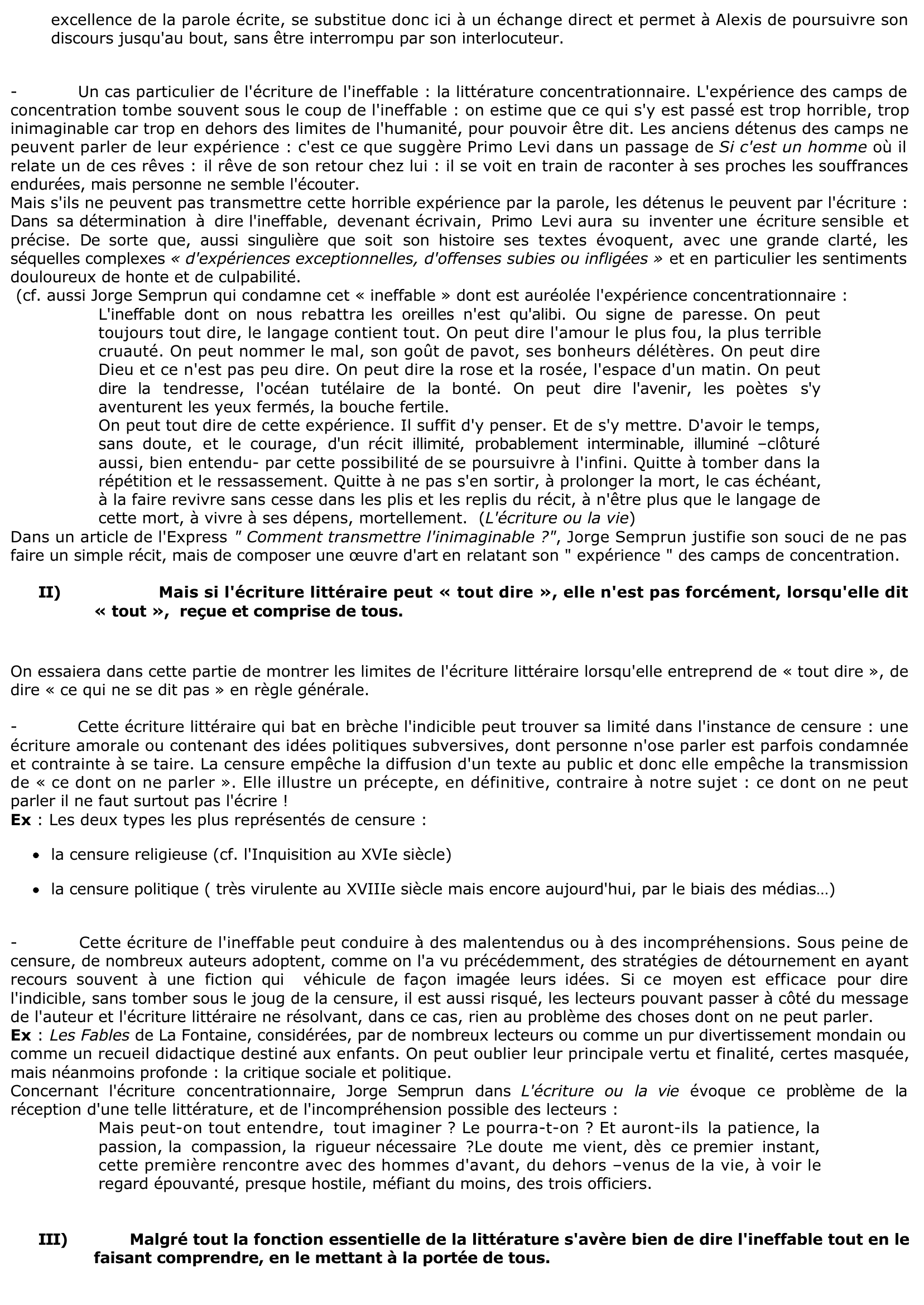Ce dont ne peut parler, il faut l'écrire. ?
Publié le 15/08/2005
Extrait du document
«
excellence de la parole écrite, se substitue donc ici à un échange direct et permet à Alexis de poursuivre sondiscours jusqu'au bout, sans être interrompu par son interlocuteur.
- Un cas particulier de l'écriture de l'ineffable : la littérature concentrationnaire.
L'expérience des camps deconcentration tombe souvent sous le coup de l'ineffable : on estime que ce qui s'y est passé est trop horrible, tropinimaginable car trop en dehors des limites de l'humanité, pour pouvoir être dit.
Les anciens détenus des camps nepeuvent parler de leur expérience : c'est ce que suggère Primo Levi dans un passage de Si c'est un homme où il relate un de ces rêves : il rêve de son retour chez lui : il se voit en train de raconter à ses proches les souffrances endurées, mais personne ne semble l'écouter . Mais s'ils ne peuvent pas transmettre cette horrible expérience par la parole, les détenus le peuvent par l'écriture :Dans sa détermination à dire l'ineffable, devenant écrivain, Primo Levi aura su inventer une écriture sensible etprécise.
De sorte que, aussi singulière que soit son histoire ses textes évoquent, avec une grande clarté, lesséquelles complexes « d'expériences exceptionnelles, d'offenses subies ou infligées » et en particulier les sentiments douloureux de honte et de culpabilité.
(cf.
aussi Jorge Semprun qui condamne cet « ineffable » dont est auréolée l'expérience concentrationnaire : L'ineffable dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'alibi.
Ou signe de paresse.
On peuttoujours tout dire, le langage contient tout.
On peut dire l'amour le plus fou, la plus terriblecruauté.
On peut nommer le mal, son goût de pavot, ses bonheurs délétères.
On peut direDieu et ce n'est pas peu dire.
On peut dire la rose et la rosée, l'espace d'un matin.
On peutdire la tendresse, l'océan tutélaire de la bonté.
On peut dire l'avenir, les poètes s'yaventurent les yeux fermés, la bouche fertile.On peut tout dire de cette expérience.
Il suffit d'y penser.
Et de s'y mettre.
D'avoir le temps,sans doute, et le courage, d'un récit illimité, probablement interminable, illuminé –clôturéaussi, bien entendu- par cette possibilité de se poursuivre à l'infini.
Quitte à tomber dans larépétition et le ressassement.
Quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant,à la faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage decette mort, à vivre à ses dépens, mortellement.
( L'écriture ou la vie ) Dans un article de l'Express " Comment transmettre l'inimaginable ?" , Jorge Semprun justifie son souci de ne pas faire un simple récit, mais de composer une œuvre d'art en relatant son " expérience " des camps de concentration.
II) Mais si l'écriture littéraire peut « tout dire », elle n'est pas forcément, lorsqu'elle dit « tout », reçue et comprise de tous.
On essaiera dans cette partie de montrer les limites de l'écriture littéraire lorsqu'elle entreprend de « tout dire », dedire « ce qui ne se dit pas » en règle générale.
- Cette écriture littéraire qui bat en brèche l'indicible peut trouver sa limité dans l'instance de censure : uneécriture amorale ou contenant des idées politiques subversives, dont personne n'ose parler est parfois condamnéeet contrainte à se taire.
La censure empêche la diffusion d'un texte au public et donc elle empêche la transmissionde « ce dont on ne parler ».
Elle illustre un précepte, en définitive, contraire à notre sujet : ce dont on ne peutparler il ne faut surtout pas l'écrire !Ex : Les deux types les plus représentés de censure :
la censure religieuse (cf.
l'Inquisition au XVIe siècle)
la censure politique ( très virulente au XVIIIe siècle mais encore aujourd'hui, par le biais des médias…)
- Cette écriture de l'ineffable peut conduire à des malentendus ou à des incompréhensions.
Sous peine decensure, de nombreux auteurs adoptent, comme on l'a vu précédemment, des stratégies de détournement en ayantrecours souvent à une fiction qui véhicule de façon imagée leurs idées.
Si ce moyen est efficace pour direl'indicible, sans tomber sous le joug de la censure, il est aussi risqué, les lecteurs pouvant passer à côté du messagede l'auteur et l'écriture littéraire ne résolvant, dans ce cas, rien au problème des choses dont on ne peut parler.Ex : Les Fables de La Fontaine, considérées, par de nombreux lecteurs ou comme un pur divertissement mondain ou comme un recueil didactique destiné aux enfants.
On peut oublier leur principale vertu et finalité, certes masquée,mais néanmoins profonde : la critique sociale et politique.Concernant l'écriture concentrationnaire, Jorge Semprun dans L'écriture ou la vie évoque ce problème de la réception d'une telle littérature, et de l'incompréhension possible des lecteurs : Mais peut-on tout entendre, tout imaginer ? Le pourra-t-on ? Et auront-ils la patience, lapassion, la compassion, la rigueur nécessaire ?Le doute me vient, dès ce premier instant,cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors –venus de la vie, à voir leregard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers.
III) Malgré tout la fonction essentielle de la littérature s'avère bien de dire l'ineffable tout en le faisant comprendre, en le mettant à la portée de tous..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le mode de l'écrit Des apprentissages progressifs Apprendre à écrire Au cycle 3, il faut mettre l'élève en situation de rédiger des textes plus complexes qui correspondent à des modèles textuels.
- Comment comprenez-vous cette pensée de Joubert : « Pour bien écrire, il faut une facilité naturelle et une difficulté acquise » ?
- Faut-il changer le proverbe de Boileau et écrire: Ce qui s'énonce bien se conçoit clairement ?
- Selon André Breton, un poème doit être « une débâcle de l'intellect ». Paul Valéry affirme au contraire : « J'aimerais infiniment mieux écrire en toute conscience, et dans une entière lucidité quelque chose de faible, que d'enfanter à la faveur d'une transe et hors de moi-même un chef-d'œuvre d'entre les plus beaux. » Faut-il donc condamner totalement le surréalisme ?
- Selon André Breton, un poème doit être « une débâcle de l'intellect ». Paul Valéry affirme au contraire : « J'aimerais infiniment mieux écrire en toute conscience, et dans une entière lucidité quelque chose de faible, que d'enfanter à la faveur d'une transe et hors de moi-même un chef-d'oeuvre d'entre les plus beaux. » Faut-il donc condamner totalement le surréalisme ?