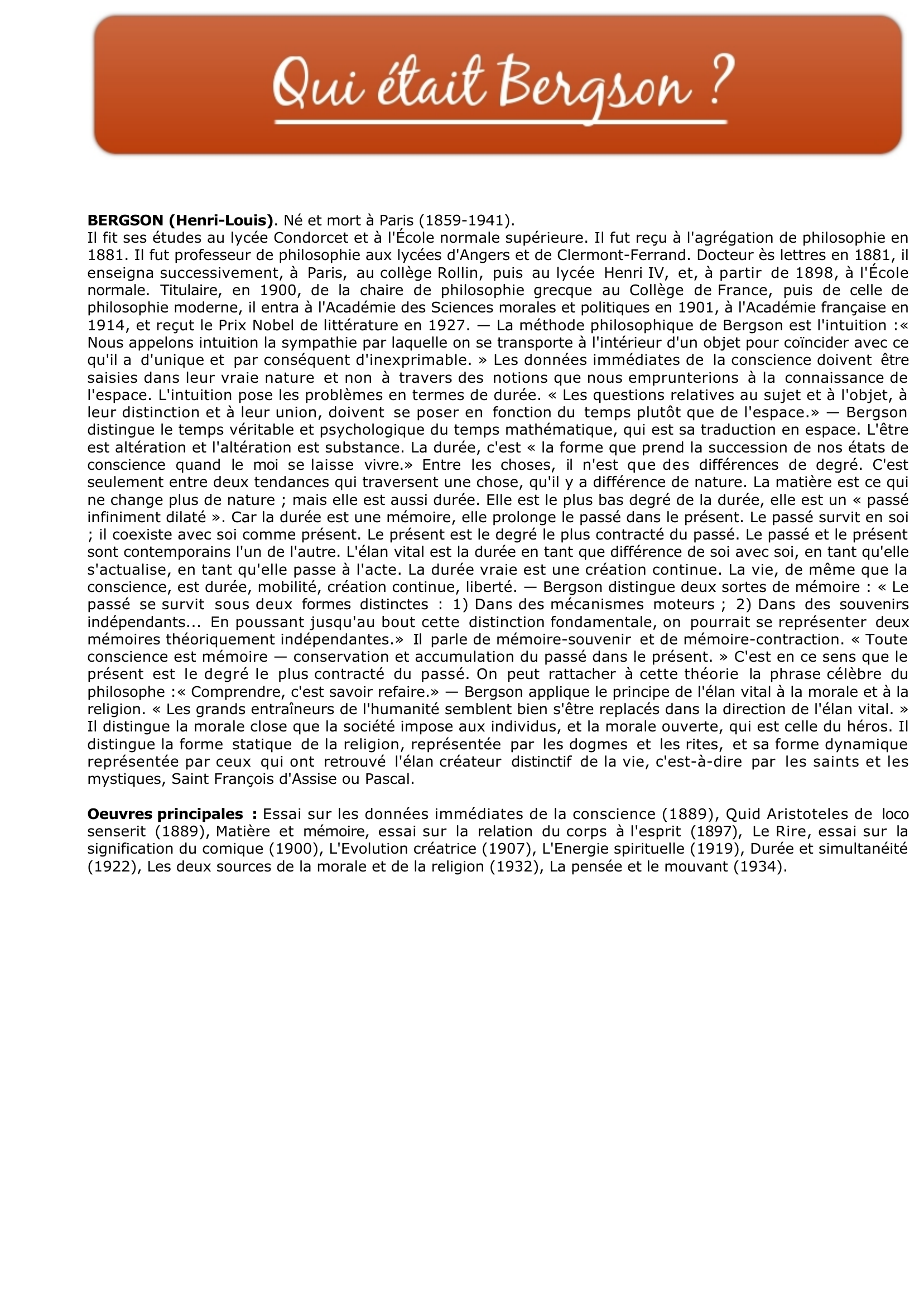Bergson: Langage et généralité
Publié le 20/04/2004
Extrait du document
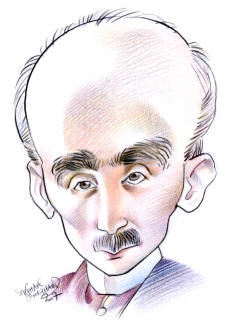
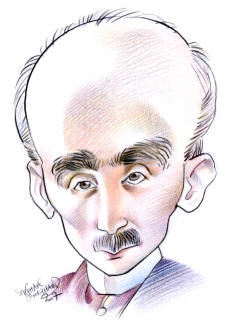
«
BERGSON (Henri-Louis) .
Né et mort à Paris (1859-1941). Il fit ses études au lycée Condorcet et à l'École normale supérieure.
Il fut reçu à l'agrégation de philosophie en1881.
Il fut professeur de philosophie aux lycées d'Angers et de Clermont-Ferrand.
Docteur ès lettres en 1881, ilenseigna successivement, à Paris, au collège Rollin, puis au lycée Henri IV, et, à partir de 1898, à l'Écolenormale.
Titulaire, en 1900, de la chaire de philosophie grecque au Collège de France, puis de celle dephilosophie moderne, il entra à l'Académie des Sciences morales et politiques en 1901, à l'Académie française en1914, et reçut le Prix Nobel de littérature en 1927.
— La méthode philosophique de Bergson est l'intuition :«Nous appelons intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec cequ'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable.
» Les données immédiates de la conscience doivent êtresaisies dans leur vraie nature et non à travers des notions que nous emprunterions à la connaissance del'espace.
L'intuition pose les problèmes en termes de durée.
« Les questions relatives au sujet et à l'objet, àleur distinction et à leur union, doivent se poser en fonction du temps plutôt que de l'espace.» — Bergsondistingue le temps véritable et psychologique du temps mathématique, qui est sa traduction en espace.
L'êtreest altération et l'altération est substance.
La durée, c'est « la forme que prend la succession de nos états deconscience quand le moi se laisse vivre.» Entre les choses, il n'est que des différences de degré.
C'estseulement entre deux tendances qui traversent une chose, qu'il y a différence de nature.
La matière est ce quine change plus de nature ; mais elle est aussi durée.
Elle est le plus bas degré de la durée, elle est un « passéinfiniment dilaté ».
Car la durée est une mémoire, elle prolonge le passé dans le présent.
Le passé survit en soi; il coexiste avec soi comme présent.
Le présent est le degré le plus contracté du passé.
Le passé et le présentsont contemporains l'un de l'autre.
L'élan vital est la durée en tant que différence de soi avec soi, en tant qu'elles'actualise, en tant qu'elle passe à l'acte.
La durée vraie est une création continue.
La vie, de même que laconscience, est durée, mobilité, création continue, liberté.
— Bergson distingue deux sortes de mémoire : « Lepassé se survit sous deux formes distinctes : 1) Dans des mécanismes moteurs ; 2) Dans des souvenirsindépendants...
En poussant jusqu'au bout cette distinction fondamentale, on pourrait se représenter deuxmémoires théoriquement indépendantes.» Il parle de mémoire-souvenir et de mémoire-contraction.
« Touteconscience est mémoire — conservation et accumulation du passé dans le présent.
» C'est en ce sens que leprésent est le degré le plus contracté du passé.
On peut rattacher à cette théorie la phrase célèbre duphilosophe :« Comprendre, c'est savoir refaire.» — Bergson applique le principe de l'élan vital à la morale et à lareligion.
« Les grands entraîneurs de l'humanité semblent bien s'être replacés dans la direction de l'élan vital.
»Il distingue la morale close que la société impose aux individus, et la morale ouverte, qui est celle du héros.
Ildistingue la forme statique de la religion, représentée par les dogmes et les rites, et sa forme dynamiquereprésentée par ceux qui ont retrouvé l'élan créateur distinctif de la vie, c'est-à-dire par les saints et lesmystiques, Saint François d'Assise ou Pascal.
Oeuvres principales : Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Quid Aristoteles de loco senserit (1889), Matière et mémoire, essai sur la relation du corps à l'esprit (1897), Le Rire, essai sur lasignification du comique (1900), L'Evolution créatrice (1907), L'Energie spirituelle (1919), Durée et simultanéité(1922), Les deux sources de la morale et de la religion (1932), La pensée et le mouvant (1934)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication de texte Bergson le langage
- LE LANGAGE - Bergson, L’évolution créatrice
- Bergson, L’évolution créatrice: le langage
- Bergson: Le langage; la société.
- La question du langage des animaux : BERGSON