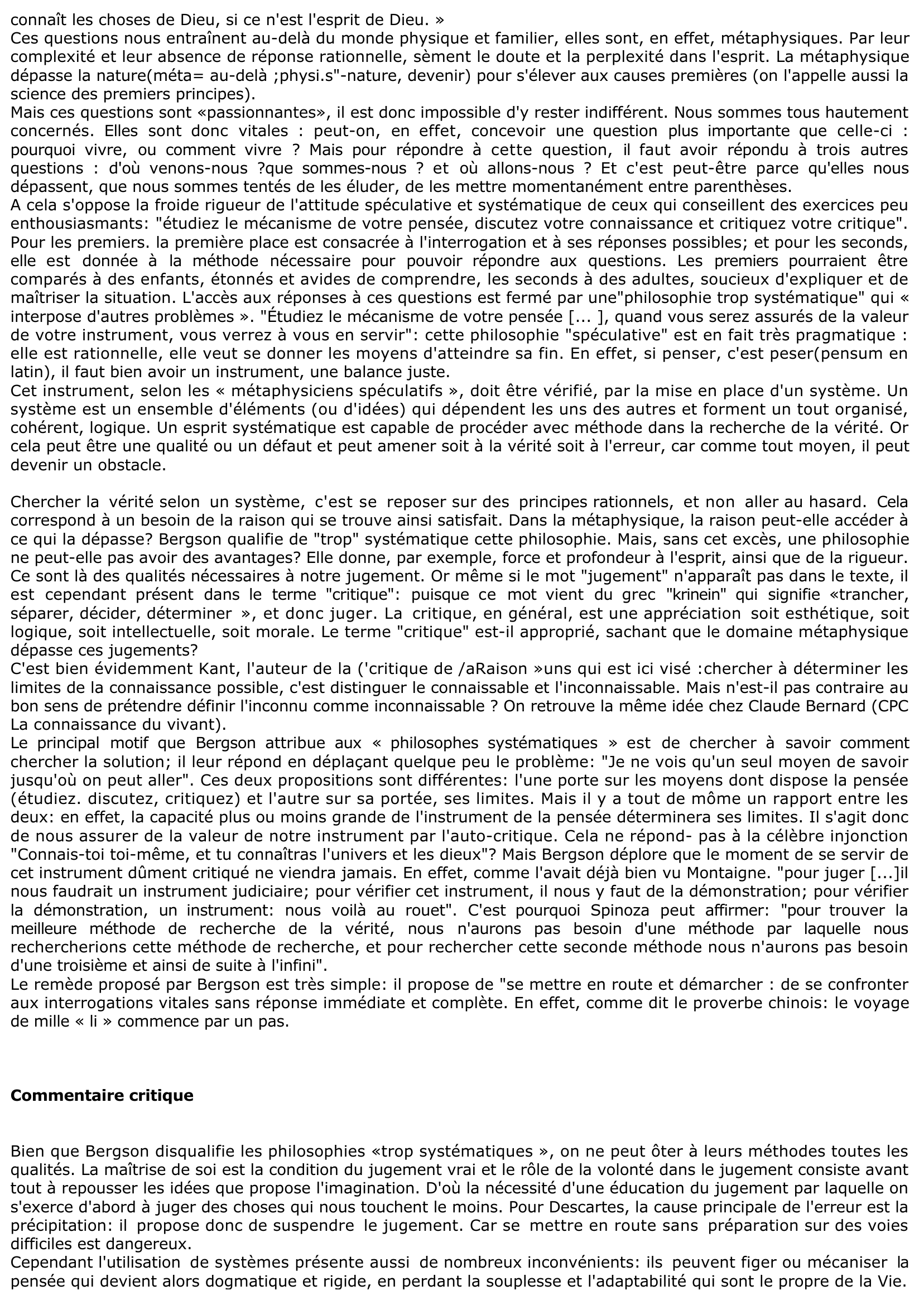BERGSON et la métaphysique
Publié le 18/04/2009
Extrait du document
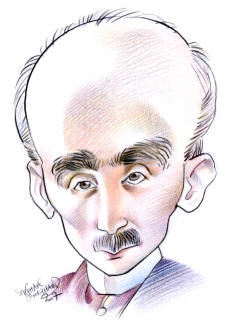
Dans le texte qui nous est proposé, Bergson opte catégoriquement pour la deuxième hypothèse : selon lui, bien que les questions relatives à notre origine, et au sens de l'existence soient fondamentales, elles n'occupent pas la place qui leur est due dans les réflexions des philosophes professionnels : celles-ci posent un préalable qui finit par être un obstacle infranchissable, car mettre en examen notre faculté de juger. c'est l'immobiliser. la suspendre. Mais si «pour savoir jusqu'où on peut aller, il suffit de se mettre en route et de marcher «, ne risque-t-on pas de se perdre? L'esprit a-t-il donc besoin d'aucune formation? La métaphysique est-elle accessible à tous? La volonté suffit-elle pour nous mener à la vérité?
- 1) L'auteur commence par indiquer les questions fondamentales qui devraient occuper tout philosophe.
- 2) Puis, en une prosopopée, il oppose les objections formulées par une philosophie « trop systématique « : la pensée doit commencer par s'examiner elle-même et définir ses propres limites.
- 3) Enfin, il répond à cette objection en énonçant sa thèse: en commençant ainsi on est sûr de ne jamais aboutir.
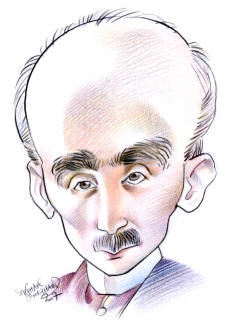
«
connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu.
»Ces questions nous entraînent au-delà du monde physique et familier, elles sont, en effet, métaphysiques.
Par leurcomplexité et leur absence de réponse rationnelle, sèment le doute et la perplexité dans l'esprit.
La métaphysiquedépasse la nature(méta= au-delà ;physi.s"-nature, devenir) pour s'élever aux causes premières (on l'appelle aussi lascience des premiers principes).Mais ces questions sont «passionnantes», il est donc impossible d'y rester indifférent.
Nous sommes tous hautementconcernés.
Elles sont donc vitales : peut-on, en effet, concevoir une question plus importante que celle-ci :pourquoi vivre, ou comment vivre ? Mais pour répondre à cette question, il faut avoir répondu à trois autresquestions : d'où venons-nous ?que sommes-nous ? et où allons-nous ? Et c'est peut-être parce qu'elles nousdépassent, que nous sommes tentés de les éluder, de les mettre momentanément entre parenthèses.A cela s'oppose la froide rigueur de l'attitude spéculative et systématique de ceux qui conseillent des exercices peuenthousiasmants: "étudiez le mécanisme de votre pensée, discutez votre connaissance et critiquez votre critique".Pour les premiers.
la première place est consacrée à l'interrogation et à ses réponses possibles; et pour les seconds,elle est donnée à la méthode nécessaire pour pouvoir répondre aux questions.
Les premiers pourraient êtrecomparés à des enfants, étonnés et avides de comprendre, les seconds à des adultes, soucieux d'expliquer et demaîtriser la situation.
L'accès aux réponses à ces questions est fermé par une"philosophie trop systématique" qui «interpose d'autres problèmes ».
"Étudiez le mécanisme de votre pensée [...
], quand vous serez assurés de la valeurde votre instrument, vous verrez à vous en servir": cette philosophie "spéculative" est en fait très pragmatique :elle est rationnelle, elle veut se donner les moyens d'atteindre sa fin.
En effet, si penser, c'est peser(pensum enlatin), il faut bien avoir un instrument, une balance juste.Cet instrument, selon les « métaphysiciens spéculatifs », doit être vérifié, par la mise en place d'un système.
Unsystème est un ensemble d'éléments (ou d'idées) qui dépendent les uns des autres et forment un tout organisé,cohérent, logique.
Un esprit systématique est capable de procéder avec méthode dans la recherche de la vérité.
Orcela peut être une qualité ou un défaut et peut amener soit à la vérité soit à l'erreur, car comme tout moyen, il peutdevenir un obstacle.
Chercher la vérité selon un système, c'est se reposer sur des principes rationnels, et non aller au hasard.
Celacorrespond à un besoin de la raison qui se trouve ainsi satisfait.
Dans la métaphysique, la raison peut-elle accéder àce qui la dépasse? Bergson qualifie de "trop" systématique cette philosophie.
Mais, sans cet excès, une philosophiene peut-elle pas avoir des avantages? Elle donne, par exemple, force et profondeur à l'esprit, ainsi que de la rigueur.Ce sont là des qualités nécessaires à notre jugement.
Or même si le mot "jugement" n'apparaît pas dans le texte, ilest cependant présent dans le terme "critique": puisque ce mot vient du grec "krinein" qui signifie «trancher,séparer, décider, déterminer », et donc juger.
La critique, en général, est une appréciation soit esthétique, soitlogique, soit intellectuelle, soit morale.
Le terme "critique" est-il approprié, sachant que le domaine métaphysiquedépasse ces jugements?C'est bien évidemment Kant, l'auteur de la ('critique de /aRaison »uns qui est ici visé :chercher à déterminer leslimites de la connaissance possible, c'est distinguer le connaissable et l'inconnaissable.
Mais n'est-il pas contraire aubon sens de prétendre définir l'inconnu comme inconnaissable ? On retrouve la même idée chez Claude Bernard (CPCLa connaissance du vivant).Le principal motif que Bergson attribue aux « philosophes systématiques » est de chercher à savoir commentchercher la solution; il leur répond en déplaçant quelque peu le problème: "Je ne vois qu'un seul moyen de savoirjusqu'où on peut aller".
Ces deux propositions sont différentes: l'une porte sur les moyens dont dispose la pensée(étudiez.
discutez, critiquez) et l'autre sur sa portée, ses limites.
Mais il y a tout de môme un rapport entre lesdeux: en effet, la capacité plus ou moins grande de l'instrument de la pensée déterminera ses limites.
Il s'agit doncde nous assurer de la valeur de notre instrument par l'auto-critique.
Cela ne répond- pas à la célèbre injonction"Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux"? Mais Bergson déplore que le moment de se servir decet instrument dûment critiqué ne viendra jamais.
En effet, comme l'avait déjà bien vu Montaigne.
"pour juger [...]ilnous faudrait un instrument judiciaire; pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration; pour vérifierla démonstration, un instrument: nous voilà au rouet".
C'est pourquoi Spinoza peut affirmer: "pour trouver lameilleure méthode de recherche de la vérité, nous n'aurons pas besoin d'une méthode par laquelle nousrechercherions cette méthode de recherche, et pour rechercher cette seconde méthode nous n'aurons pas besoind'une troisième et ainsi de suite à l'infini".Le remède proposé par Bergson est très simple: il propose de "se mettre en route et démarcher : de se confronteraux interrogations vitales sans réponse immédiate et complète.
En effet, comme dit le proverbe chinois: le voyagede mille « li » commence par un pas.
Commentaire critique
Bien que Bergson disqualifie les philosophies «trop systématiques », on ne peut ôter à leurs méthodes toutes lesqualités.
La maîtrise de soi est la condition du jugement vrai et le rôle de la volonté dans le jugement consiste avanttout à repousser les idées que propose l'imagination.
D'où la nécessité d'une éducation du jugement par laquelle ons'exerce d'abord à juger des choses qui nous touchent le moins.
Pour Descartes, la cause principale de l'erreur est laprécipitation: il propose donc de suspendre le jugement.
Car se mettre en route sans préparation sur des voiesdifficiles est dangereux.Cependant l'utilisation de systèmes présente aussi de nombreux inconvénients: ils peuvent figer ou mécaniser lapensée qui devient alors dogmatique et rigide, en perdant la souplesse et l'adaptabilité qui sont le propre de la Vie..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bergson et la métaphysique
- Que signifie cette formule de BERGSON : « La métaphysique est l'expérience intégrale » ?
- L'EXPÉRIENCE MÉTAPHYSIQUE - BERGSON
- INTRODUCTION A LA MÉTAPHYSIQUE de Bergson
- Henri BERGSON, extrait du Cours I, Leçons de psychologie et de métaphysique