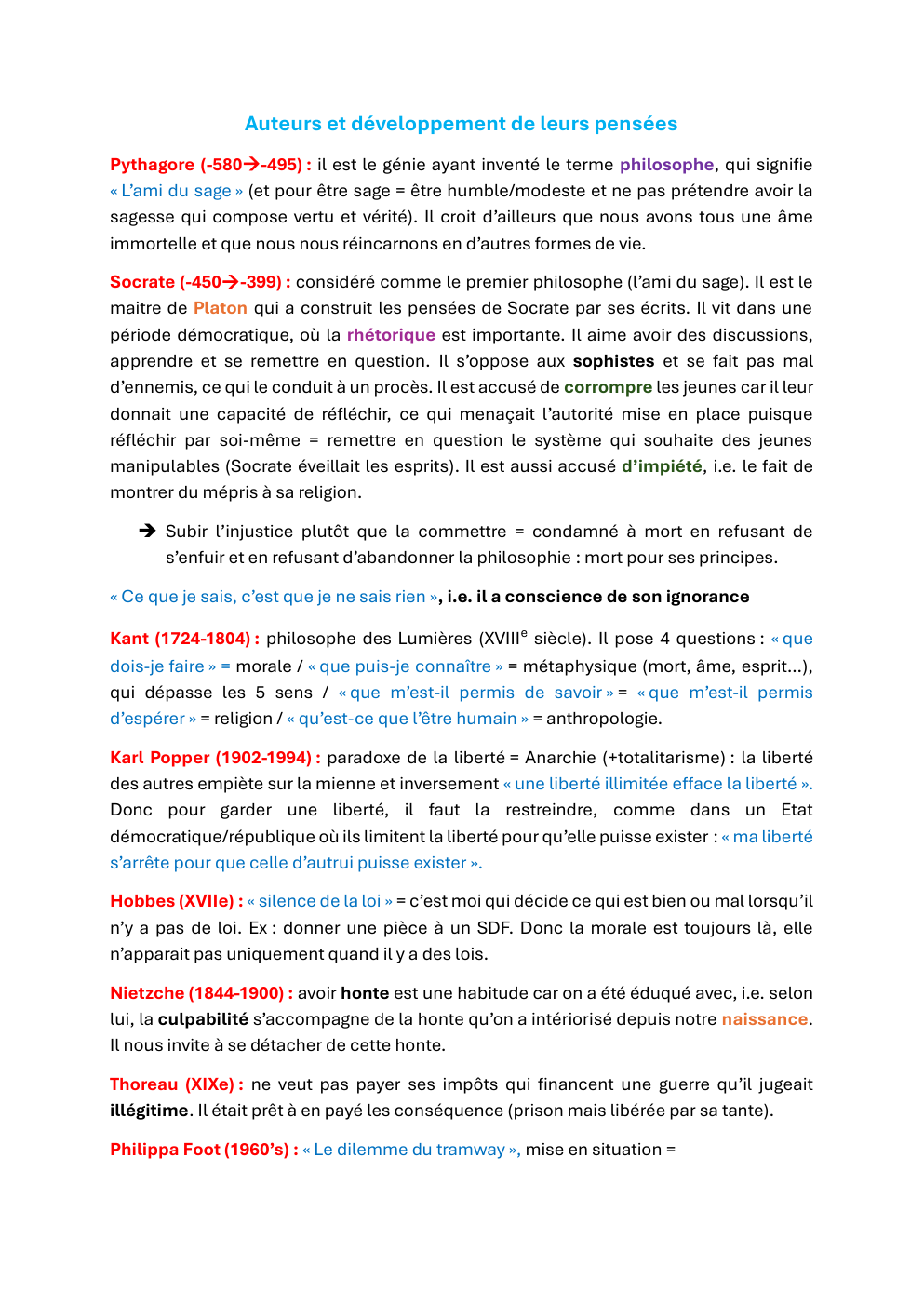Auteurs et développement de leurs pensées
Publié le 04/03/2025
Extrait du document
«
Auteurs et développement de leurs pensées
Pythagore (-580→-495) : il est le génie ayant inventé le terme philosophe, qui signifie
« L’ami du sage » (et pour être sage = être humble/modeste et ne pas prétendre avoir la
sagesse qui compose vertu et vérité).
Il croit d’ailleurs que nous avons tous une âme
immortelle et que nous nous réincarnons en d’autres formes de vie.
Socrate (-450→-399) : considéré comme le premier philosophe (l’ami du sage).
Il est le
maitre de Platon qui a construit les pensées de Socrate par ses écrits.
Il vit dans une
période démocratique, où la rhétorique est importante.
Il aime avoir des discussions,
apprendre et se remettre en question.
Il s’oppose aux sophistes et se fait pas mal
d’ennemis, ce qui le conduit à un procès.
Il est accusé de corrompre les jeunes car il leur
donnait une capacité de réfléchir, ce qui menaçait l’autorité mise en place puisque
réfléchir par soi-même = remettre en question le système qui souhaite des jeunes
manipulables (Socrate éveillait les esprits).
Il est aussi accusé d’impiété, i.e.
le fait de
montrer du mépris à sa religion.
➔ Subir l’injustice plutôt que la commettre = condamné à mort en refusant de
s’enfuir et en refusant d’abandonner la philosophie : mort pour ses principes.
« Ce que je sais, c’est que je ne sais rien », i.e.
il a conscience de son ignorance
Kant (1724-1804) : philosophe des Lumières (XVIIIe siècle).
Il pose 4 questions : « que
dois-je faire » = morale / « que puis-je connaître » = métaphysique (mort, âme, esprit…),
qui dépasse les 5 sens / « que m’est-il permis de savoir » = « que m’est-il permis
d’espérer » = religion / « qu’est-ce que l’être humain » = anthropologie.
Karl Popper (1902-1994) : paradoxe de la liberté = Anarchie (+totalitarisme) : la liberté
des autres empiète sur la mienne et inversement « une liberté illimitée efface la liberté ».
Donc pour garder une liberté, il faut la restreindre, comme dans un Etat
démocratique/république où ils limitent la liberté pour qu’elle puisse exister : « ma liberté
s’arrête pour que celle d’autrui puisse exister ».
Hobbes (XVIIe) : « silence de la loi » = c’est moi qui décide ce qui est bien ou mal lorsqu’il
n’y a pas de loi.
Ex : donner une pièce à un SDF.
Donc la morale est toujours là, elle
n’apparait pas uniquement quand il y a des lois.
Nietzche (1844-1900) : avoir honte est une habitude car on a été éduqué avec, i.e.
selon
lui, la culpabilité s’accompagne de la honte qu’on a intériorisé depuis notre naissance.
Il nous invite à se détacher de cette honte.
Thoreau (XIXe) : ne veut pas payer ses impôts qui financent une guerre qu’il jugeait
illégitime.
Il était prêt à en payé les conséquence (prison mais libérée par sa tante).
Philippa Foot (1960’s) : « Le dilemme du tramway », mise en situation =
1-A) j’actionne le levier et dévie le train et tue une seule personne = un meurtre
1-B) je ne fais rien et cinq personnes meurent = laisser mourir
Arg : c’est le destin, ce n’est pas à moi de choisir, je ne peux pas tuer quelqu’un, 5 vies
valent mieux qu’une seule vie, dans tous les cas c’est la merde mais l’intention compte
et elle est différente = CONFLIT DES DEVOIRS
Utilitariste : tue la personne seule car moins de peine aux parents et moins de dégâts
et considère le bonhomme comme un moyen dans le v2.
Ex 1 : tout seul sur une île déserte, il n’y a plus d’intérêt général donc il va faire ce qui
lui plait comme se laisser mourir, ne pas travailler…
Ex 2 : on a des devoirs pour les animaux car ils souffrent
Kant : on ne peut pas dévier le train car si tout le monde tuait pour l’intérêt général,
cela mène à une société invivable, et de plus, il ne peut pas choisir, car déjà il doit
considérer le bonhomme comme une fin et en plus il ne fait rien car il considère que
chaque vie mérite d’être sauvée.
Ex 1 : tout seul dans une île déserte, il a des devoirs envers lui-même et doit se
respecter, dès lors il doit se maintenir en vie, survivre, compter sur son hygiène,
travailler...
Ex 2 : les animaux n’ont pas la raison donc les H>animaux.
Cependant, il banni la
cruauté animale car ce n’est pas un manque de respect envers l’animal mais envers
l’humanité en lui-même car l’homme doit être doux, délicat, ne pas user de la violence
et montrer une mauvaise image de l’homme c’est un crime contre l’humanité et un acte
irrespectueux.
Bentham (XIXe) : un utilitariste qui exprime « la question avec les animaux n’est pas de
savoir s’ils peuvent penser mais s’ils peuvent souffrir », i.e.
on a des devoirs envers les
créatures qui peuvent souffrir
Aymeric Caron : respecter toute forme de vie, même les moustiques car ils ont eux aussi
le droit de vivre.
Il est antispécisme.
Hippocrate (-460→-377) : médecin qui a écrit des livres.
Il prône le secret médical et
insiste sur le fait de soigner tout être humain, peu importe l’affinité qu’on a avec lui.
Kant (1724-1804) : IMPERATIF CATHEGORIQUE (+hypothétique qui est plutôt un conseil
comme prendre son parapluie)
= universalisation de sa maxime, i.e.
appliquer des morales qui sont
susceptibles de devenir des morales universelles donc avant d’agit = se demander si tout
le monde agissait comme moi, qu’est-ce que cela fera ? conséquence positive/neutre =
je fais l’action / conséquence négative, chaotique qui mène à une société invivable = je
ne le fais pas.
Ex : se suicider.
= considérer en soi-même et en les autres toujours comme une fin et non
jamais uniquement comme un moyen, i.e.
respecter l’être humain et aussi soi-même,
car si on ne le fait pas, c’est comme un crime contre l’humanité (on a des devoirs envers
soi-même).
+ trouver des principes à valeur absolue, qui s’applique à tout être humains même ceux
qui n’habitent pas cette terre car cela requière de la logique, et par conséquent l’usage
de la raison = « Agis de telle sorte que la maxime de la volonté puisse toujours valoir
comme principe d’une législation (loi) universelle (qui s’applique à tout le monde) »,
i.e.
appliquer une morale dans toutes les circonstances, et la respecter comme si c’était
une loi de la nature qu’on ne peut y échapper.
= absurdité : « Le mensonge nuit toujours à autrui : même s’il ne nuit pas à un autre
homme, il nuit à l’humanité en général et rend vaine la source du devoir ».
Donc on ne
peut pas mentir car ça serait une société invivable + donner une mauvaise image de
l’humanité.
On doit dire la vérité tout le temps peu importe les circonstances (nazi : il
dénonce le juif).
➔ Il reprend le schéma du livre de Jean Paul Sartre et donc pour lui l’intention est une
certitude, i.e.
elle se fond sur des principes qu’on doit suivre et par conséquent
mentir est mal.
➔ La conséquence est dans le domaine de l’incertitude et par conséquent, quand
on agit les conséquences sont contingentes : il y en a qui peuvent être prévisibles,
d’autres peuvent être imprévisibles comme dans Le Mur.
Benjamin Constant (XIXe) : écrivain et philosophe qui est contre la pensée de Kant qu’il
juge absurde.
Il dit qu’il faut dire la vérité à ceux qui ont le droit à la vérité, mais si on nuit à quelqu’un
en disant la vérité et bien la personne perd le droit à la vérité.
Ex : le nazi perd le droit à la vérité car son intention envers le juif sera mauvaise (il le tuera
si je dénonce le juif), donc on a le choix entre se taire ou mentir.
Jean-Paul Sartre (1905-1980) : philosophe et écrivain qui a participé à la diffusion de
« l’existentialisme est un humanisme », notamment lors d’une conférence en 1945.
Il part
du principe que les individus sont les seuls responsables de leurs actes et qu’ils doivent
faire leurs propres choix en agissant en conséquence.
Dès lors, il est important qu’ils
reconnaissent leurs libertés qu’ils ont dans toutes circonstances.
+ « nous n’avons jamais été autant libre que durant l’occupation » = choix radicaux
comme rejoindre la révolution ou se laisser soumettre = les seuls à pouvoir choisir.
Tu ne
peux pas te baser sur Kant ou sur un utilitariste comme Mill.
Simone de Beauvoir (1908-1986) : philosophe qui a entretenu une relation passionnante
avec J-P-S.
Elle n’était tout de même pas d’accord sur les libertés.
Selon elle, on n’a plus
de libertés lorsqu’on n’est plus considéré comme un être humain.
Ex : les esclaves
sexuelles au Harem.
Aristote (-384→322) : philosophe et polymathe (s’intéresse à beaucoup de domaines).
Comment se servir des libertés ? Comment les utiliser = avec prudence.
Pour lui, il n’y a pas de science de la morale car là où....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La conscience que nous avons d'être les auteurs de nos actes et de nos pensées n'est-elle qu'illusion ?
- Quels moyens les auteurs ont-ils choisi pour faire percevoir aux lecteurs les sentiments et les pensées qui agitent les personnages principaux ?
- A. Gide voit dans toute la littérature française un dialogue entre deux formes de pensée dont tout jeune esprit serait faussé s'il n'écoutait ou si on ne lui laissait entendre que l'une des deux voix. Il écrit notamment : « Le dialogue reprend avec Pascal contre Montaigne. Il n'y a pas d'échange de propos entre eux, puisque Montaigne est mort lorsque Pascal commence à parler; mais c'est pourtant à lui qu'il s'adresse — et pas seulement dans l'illustre Entretien avec M. de Sacy. C'est a
- La lecture de tous bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée, en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleures de leurs pensées. Discours de la méthode Descartes, René. Commentez cette citation.
- La lecture de tous bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée, en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleures de leurs pensées. [ Discours de la méthode ] Descartes, René. Commentez cette citation.