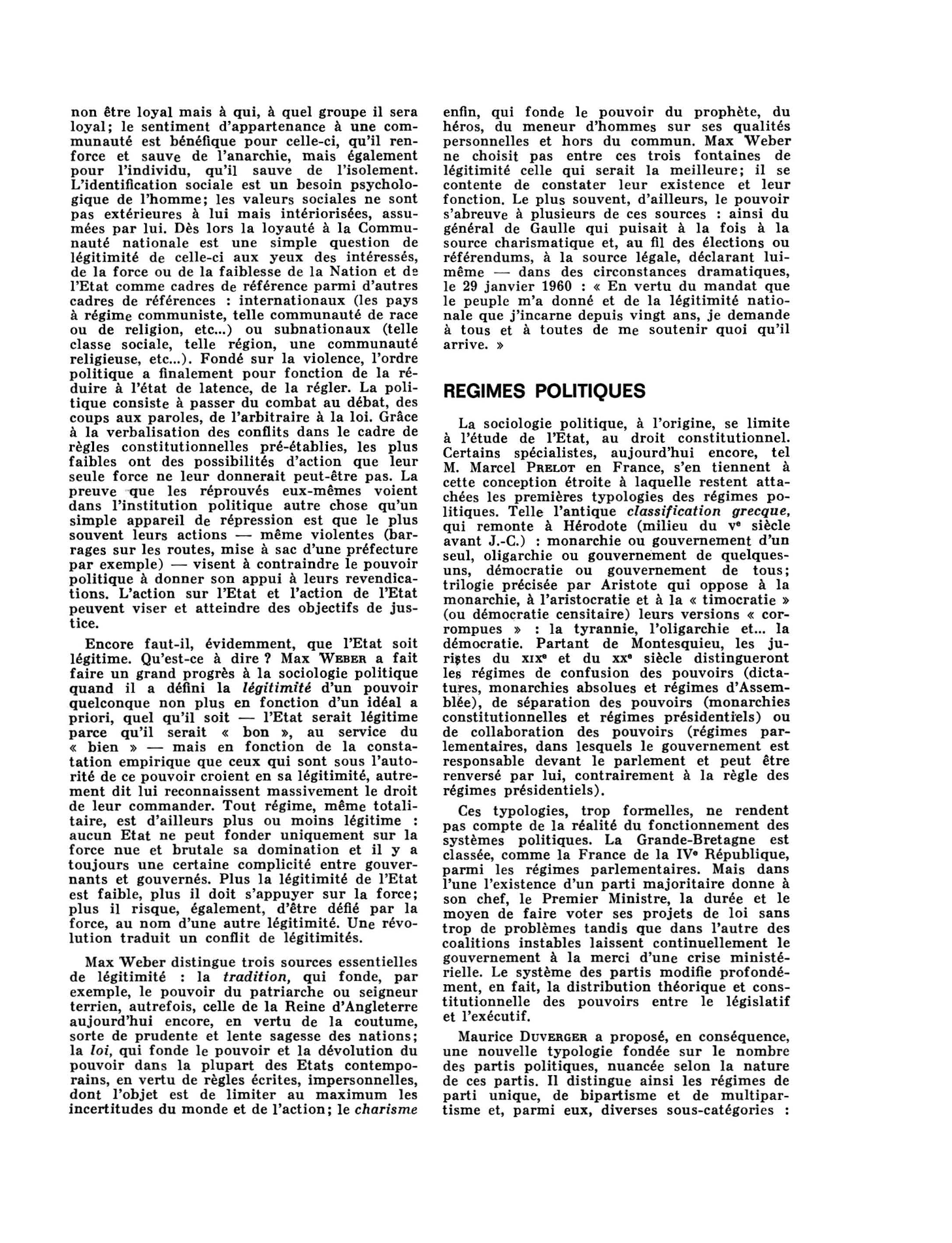ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE
Publié le 30/11/2011

Extrait du document
La notion de politique est liée à celle de pouvoir. Certains spécialistes de science politique comme Harold D. LASSWELL, voient même dans toute étude du pouvoir un objet de la science politique : ainsi du « pouvoir « dans un petit groupe, comme la famille, de la « politique « de telle entreprise industrielle ou commerciale, etc. Mais, à l'imitation d'Aristote (de la Politique, 335-332 avant J .-C.), la tendance générale a plutôt été de distinguer entre le pouvoir de l'Etat, celui des pouvoirs publics, et les autres formes d'autorité. Le sociologue allemand Max WEBER (1864-1920) fonde cette distinction sur le fait capital que le pouvoir politique est le seul à disposer légitimement de l'usage de la force, sur le territoire de son ressort, pour faire respecter ses décisions : le premier souci d'un Etat est de s'assurer le contrôle des armes, le monopole de leur usage par la police et l'armée. Dans l'Essence du politique, Julien FREUND pose les trois pré-supposés, les trois catégories essentielles du politique
«
non être loyal mais à qui, à quel groupe il sera loyal; le sentiment d'appartenance à une com munauté est bénéfique pour celle-ci, qu'il ren force et sauve de l'anarchie, mais également pour l'individu, qu'il sauve de l'isolement.
L'identification sociale est un besoin psycholo gique de l'homme; les valeurs sociales ne sont pas extérieures à lui mais intériorisées, assu mées par lui.
Dès lors la loyauté à la Commu nauté nationale est une simple question de légitimité de celle-ci aux yeux des intéres sés, de la force ou de la faiblesse de la Nation et de l'Etat comme cadres de référence parmi d'autres cadres de références : internationaux (les pays à régime communiste, telle communauté de race ou de religion, etc ...
) ou subnationaux (telle classe sociale, telle région, une communauté religieuse , etc ...
).
Fondé sur la violence, l'ordre politique a finalement pour fonction de la ré duire à l'état de latence, de la régler .
La poli tique consiste à passer du combat au débat, des coups aux paroles, de l'arbitraire à la loi.
Grâce à la verbalisation des conflits dans le cadre de règles constitutionnelles pré-établies, les plus faibles ont des possibilités d'action que leur seule force ne leur donnerait peut-être pas.
La preuve ·11ue les réprouvés eux-mêmes voient dans l'institution politique autre chose qu'un simple appareil de répression est que le plus souvent leurs actions - même violentes (bar rages sur les routes, mise à sac d'une préfecture par exemple) - visent à contraindre le pouvoir politique à donner son appui à leurs revendica tions.
L'action sur l'Etat et l'action de l'Etat peuvent viser et atteindre des objectifs de jus tice .
Encore faut-il, évidemment, que l'Etat soit légitime .
Qu'est-ce à dire ? Max WEBER a fait faire un grand progrès à la sociologie politique quand il a défini la légitimité d'un pouvoir quelconque non plus en fonction d'un idéal a priori, quel qu'il soit - l'Etat serait légitime parce qu 'il serait « bon », au service du « bien » - mais en fonction de la consta tation empirique que ceux qui sont sous l'auto rité de ce pouvoir croient en sa légitimité, autre ment dit lui reconnaissent massivement le droit de leur commander.
Tout régime, même totali taire , est d'ailleurs plus ou moins légitime :
a ucun Etat ne peut fonder uniquement sur la force nue et brutale sa domination et il y a toujours une certaine complicité entre gouver nants et gouvernés.
Plus la légitimité de l'Etat est faibl e , plus il doit s'appuyer sur la force; plus il risque, également, d'être défié par la force, au nom d 'une autre légitimité.
Une révo lution traduit un conflit de légitimités.
Max Weber distingue troi s sources essentielles de légitimité : la tradition, qui fonde, par exemple, le pouvoir du patriarche ou seigneur terrien, autrefois, celle de la Reine d'Angleterre aujourd'hui encore , en vertu de la coutume, sorte de prudente et lente sagesse des nations; la loi, qui fonde le pouvoir et la dévolution du pouvoir dans la plupart des Etats contempo rains, en vertu de règles écrites, impersonnelles, dont l'objet est de limiter au maximum les incertitudes du monde et de l'action; le charisme
enfin, qui fonde le pouvoir du prophète , du héros , du meneur d'hommes sur ses qualités personnelles et hors du commun.
Max Weber ne choisit pas entre ces trois fontaines de légitimité celle qui serait la meilleure; il se contente de constater leur existence et leur fonction .
Le plus souvent , d'ailleurs, le pouvoir s'abreuve à plusieurs de ces sources : ainsi du général de Gaulle qui puisait à la fois à la source charismatique et, au fil des élections ou référendums, à la source légale, déclarant lui même - dans des circonstances dramatiques, le 29 janvier 1960 : « En vertu du mandat que le peuple m'a donné et de la légitimité natio nale que j'incarne depuis vingt ans, je demande à tous et à toutes de me soutenir quoi qu'il arrive.
»
REGIMES POLITIQUES
La sociologie politique, à l'origine, se limite à l'étude de l'Etat, au droit constitutionnel.
Certains spécialistes, aujourd'hui encore, tel M.
Marcel PRELOT en France, s'en tiennent à cette conception étroite à laquelle restent atta chées les premières typologies des régimes po litiques.
Telle l'antique classification grecque, qui remonte à Hérodote (milieu du v• siècle avant J.-C.) : monarchie ou gouvernement d'un seul, oligarchie ou gouvernement de quelques uns, démocratie ou gouvernement de tous; trilogie précisée par Aristote qui oppose à la monarchie, à l'aristocratie et à la « timocratie » (ou démocratie censitaire) leurs versions « cor rompues » : la tyrannie, l'oligarchie et...
la démocratie.
Partant de Montesquieu, les ju rij es du XIX" et du xx• siècle distingueront les régimes de confusion des pouvoirs (dicta tures, monarchies absolues et régimes d' Assem blée) , de séparation des pouvoirs (monarchies constitutionnelles et régimes présidenti'els) ou de collaboration des pouvoirs (régimes par lementaires, dans lesquels le gouvernement est responsable devant le parlement et peut être renversé par lui, contrairement à la règle des régimes présidentiels) .
Ces
typologies, trop formelles, ne rendent pas compte de la réalité du fonctionnement des systèmes politiques.
La Grande-Bretagne est classée , comme la France de la IV• République, parmi les régimes parlementaires.
Mais dans l'une l 'existence d'un parti majoritaire donne à son chef , le Premier Ministre, la durée et le moyen de faire voter ses projets de loi sans trop de problèmes tandis que dans l'autre des coalitions instables laissent continuellement le gouvernement à la merci d'une crise ministé rielle .
Le système des partis modifie profondé ment, en fait, la distribution théorique et cons titutionnelle des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif.
Maurice DuvERGER a proposé, en conséquence , une nouvelle typologie fondée sur le nombre des partis politiques, nuancée selon la nature de ces partis.
Il distingue ainsi les régimes de parti unique, de bipartisme et de multipar tisme et, parmi eux, diverses sous-catégories :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les aspects généraux des organisations en gestion
- GREGOIRE, Henri, dit l'abbé (4 décembre 1750-28 mai 1831) Ecclésiastique et homme politique Il est député du clergé aux Etats généraux de 1789.
- MONTESQUIOU-FEZENSAC, François Xavier Marc Antoine duc de (1756-1832) Homme politique, il est Agent général du clergé dont il est le représentant aux Etats généraux.
- GREGOIRE, Henri, dit l'abbé (4 décembre 1750-28 mai 1831) Ecclésiastique et homme politique Il est député du clergé aux Etats généraux de 1789.
- BUZOT, François (1760-1794) Homme politique, il est député du tiers état aux Etats généraux (1789), siège avec les Girondins et prend part à la malheureuse insurrection fédéraliste.