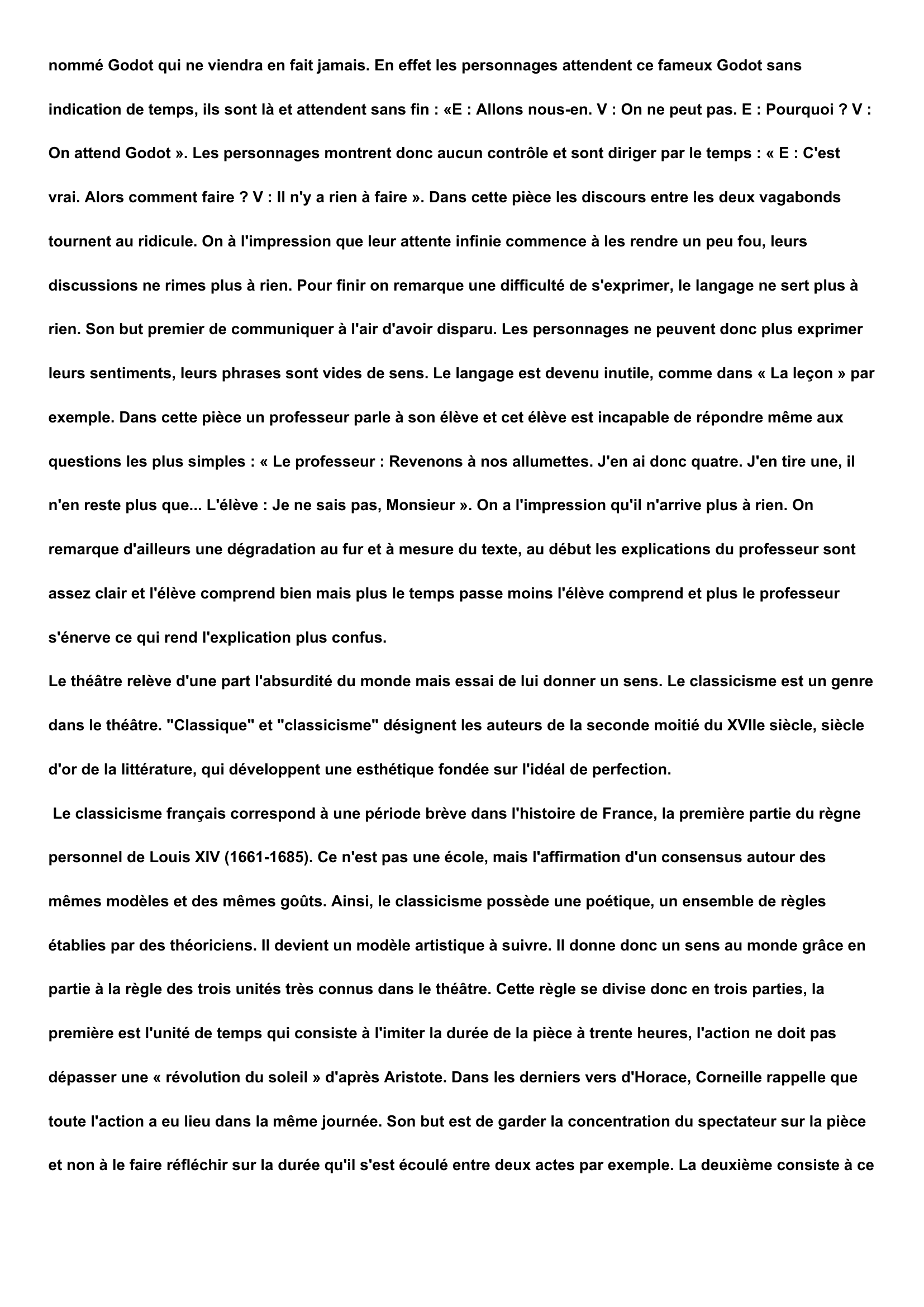A
Publié le 22/10/2012
Extrait du document
«
nommé Godot qui ne viendra en fait jamais.
En effet les personnages attendent ce fameux Godot sans
indication de temps, ils sont là et attendent sans fin : «E : Allons nous-en.
V : On ne peut pas.
E : Pourquoi ? V :
On attend Godot ».
Les personnages montrent donc aucun contrôle et sont diriger par le temps : « E : C'est
vrai.
Alors comment faire ? V : Il n'y a rien à faire ».
Dans cette pièce les discours entre les deux vagabonds
tournent au ridicule.
On à l'impression que leur attente infinie commence à les rendre un peu fou, leurs
discussions ne rimes plus à rien.
Pour finir on remarque une difficulté de s'exprimer, le langage ne sert plus à
rien.
Son but premier de communiquer à l'air d'avoir disparu.
Les personnages ne peuvent donc plus exprimer
leurs sentiments, leurs phrases sont vides de sens.
Le langage est devenu inutile, comme dans « La leçon » par
exemple.
Dans cette pièce un professeur parle à son élève et cet élève est incapable de répondre même aux
questions les plus simples : « Le professeur : Revenons à nos allumettes.
J'en ai donc quatre.
J'en tire une, il
n'en reste plus que...
L'élève : Je ne sais pas, Monsieur ».
On a l'impression qu'il n'arrive plus à rien.
On
remarque d'ailleurs une dégradation au fur et à mesure du texte, au début les explications du professeur sont
assez clair et l'élève comprend bien mais plus le temps passe moins l'élève comprend et plus le professeur
s'énerve ce qui rend l'explication plus confus.
Le théâtre relève d'une part l'absurdité du monde mais essai de lui donner un sens.
Le classicisme est un genre
dans le théâtre.
"Classique" et "classicisme" désignent les auteurs de la seconde moitié du XVIIe siècle, siècle
d'or de la littérature, qui développent une esthétique fondée sur l'idéal de perfection.
Le classicisme français correspond à une période brève dans l'histoire de France, la première partie du règne
personnel de Louis XIV (1661-1685).
Ce n'est pas une école, mais l'affirmation d'un consensus autour des
mêmes modèles et des mêmes goûts.
Ainsi, le classicisme possède une poétique, un ensemble de règles
établies par des théoriciens.
Il devient un modèle artistique à suivre.
Il donne donc un sens au monde grâce en
partie à la règle des trois unités très connus dans le théâtre.
Cette règle se divise donc en trois parties, la
première est l'unité de temps qui consiste à l'imiter la durée de la pièce à trente heures, l'action ne doit pas
dépasser une « révolution du soleil » d'après Aristote.
Dans les derniers vers d'Horace, Corneille rappelle que
toute l'action a eu lieu dans la même journée.
Son but est de garder la concentration du spectateur sur la pièce
et non à le faire réfléchir sur la durée qu'il s'est écoulé entre deux actes par exemple.
La deuxième consiste à ce.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓