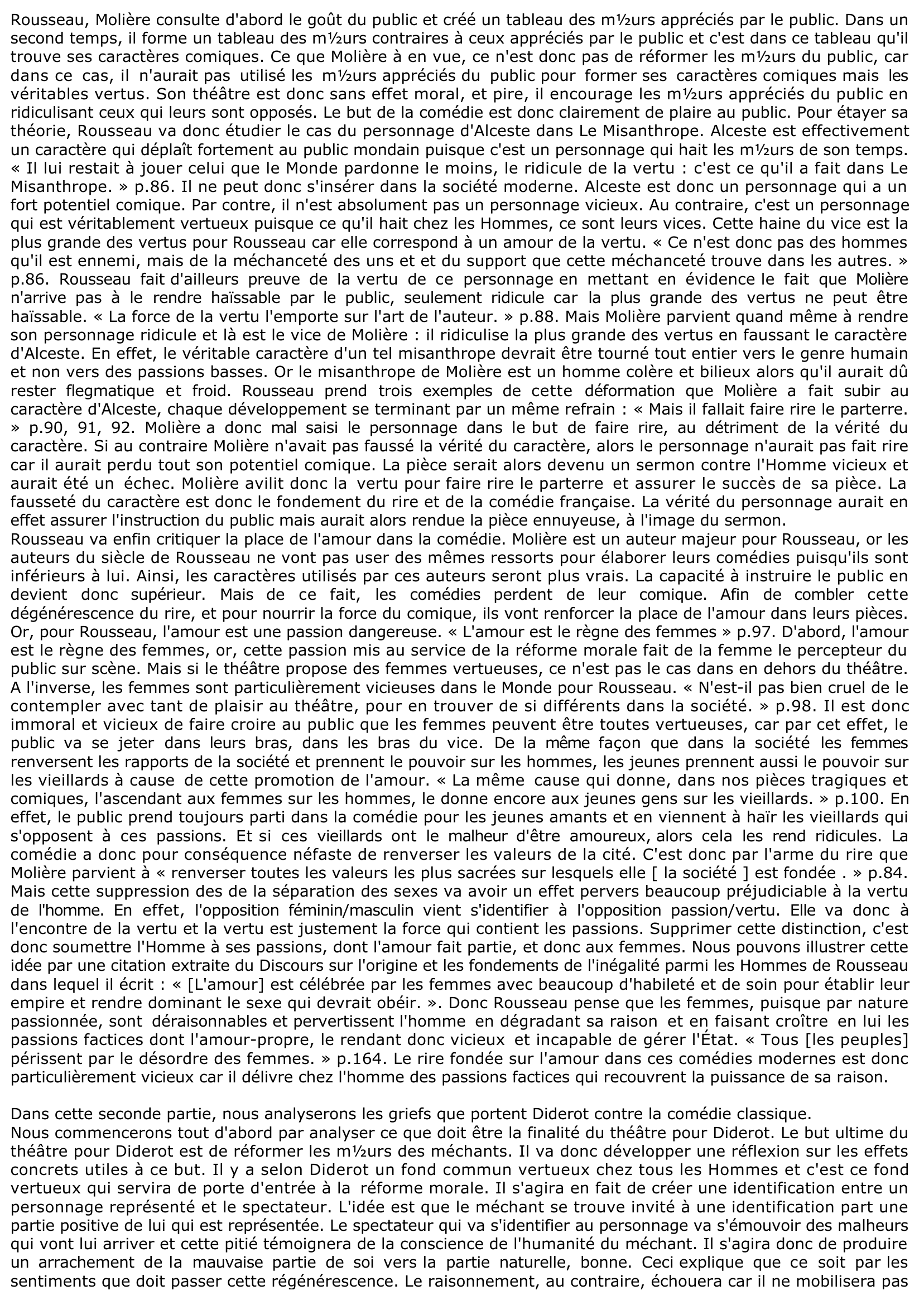Vous étudierez, et en vous appuyant sur des analyses précises, les critiques de Diderot et de Rousseau à l'égard du rire et de la comédie à la française ; vous préciserez leurs griefs respectifs et les solutions qu'ils proposent l'un et l'autre pour remédier à cette crise de la gaité française, caractéristiques des Lumières.
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
Rousseau, Molière consulte d'abord le goût du public et créé un tableau des m½urs appréciés par le public.
Dans unsecond temps, il forme un tableau des m½urs contraires à ceux appréciés par le public et c'est dans ce tableau qu'iltrouve ses caractères comiques.
Ce que Molière à en vue, ce n'est donc pas de réformer les m½urs du public, cardans ce cas, il n'aurait pas utilisé les m½urs appréciés du public pour former ses caractères comiques mais lesvéritables vertus.
Son théâtre est donc sans effet moral, et pire, il encourage les m½urs appréciés du public enridiculisant ceux qui leurs sont opposés.
Le but de la comédie est donc clairement de plaire au public.
Pour étayer sathéorie, Rousseau va donc étudier le cas du personnage d'Alceste dans Le Misanthrope.
Alceste est effectivementun caractère qui déplaît fortement au public mondain puisque c'est un personnage qui hait les m½urs de son temps.« Il lui restait à jouer celui que le Monde pardonne le moins, le ridicule de la vertu : c'est ce qu'il a fait dans LeMisanthrope.
» p.86.
Il ne peut donc s'insérer dans la société moderne.
Alceste est donc un personnage qui a unfort potentiel comique.
Par contre, il n'est absolument pas un personnage vicieux.
Au contraire, c'est un personnagequi est véritablement vertueux puisque ce qu'il hait chez les Hommes, ce sont leurs vices.
Cette haine du vice est laplus grande des vertus pour Rousseau car elle correspond à un amour de la vertu.
« Ce n'est donc pas des hommesqu'il est ennemi, mais de la méchanceté des uns et et du support que cette méchanceté trouve dans les autres.
»p.86.
Rousseau fait d'ailleurs preuve de la vertu de ce personnage en mettant en évidence le fait que Molièren'arrive pas à le rendre haïssable par le public, seulement ridicule car la plus grande des vertus ne peut êtrehaïssable.
« La force de la vertu l'emporte sur l'art de l'auteur.
» p.88.
Mais Molière parvient quand même à rendreson personnage ridicule et là est le vice de Molière : il ridiculise la plus grande des vertus en faussant le caractèred'Alceste.
En effet, le véritable caractère d'un tel misanthrope devrait être tourné tout entier vers le genre humainet non vers des passions basses.
Or le misanthrope de Molière est un homme colère et bilieux alors qu'il aurait dûrester flegmatique et froid.
Rousseau prend trois exemples de cette déformation que Molière a fait subir aucaractère d'Alceste, chaque développement se terminant par un même refrain : « Mais il fallait faire rire le parterre.» p.90, 91, 92.
Molière a donc mal saisi le personnage dans le but de faire rire, au détriment de la vérité ducaractère.
Si au contraire Molière n'avait pas faussé la vérité du caractère, alors le personnage n'aurait pas fait rirecar il aurait perdu tout son potentiel comique.
La pièce serait alors devenu un sermon contre l'Homme vicieux etaurait été un échec.
Molière avilit donc la vertu pour faire rire le parterre et assurer le succès de sa pièce.
Lafausseté du caractère est donc le fondement du rire et de la comédie française.
La vérité du personnage aurait eneffet assurer l'instruction du public mais aurait alors rendue la pièce ennuyeuse, à l'image du sermon.Rousseau va enfin critiquer la place de l'amour dans la comédie.
Molière est un auteur majeur pour Rousseau, or lesauteurs du siècle de Rousseau ne vont pas user des mêmes ressorts pour élaborer leurs comédies puisqu'ils sontinférieurs à lui.
Ainsi, les caractères utilisés par ces auteurs seront plus vrais.
La capacité à instruire le public endevient donc supérieur.
Mais de ce fait, les comédies perdent de leur comique.
Afin de combler cettedégénérescence du rire, et pour nourrir la force du comique, ils vont renforcer la place de l'amour dans leurs pièces.Or, pour Rousseau, l'amour est une passion dangereuse.
« L'amour est le règne des femmes » p.97.
D'abord, l'amourest le règne des femmes, or, cette passion mis au service de la réforme morale fait de la femme le percepteur dupublic sur scène.
Mais si le théâtre propose des femmes vertueuses, ce n'est pas le cas dans en dehors du théâtre.A l'inverse, les femmes sont particulièrement vicieuses dans le Monde pour Rousseau.
« N'est-il pas bien cruel de lecontempler avec tant de plaisir au théâtre, pour en trouver de si différents dans la société.
» p.98.
Il est doncimmoral et vicieux de faire croire au public que les femmes peuvent être toutes vertueuses, car par cet effet, lepublic va se jeter dans leurs bras, dans les bras du vice.
De la même façon que dans la société les femmesrenversent les rapports de la société et prennent le pouvoir sur les hommes, les jeunes prennent aussi le pouvoir surles vieillards à cause de cette promotion de l'amour.
« La même cause qui donne, dans nos pièces tragiques etcomiques, l'ascendant aux femmes sur les hommes, le donne encore aux jeunes gens sur les vieillards.
» p.100.
Eneffet, le public prend toujours parti dans la comédie pour les jeunes amants et en viennent à haïr les vieillards quis'opposent à ces passions.
Et si ces vieillards ont le malheur d'être amoureux, alors cela les rend ridicules.
Lacomédie a donc pour conséquence néfaste de renverser les valeurs de la cité.
C'est donc par l'arme du rire queMolière parvient à « renverser toutes les valeurs les plus sacrées sur lesquels elle [ la société ] est fondée .
» p.84.Mais cette suppression des de la séparation des sexes va avoir un effet pervers beaucoup préjudiciable à la vertude l'homme.
En effet, l'opposition féminin/masculin vient s'identifier à l'opposition passion/vertu.
Elle va donc àl'encontre de la vertu et la vertu est justement la force qui contient les passions.
Supprimer cette distinction, c'estdonc soumettre l'Homme à ses passions, dont l'amour fait partie, et donc aux femmes.
Nous pouvons illustrer cetteidée par une citation extraite du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les Hommes de Rousseaudans lequel il écrit : « [L'amour] est célébrée par les femmes avec beaucoup d'habileté et de soin pour établir leurempire et rendre dominant le sexe qui devrait obéir.
».
Donc Rousseau pense que les femmes, puisque par naturepassionnée, sont déraisonnables et pervertissent l'homme en dégradant sa raison et en faisant croître en lui lespassions factices dont l'amour-propre, le rendant donc vicieux et incapable de gérer l'État.
« Tous [les peuples]périssent par le désordre des femmes.
» p.164.
Le rire fondée sur l'amour dans ces comédies modernes est doncparticulièrement vicieux car il délivre chez l'homme des passions factices qui recouvrent la puissance de sa raison.
Dans cette seconde partie, nous analyserons les griefs que portent Diderot contre la comédie classique.Nous commencerons tout d'abord par analyser ce que doit être la finalité du théâtre pour Diderot.
Le but ultime duthéâtre pour Diderot est de réformer les m½urs des méchants.
Il va donc développer une réflexion sur les effetsconcrets utiles à ce but.
Il y a selon Diderot un fond commun vertueux chez tous les Hommes et c'est ce fondvertueux qui servira de porte d'entrée à la réforme morale.
Il s'agira en fait de créer une identification entre unpersonnage représenté et le spectateur.
L'idée est que le méchant se trouve invité à une identification part unepartie positive de lui qui est représentée.
Le spectateur qui va s'identifier au personnage va s'émouvoir des malheursqui vont lui arriver et cette pitié témoignera de la conscience de l'humanité du méchant.
Il s'agira donc de produireun arrachement de la mauvaise partie de soi vers la partie naturelle, bonne.
Ceci explique que ce soit par lessentiments que doit passer cette régénérescence.
Le raisonnement, au contraire, échouera car il ne mobilisera pas.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentez ces lignes de Sylvain Menant (Littérature française, t. VI : De l'Encyclopédie aux Méditations, Arthaud, 1984) : «Tout le monde, de Voltaire à Diderot, cherche à définir un «droit naturel», droit absolu inscrit dans la raison humaine et antérieur, d'un point de vue intellectuel, à l'existence des sociétés. Ce droit naturel doit s'imposer dans tous les régimes politiques. Il protège la liberté des individus et leur fixe des devoirs. Chaque intervention dans les affaires du tem
- On a souvent noté que la comédie de Molière côtoyait le drame. En vous appuyant sur certaines scènes de l'Avare, montrez qu'elles provoquent à la fois le, rire et des réflexions sérieuses chez le spectateur.
- ESSAIS CARACTÉRISTIQUES ET CRITIQUES (résumé)
- ÉTUDES CRITIQUES SUR L’HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE. de Ferdinand Brunetière
- LETTRE SUR LA MUSIQUE FRANÇAISE de Jean Jacques Rousseau