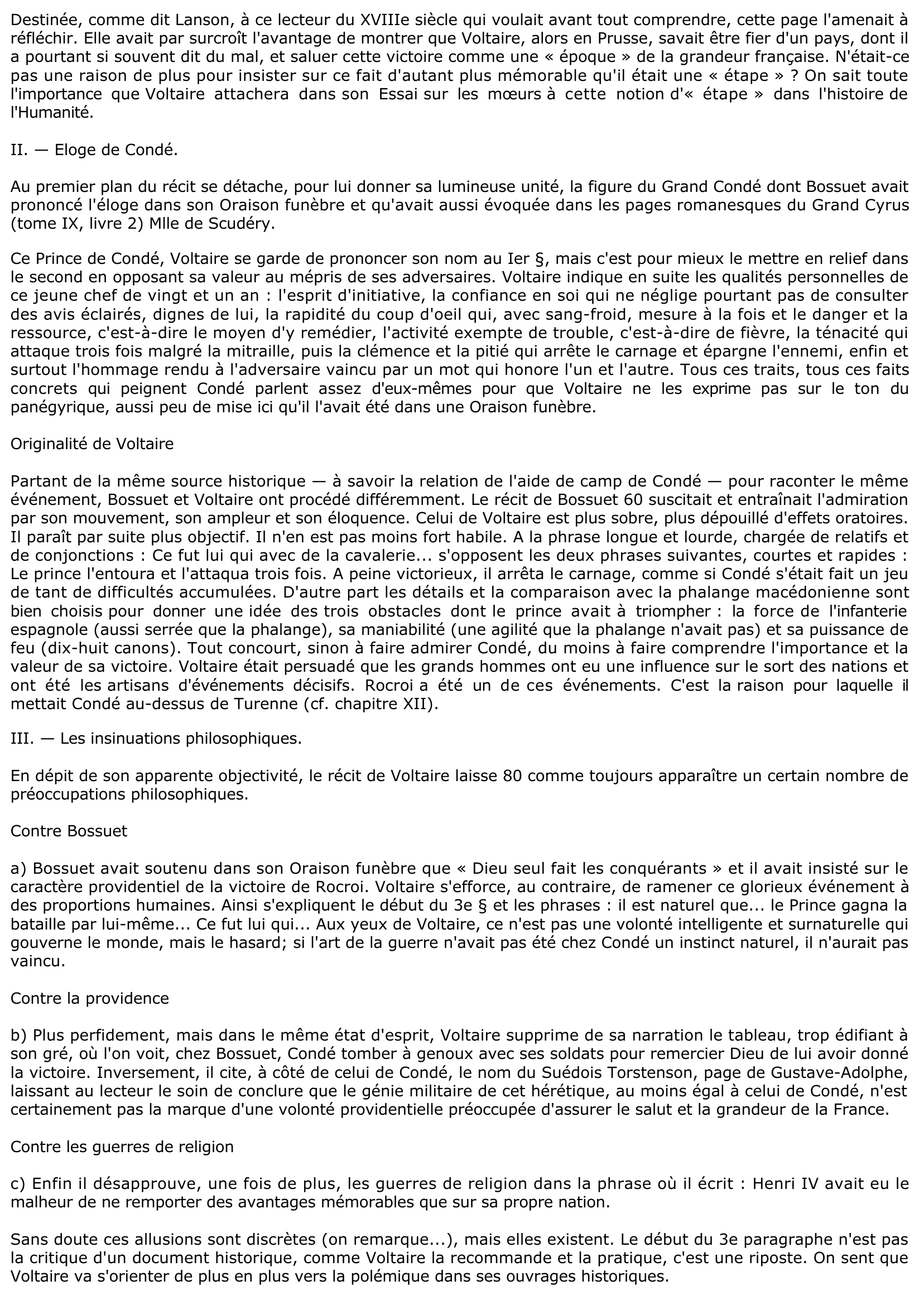Voltaire: Le Siècle de Louis XIV - La Bataille de Rocroi (Chap. 3)
Publié le 01/04/2011
Extrait du document

§ 1 Le fort de la guerre était du côté de la Flandre; les troupes espagnoles sortirent des frontières du Hainaut au nombre de vingt-six mille hommes, sous la conduite d'un vieux général 19 expérimenté, nommé don Francisco de Mello. Ils vinrent ravager les frontières de la Champagne; ils attaquèrent Rocroi, et ils crurent pénétrer bientôt jusqu'aux portes de Paris, comme ils avaient fait huit ans auparavant. La mort de Louis XIII, la faiblesse d'une minorité, relevaient leurs espérances ; et quand ils virent qu'on ne leur opposait qu'une armée inférieure en nombre, commandée par un jeune homme de vingt un 16 ans, leur espérance se changea en sécurité. § 2 Ce jeune homme sans expérience, qu'ils méprisaient, était Louis de Bourbon alors duc d'Enghien, connu depuis sous le nom de grand Condé. La plupart des grands capitaines sont devenus tels par degrés. Ce prince était né général; l'art de la guerre semblait en lui un instinct naturel : il n'y avait en Europe que lui et le Suédois Torstenson qui eussent eu à vingt ans ce génie qui peut se passer de l'expérience. § 3 Le duc d'Enghien avait reçu, avec la nouvelle de la mort de Louis XIII, l'ordre de ne point hasarder la bataille. Le maréchal, qui lui avait été donné pour le conseiller et pour le conduire, secondait par sa circonspection ces ordres timides. Le prince ne crut ni le maréchal ni la cour; il ne confia son dessein, qu'à Gassion, maréchal de camp, digne d'être consulté par lui : ils forcèrent le maréchal à trouver la bataille nécessaire. § 4 (19 mai 1643) On remarque que le prince, ayant tout réglé le soir, veille de la bataille, s'endormit si profondément qu'il fallut le réveiller pour combattre. On conte la même chose d'Alexandre. Il est naturel qu'un jeune homme, épuisé des fatigues que demande l'arrangement d'un si grand jour, tombe ensuite dans un sommeil plein; il l'est aussi qu'un génie fait pour la guerre, agissant sans inquiétude, laisse au corps assez de calme pour dormir. Le prince gagna la bataille par lui-même, par un coup d'œil qui voyait à la fois le danger et la ressource, par son activité exempte de trouble, qui le portait à tous les endroits. Ce fut lui qui, avec de la cavalerie, attaqua cette infanterie espagnole jusque-là invincible, aussi forte, aussi serrée que la phalange ancienne si estimée, et qui s'ouvrait avec une agilité que la phalange n'avait pas, pour laisser partir la décharge de dix-huit canons qu'elle renfermait au milieu d'elle. Le prince l'entoura et l'attaqua trois fois. A peine victorieux, il arrêta le carnage. Les officiers espagnols se jetaient à ses genoux pour trouver auprès de lui un asile contre la fureur du soldat vainqueur. Le duc d'Enghien eut autant de soin de les épargner qu'il en avait pris pour les vaincre. § 6 Le vieux comte de Fuentes, qui commandait cette infanterie espagnole, mourut percé de coups. Condé, en l'apprenant, dit « qu'il voudrait être mort comme lui, s'il n'avait pas vaincu «. § 5 Le respect qu'on avait en Europe pour les armées espagnoles se tourna du côté des armées françaises, qui n'avaient point depuis cent ans gagné de bataille si célèbre; car la sanglante journée de Marignan, disputée plutôt que gagnée par François Ier contre les Suisses, avait été l'ouvrage des bandes noires allemandes autant que des troupes françaises. Les journées de Pavie et de Saint-Quentin étaient encore des époques fatales à la réputation de la France. Henri IV avait eu le malheur de ne remporter des avantages mémorables que sur sa propre nation. Sous Louis XIII, le maréchal de Guébriant avait eu de petits succès, mais toujours balancés par des pertes. Les grandes batailles qui ébranlent les États, et qui restent à jamais dans la mémoire des hommes, n'avaient été livrées en ce temps que par Gustave-Adolphe. Cette journée de Rocroi devint l'époque de la gloire française et de celle de Condé.
COMMENTAIRE : S'attachant de préférence à l'étude des civilisations, Voltaire faisait passer au second plan l'Histoire militaire. Il écrivait à Thiériot le 15 juillet 1735 : Une écluse du canal qui joint les deux mers, un tableau du Poussin, une belle tragédie, une vérité découverte sont des choses mille fois plus précieuses que toutes les relations de campagne. On pourrait donc s'étonner de l'importance qu'il accorde ici à un événement militaire, si on ne découvrait derrière ce récit de bataille, en apparence traditionnel, les véritables raisons qui l'ont inspiré.

«
Destinée, comme dit Lanson, à ce lecteur du XVIIIe siècle qui voulait avant tout comprendre, cette page l'amenait àréfléchir.
Elle avait par surcroît l'avantage de montrer que Voltaire, alors en Prusse, savait être fier d'un pays, dont ila pourtant si souvent dit du mal, et saluer cette victoire comme une « époque » de la grandeur française.
N'était-cepas une raison de plus pour insister sur ce fait d'autant plus mémorable qu'il était une « étape » ? On sait toutel'importance que Voltaire attachera dans son Essai sur les mœurs à cette notion d'« étape » dans l'histoire del'Humanité.
II.
— Eloge de Condé.
Au premier plan du récit se détache, pour lui donner sa lumineuse unité, la figure du Grand Condé dont Bossuet avaitprononcé l'éloge dans son Oraison funèbre et qu'avait aussi évoquée dans les pages romanesques du Grand Cyrus(tome IX, livre 2) Mlle de Scudéry.
Ce Prince de Condé, Voltaire se garde de prononcer son nom au Ier §, mais c'est pour mieux le mettre en relief dansle second en opposant sa valeur au mépris de ses adversaires.
Voltaire indique en suite les qualités personnelles dece jeune chef de vingt et un an : l'esprit d'initiative, la confiance en soi qui ne néglige pourtant pas de consulterdes avis éclairés, dignes de lui, la rapidité du coup d'oeil qui, avec sang-froid, mesure à la fois et le danger et laressource, c'est-à-dire le moyen d'y remédier, l'activité exempte de trouble, c'est-à-dire de fièvre, la ténacité quiattaque trois fois malgré la mitraille, puis la clémence et la pitié qui arrête le carnage et épargne l'ennemi, enfin etsurtout l'hommage rendu à l'adversaire vaincu par un mot qui honore l'un et l'autre.
Tous ces traits, tous ces faitsconcrets qui peignent Condé parlent assez d'eux-mêmes pour que Voltaire ne les exprime pas sur le ton dupanégyrique, aussi peu de mise ici qu'il l'avait été dans une Oraison funèbre.
Originalité de Voltaire
Partant de la même source historique — à savoir la relation de l'aide de camp de Condé — pour raconter le mêmeévénement, Bossuet et Voltaire ont procédé différemment.
Le récit de Bossuet 60 suscitait et entraînait l'admirationpar son mouvement, son ampleur et son éloquence.
Celui de Voltaire est plus sobre, plus dépouillé d'effets oratoires.Il paraît par suite plus objectif.
Il n'en est pas moins fort habile.
A la phrase longue et lourde, chargée de relatifs etde conjonctions : Ce fut lui qui avec de la cavalerie...
s'opposent les deux phrases suivantes, courtes et rapides :Le prince l'entoura et l'attaqua trois fois.
A peine victorieux, il arrêta le carnage, comme si Condé s'était fait un jeude tant de difficultés accumulées.
D'autre part les détails et la comparaison avec la phalange macédonienne sontbien choisis pour donner une idée des trois obstacles dont le prince avait à triompher : la force de l'infanterieespagnole (aussi serrée que la phalange), sa maniabilité (une agilité que la phalange n'avait pas) et sa puissance defeu (dix-huit canons).
Tout concourt, sinon à faire admirer Condé, du moins à faire comprendre l'importance et lavaleur de sa victoire.
Voltaire était persuadé que les grands hommes ont eu une influence sur le sort des nations etont été les artisans d'événements décisifs.
Rocroi a été un de ces événements.
C'est la raison pour laquelle ilmettait Condé au-dessus de Turenne (cf.
chapitre XII).
III.
— Les insinuations philosophiques.
En dépit de son apparente objectivité, le récit de Voltaire laisse 80 comme toujours apparaître un certain nombre depréoccupations philosophiques.
Contre Bossuet
a) Bossuet avait soutenu dans son Oraison funèbre que « Dieu seul fait les conquérants » et il avait insisté sur lecaractère providentiel de la victoire de Rocroi.
Voltaire s'efforce, au contraire, de ramener ce glorieux événement àdes proportions humaines.
Ainsi s'expliquent le début du 3e § et les phrases : il est naturel que...
le Prince gagna labataille par lui-même...
Ce fut lui qui...
Aux yeux de Voltaire, ce n'est pas une volonté intelligente et surnaturelle quigouverne le monde, mais le hasard; si l'art de la guerre n'avait pas été chez Condé un instinct naturel, il n'aurait pasvaincu.
Contre la providence
b) Plus perfidement, mais dans le même état d'esprit, Voltaire supprime de sa narration le tableau, trop édifiant àson gré, où l'on voit, chez Bossuet, Condé tomber à genoux avec ses soldats pour remercier Dieu de lui avoir donnéla victoire.
Inversement, il cite, à côté de celui de Condé, le nom du Suédois Torstenson, page de Gustave-Adolphe,laissant au lecteur le soin de conclure que le génie militaire de cet hérétique, au moins égal à celui de Condé, n'estcertainement pas la marque d'une volonté providentielle préoccupée d'assurer le salut et la grandeur de la France.
Contre les guerres de religion
c) Enfin il désapprouve, une fois de plus, les guerres de religion dans la phrase où il écrit : Henri IV avait eu lemalheur de ne remporter des avantages mémorables que sur sa propre nation.
Sans doute ces allusions sont discrètes (on remarque...), mais elles existent.
Le début du 3e paragraphe n'est pasla critique d'un document historique, comme Voltaire la recommande et la pratique, c'est une riposte.
On sent queVoltaire va s'orienter de plus en plus vers la polémique dans ses ouvrages historiques..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture : SIÈCLE DE LOUIS XIV (Le) de Voltaire
- Siècle de LOUIS XIV (le) de Voltaire (résumé et analyse de l'oeuvre)
- SIÈCLE DE LOUIS XIV (Le). de Voltaire (Résumé et analyse)
- Voltaire écrit dans Le Siècle de Louis XIV : « Molière fut, si on ose le dire, un législateur des bienséances du monde. » Et ailleurs : « Molière a fondé l’école de la vie civile. » Vous expliquerez ces expressions et vous direz si elles vous semblent bien caractériser la morale de Molière.
- Lettre de Voltaire, envoyant de Berlin Le Siècle de Louis XIV au maréchal de Richelieu, et le priant de présenter ce livre à Louis XV.