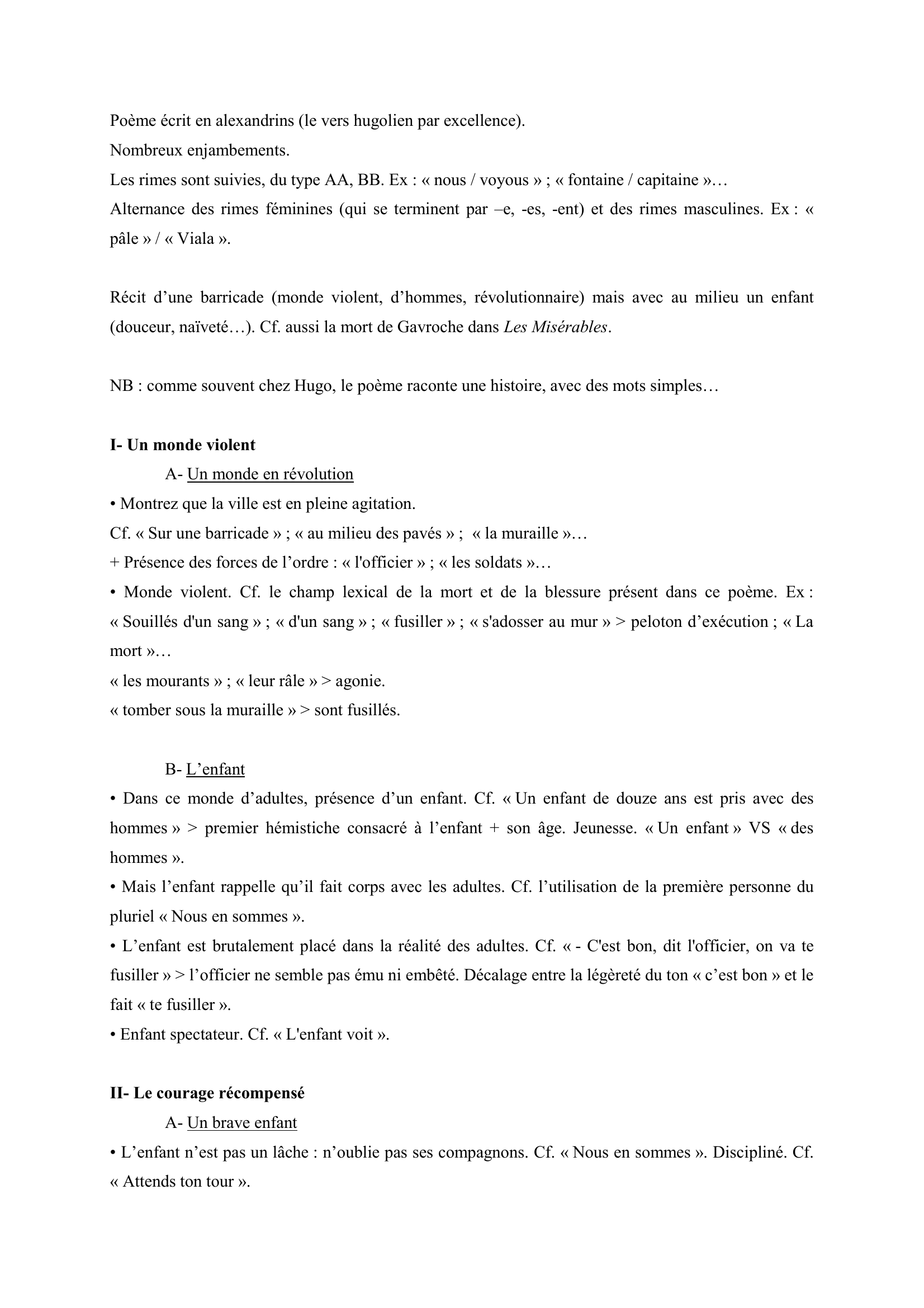Victor Hugo, L'Année terrible, « Sur une barricade, au milieu des pavés ».
Publié le 10/01/2020

Extrait du document
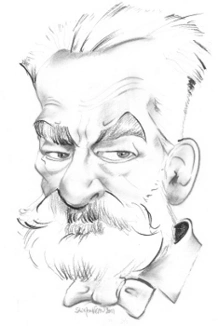
XI
Sur une barricade, au milieu des pavés
Souillés d'un sang coupable et d'un sang pur lavés,
Un enfant de douze ans est pris avec des hommes.
- Es-tu de ceux-là, toi ! - L'enfant dit : Nous en sommes.
- C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller.
Attends ton tour. - L'enfant voit des éclairs briller,
Et tous ses compagnons tomber sous la muraille.
Il dit à l'officier: Permettez-vous que j'aille Rapporter cette montre à ma mère chez nous ?
- Tu veux t'enfuir ? - Je vais revenir. - Ces voyous
Ont peur ! Où loges-tu ? - Là, près de la fontaine.
Et je vais revenir, monsieur le capitaine.
- Va-t'en, drôle ! - L'enfant s'en va. - Piège grossier !
Et les soldats riaient avec leur officier,
Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle
Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle,
Brusquement reparu, fier comme Viala,
Vint s'adosser au mur et leur dit: Me voilà.
La mort stupide eut honte, et l'officier fit grâce.
(commentaire composé de français)
• v. 16-17-18
« Mais » : le décor change
d'atmosphère. Rythme
rendu grave dans cet hémistiche . par la présence des e
suivis de consonnes donc
prononcés:
«Mais le rire cessa 1 \"• =
surprise.
- multiplication des termes
qui traduisent stupéfaction,
véritable effet de coup de
théâtre : \" soudain , \" brusquement\"·
15) ce qui provoque ampleur
de chaque alexandrin.
- Particulièrement· v. 15,
construit comme le précédent ( « et \" répété : stylistique gréco-romaine - vers
épique - rebondissement de
phrase).
Véritable tableau de champ
de bataille.
- Antithèse du \"rire\" (des
attaquants de la barricade)
et du \" râle \" des \" mourants\"
- Décor sombre, en contraste, tout à fait propre à l'épopée cf Racine.Andromaque :
récit du sac de Troie.
- Noter que l'épopée est
traduite auditivement :
rire 11 râle
des termes allitératifs placés
côte à côte, tandis què
voyelles se différencient :
bref, aigu / â long, sourd.
Très spectaculaire.
v. 16-17-18.
\"Car soudain l'enfant
pâle » : pâle place rejetée
volontairement en fin de
vers. De plus cet adj. donne
impression de fragilité chez
enfant qui pourtant revient,
donc opposition qui rend
plus fort son héroïsme.
- << soudain-brusquement \"
= rebondissement qui met
lui aussi le jeune héros en
valeur. '
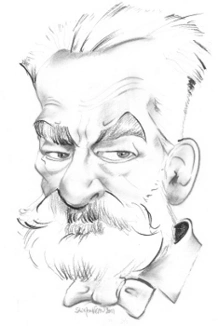
«
Poème écrit en alexandrins (le vers hugolien par excellence).
Nombreux enjambements.
Les rimes sont suivies, du type AA, BB.
Ex : « nous / voyous » ; « fontaine / capitaine »…
Alternance des rimes féminines (qui se terminent par –e, -es, -ent) et des rimes masculines.
Ex : «
pâle » / « Viala ».
Récit d’une barricade (monde violent, d’hommes, révolutionnaire) mais avec au milieu un enfant
(douceur, naïveté…).
Cf.
aussi la mort de Gavroche dans Les Misérables .
NB : comme souvent chez Hugo, le poème raconte une histoire, avec des mots simples…
I- Un monde violent
A- Un monde en révolution
• Montrez que la ville est en pleine agitation.
Cf.
« Sur une barricade » ; « au milieu des pavés » ; « la muraille »…
+ Présence des forces de l’ordre : « l'officier » ; « les soldats »…
• Monde violent.
Cf.
le champ lexical de la mort et de la blessure présent dans ce poème.
Ex :
« Souillés d'un sang » ; « d'un sang » ; « fusiller » ; « s'adosser au mur » > peloton d’exécution ; « La
mort »…
« les mourants » ; « leur râle » > agonie.
« tomber sous la muraille » > sont fusillés.
B- L’enfant
• Dans ce monde d’adultes, présence d’un enfant.
Cf.
« Un enfant de douze ans est pris avec des
hommes » > premier hémistiche consacré à l’enfant + son âge.
Jeunesse.
« Un enfant » VS « des
hommes ».
• Mais l’enfant rappelle qu’il fait corps avec les adultes.
Cf.
l’utilisation de la première personne du
pluriel « Nous en sommes ».
• L’enfant est brutalement placé dans la réalité des adultes.
Cf.
« - C'est bon, dit l'officier, on va te
fusiller » > l’officier ne semble pas ému ni embêté.
Décalage entre la légèreté du ton « c’est bon » et le
fait « te fusiller ».
• Enfant spectateur.
Cf.
« L'enfant voit ».
II- Le courage récompensé
A- Un brave enfant
• L’enfant n’est pas un lâche : n’oublie pas ses compagnons.
Cf.
« Nous en sommes ».
Discipliné.
Cf.
« Attends ton tour »..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor HUGO, L'Année terrible : Sur une barricade, au milieu des pavés
- ANNÉE TERRIBLE (L’). de Victor Hugo
- Commentaire Littéraire : Victor Hugo - Année Terrible
- HUGO (1802-1885) L 'année terrible 1
- Proposition de corrigé du commentaire de V. Hugo, L'Année terrible, Juin 1871 (VII)