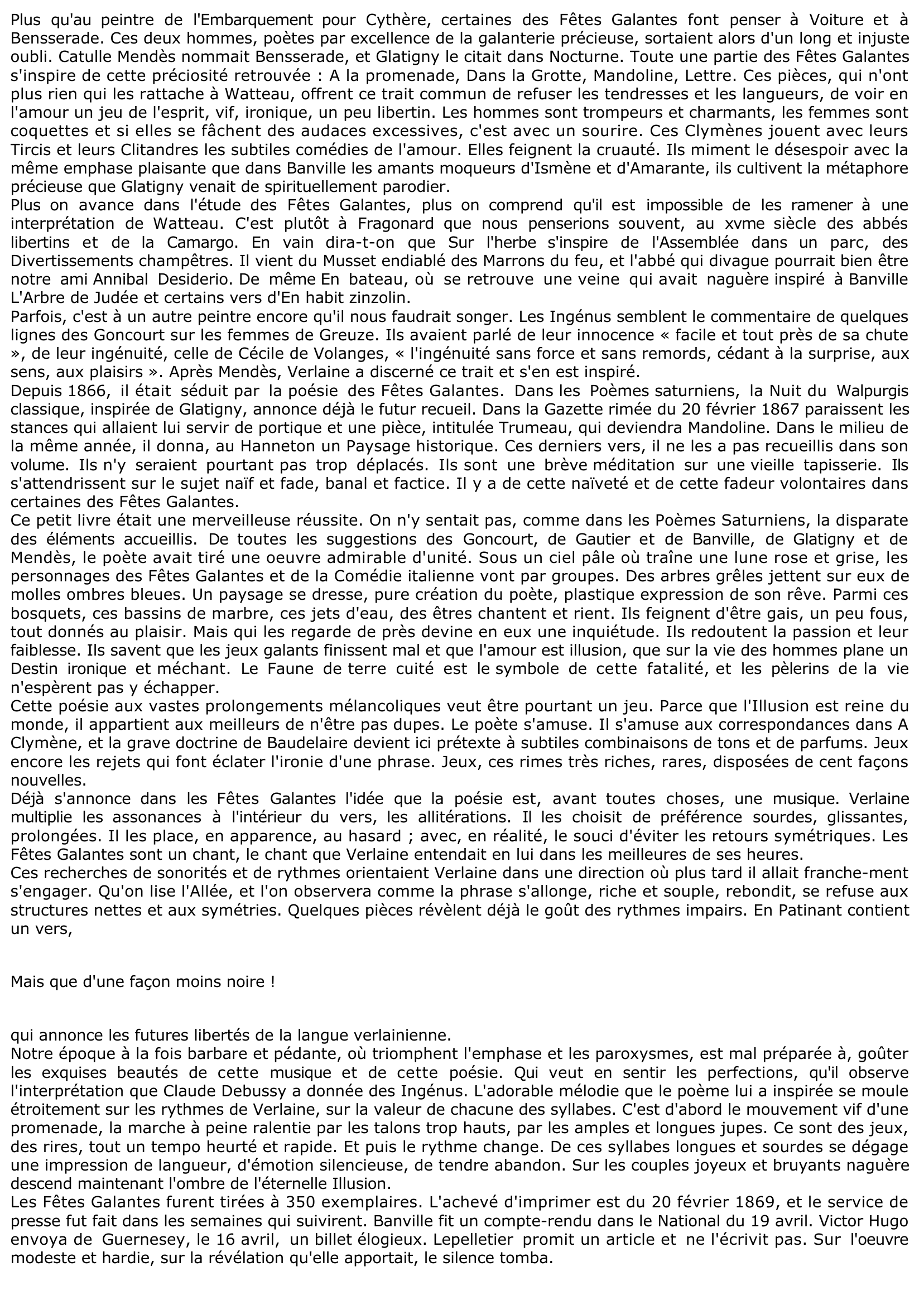VERLAINE : LES FÊTES GALANTES.
Publié le 25/06/2011
Extrait du document
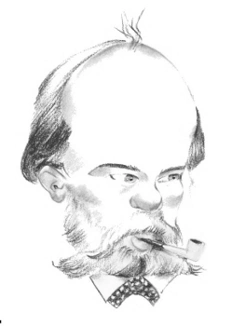
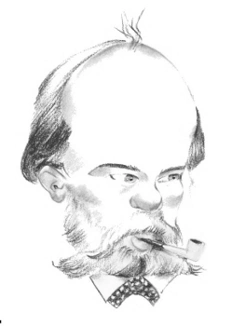
«
Plus qu'au peintre de l'Embarquement pour Cythère, certaines des Fêtes Galantes font penser à Voiture et àBensserade.
Ces deux hommes, poètes par excellence de la galanterie précieuse, sortaient alors d'un long et injusteoubli.
Catulle Mendès nommait Bensserade, et Glatigny le citait dans Nocturne.
Toute une partie des Fêtes Galantess'inspire de cette préciosité retrouvée : A la promenade, Dans la Grotte, Mandoline, Lettre.
Ces pièces, qui n'ontplus rien qui les rattache à Watteau, offrent ce trait commun de refuser les tendresses et les langueurs, de voir enl'amour un jeu de l'esprit, vif, ironique, un peu libertin.
Les hommes sont trompeurs et charmants, les femmes sontcoquettes et si elles se fâchent des audaces excessives, c'est avec un sourire.
Ces Clymènes jouent avec leursTircis et leurs Clitandres les subtiles comédies de l'amour.
Elles feignent la cruauté.
Ils miment le désespoir avec lamême emphase plaisante que dans Banville les amants moqueurs d'Ismène et d'Amarante, ils cultivent la métaphoreprécieuse que Glatigny venait de spirituellement parodier.Plus on avance dans l'étude des Fêtes Galantes, plus on comprend qu'il est impossible de les ramener à uneinterprétation de Watteau.
C'est plutôt à Fragonard que nous penserions souvent, au xvme siècle des abbéslibertins et de la Camargo.
En vain dira-t-on que Sur l'herbe s'inspire de l'Assemblée dans un parc, desDivertissements champêtres.
Il vient du Musset endiablé des Marrons du feu, et l'abbé qui divague pourrait bien êtrenotre ami Annibal Desiderio.
De même En bateau, où se retrouve une veine qui avait naguère inspiré à BanvilleL'Arbre de Judée et certains vers d'En habit zinzolin.Parfois, c'est à un autre peintre encore qu'il nous faudrait songer.
Les Ingénus semblent le commentaire de quelqueslignes des Goncourt sur les femmes de Greuze.
Ils avaient parlé de leur innocence « facile et tout près de sa chute», de leur ingénuité, celle de Cécile de Volanges, « l'ingénuité sans force et sans remords, cédant à la surprise, auxsens, aux plaisirs ».
Après Mendès, Verlaine a discerné ce trait et s'en est inspiré.Depuis 1866, il était séduit par la poésie des Fêtes Galantes.
Dans les Poèmes saturniens, la Nuit du Walpurgisclassique, inspirée de Glatigny, annonce déjà le futur recueil.
Dans la Gazette rimée du 20 février 1867 paraissent lesstances qui allaient lui servir de portique et une pièce, intitulée Trumeau, qui deviendra Mandoline.
Dans le milieu dela même année, il donna, au Hanneton un Paysage historique.
Ces derniers vers, il ne les a pas recueillis dans sonvolume.
Ils n'y seraient pourtant pas trop déplacés.
Ils sont une brève méditation sur une vieille tapisserie.
Ilss'attendrissent sur le sujet naïf et fade, banal et factice.
Il y a de cette naïveté et de cette fadeur volontaires danscertaines des Fêtes Galantes.Ce petit livre était une merveilleuse réussite.
On n'y sentait pas, comme dans les Poèmes Saturniens, la disparatedes éléments accueillis.
De toutes les suggestions des Goncourt, de Gautier et de Banville, de Glatigny et deMendès, le poète avait tiré une oeuvre admirable d'unité.
Sous un ciel pâle où traîne une lune rose et grise, lespersonnages des Fêtes Galantes et de la Comédie italienne vont par groupes.
Des arbres grêles jettent sur eux demolles ombres bleues.
Un paysage se dresse, pure création du poète, plastique expression de son rêve.
Parmi cesbosquets, ces bassins de marbre, ces jets d'eau, des êtres chantent et rient.
Ils feignent d'être gais, un peu fous,tout donnés au plaisir.
Mais qui les regarde de près devine en eux une inquiétude.
Ils redoutent la passion et leurfaiblesse.
Ils savent que les jeux galants finissent mal et que l'amour est illusion, que sur la vie des hommes plane unDestin ironique et méchant.
Le Faune de terre cuité est le symbole de cette fatalité, et les pèlerins de la vien'espèrent pas y échapper.Cette poésie aux vastes prolongements mélancoliques veut être pourtant un jeu.
Parce que l'Illusion est reine dumonde, il appartient aux meilleurs de n'être pas dupes.
Le poète s'amuse.
Il s'amuse aux correspondances dans AClymène, et la grave doctrine de Baudelaire devient ici prétexte à subtiles combinaisons de tons et de parfums.
Jeuxencore les rejets qui font éclater l'ironie d'une phrase.
Jeux, ces rimes très riches, rares, disposées de cent façonsnouvelles.Déjà s'annonce dans les Fêtes Galantes l'idée que la poésie est, avant toutes choses, une musique.
Verlainemultiplie les assonances à l'intérieur du vers, les allitérations.
Il les choisit de préférence sourdes, glissantes,prolongées.
Il les place, en apparence, au hasard ; avec, en réalité, le souci d'éviter les retours symétriques.
LesFêtes Galantes sont un chant, le chant que Verlaine entendait en lui dans les meilleures de ses heures.Ces recherches de sonorités et de rythmes orientaient Verlaine dans une direction où plus tard il allait franche-ments'engager.
Qu'on lise l'Allée, et l'on observera comme la phrase s'allonge, riche et souple, rebondit, se refuse auxstructures nettes et aux symétries.
Quelques pièces révèlent déjà le goût des rythmes impairs.
En Patinant contientun vers,
Mais que d'une façon moins noire !
qui annonce les futures libertés de la langue verlainienne.Notre époque à la fois barbare et pédante, où triomphent l'emphase et les paroxysmes, est mal préparée à, goûterles exquises beautés de cette musique et de cette poésie.
Qui veut en sentir les perfections, qu'il observel'interprétation que Claude Debussy a donnée des Ingénus.
L'adorable mélodie que le poème lui a inspirée se mouleétroitement sur les rythmes de Verlaine, sur la valeur de chacune des syllabes.
C'est d'abord le mouvement vif d'unepromenade, la marche à peine ralentie par les talons trop hauts, par les amples et longues jupes.
Ce sont des jeux,des rires, tout un tempo heurté et rapide.
Et puis le rythme change.
De ces syllabes longues et sourdes se dégageune impression de langueur, d'émotion silencieuse, de tendre abandon.
Sur les couples joyeux et bruyants naguèredescend maintenant l'ombre de l'éternelle Illusion.Les Fêtes Galantes furent tirées à 350 exemplaires.
L'achevé d'imprimer est du 20 février 1869, et le service depresse fut fait dans les semaines qui suivirent.
Banville fit un compte-rendu dans le National du 19 avril.
Victor Hugoenvoya de Guernesey, le 16 avril, un billet élogieux.
Lepelletier promit un article et ne l'écrivit pas.
Sur l'oeuvremodeste et hardie, sur la révélation qu'elle apportait, le silence tomba..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fêtes galantes de Verlaine
- FÊTES GALANTES. de Paul-Marie Verlaine (résumé)
- FÊTES GALANTES de Verlaine
- Les Fêtes galantes de Verlaine (résumé & analyse)
- Fêtes galantes [Paul Verlaine] - Fiche de lecture.