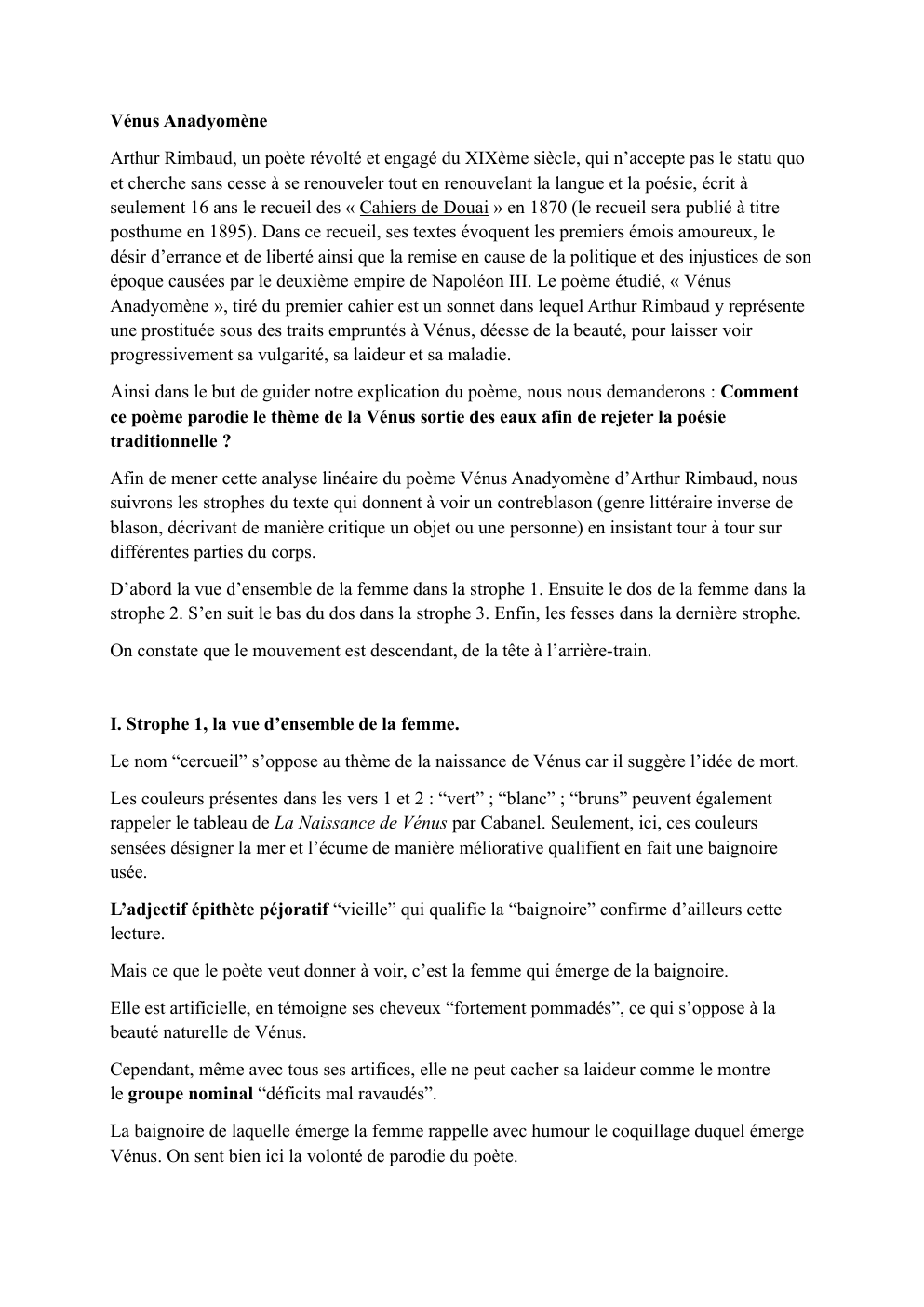Vénus Anadyomène: analyse linéaire - Rimbaud
Publié le 18/04/2025
Extrait du document
«
Vénus Anadyomène
Arthur Rimbaud, un poète révolté et engagé du XIXème siècle, qui n’accepte pas le statu quo
et cherche sans cesse à se renouveler tout en renouvelant la langue et la poésie, écrit à
seulement 16 ans le recueil des « Cahiers de Douai » en 1870 (le recueil sera publié à titre
posthume en 1895).
Dans ce recueil, ses textes évoquent les premiers émois amoureux, le
désir d’errance et de liberté ainsi que la remise en cause de la politique et des injustices de son
époque causées par le deuxième empire de Napoléon III.
Le poème étudié, « Vénus
Anadyomène », tiré du premier cahier est un sonnet dans lequel Arthur Rimbaud y représente
une prostituée sous des traits empruntés à Vénus, déesse de la beauté, pour laisser voir
progressivement sa vulgarité, sa laideur et sa maladie.
Ainsi dans le but de guider notre explication du poème, nous nous demanderons : Comment
ce poème parodie le thème de la Vénus sortie des eaux afin de rejeter la poésie
traditionnelle ?
Afin de mener cette analyse linéaire du poème Vénus Anadyomène d’Arthur Rimbaud, nous
suivrons les strophes du texte qui donnent à voir un contreblason (genre littéraire inverse de
blason, décrivant de manière critique un objet ou une personne) en insistant tour à tour sur
différentes parties du corps.
D’abord la vue d’ensemble de la femme dans la strophe 1.
Ensuite le dos de la femme dans la
strophe 2.
S’en suit le bas du dos dans la strophe 3.
Enfin, les fesses dans la dernière strophe.
On constate que le mouvement est descendant, de la tête à l’arrière-train.
I.
Strophe 1, la vue d’ensemble de la femme.
Le nom “cercueil” s’oppose au thème de la naissance de Vénus car il suggère l’idée de mort.
Les couleurs présentes dans les vers 1 et 2 : “vert” ; “blanc” ; “bruns” peuvent également
rappeler le tableau de La Naissance de Vénus par Cabanel.
Seulement, ici, ces couleurs
sensées désigner la mer et l’écume de manière méliorative qualifient en fait une baignoire
usée.
L’adjectif épithète péjoratif “vieille” qui qualifie la “baignoire” confirme d’ailleurs cette
lecture.
Mais ce que le poète veut donner à voir, c’est la femme qui émerge de la baignoire.
Elle est artificielle, en témoigne ses cheveux “fortement pommadés”, ce qui s’oppose à la
beauté naturelle de Vénus.
Cependant, même avec tous ses artifices, elle ne peut cacher sa laideur comme le montre
le groupe nominal “déficits mal ravaudés”.
La baignoire de laquelle émerge la femme rappelle avec humour le coquillage duquel émerge
Vénus.
On sent bien ici la volonté de parodie du poète.
Au niveau du rythme, les enjambements entre les vers 1-2 et 2-3 créent un déséquilibre et
une disharmonie à l’image de la femme présentée ici.
De plus, les deux adjectifs “lente et bête” insistent sur l’idée que la femme est malade.
Elle
est presque animalisée par le mot “bête” et son mouvement n’a rien de gracieux.
II.
Strophe 2, le dos de la femme.
La seconde strophe commence par un adverbe de liaison : “puis”.
Cet adverbe, repris au vers
7, montre une volonté d’exagération du poète dans la précision avec laquelle il décrit la
femme.
L’animalisation se poursuit car Rimbaud évoque, non pas le cou, mais le “col” de la femme.
On assiste à une sorte de transformation en vache : “col gras et gris” ; “larges omoplates / qui
saillent”.
De plus, le poète cherche à donner un sentiment désagréable au lecteur, notamment par
l’usage de l’allitération en -g (“gras et gris”) qui émet un son disgracieux.
Le mouvement de la femme est répétitif et évoque celui d’un animal en mouvement avec
le parallélisme “le dos court qui rentre et qui ressort”.
La maigreur suggérée par la proposition subordonnée relative “qui saillent” rejetée en début
de vers 6 participe au portrait horrible d’une femme laide et malade.
Pourtant, la maigreur est contredite par “les rondeurs des reins” au vers 7.
On voit donc que le
physique de la femme est tout sauf harmonieux.
Il s’oppose parfaitement à la perfection
habituelle de Vénus.
On note ici une nouvelle allitération en -r (vers 7 et 8) qui continue d’émettre des sons
désagréables, proches d’un râle.
La graisse n’est pas non plus la belle graisse de la Vénus traditionnelle.
Au contraire, elle
“parait en feuilles plates”, ce qui signifie qu’elle ne participe pas à lui octroyer de
chaleureuses rondeurs.
III.
Strophe 3, le bas du dos.
Le premier tercet apporte une nouvelle couleur au tableau d’ensemble : le rouge.
Cette couleur vient s’opposer à la blancheur pure avec laquelle est fréquemment représentée
Vénus.
Ici, “L’échine est un peu rouge” suggère une fois de plus que la colonne est saillante,
et donc que la maigreur de la femme décrite est maladive.
Dans cette strophe, le poète mobilise plusieurs sens du lecteur pour mieux montrer l’horreur
de la femme décrite.
On trouve l’odorat avec....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture Analytique 2 : Vénus anadyomène : Arthur Rimbaud
- Rimbaud – « Vénus Anadyomène », Les cahiers de Douai, 1919
- Commentaire du poème : Vénus Anadyomène De Arthur Rimbaud.
- Explication linéaire A la Musique Arthur Rimbaud, Poésies, 1870-1871
- analyse linéaire Les caractères Giton et Phédon