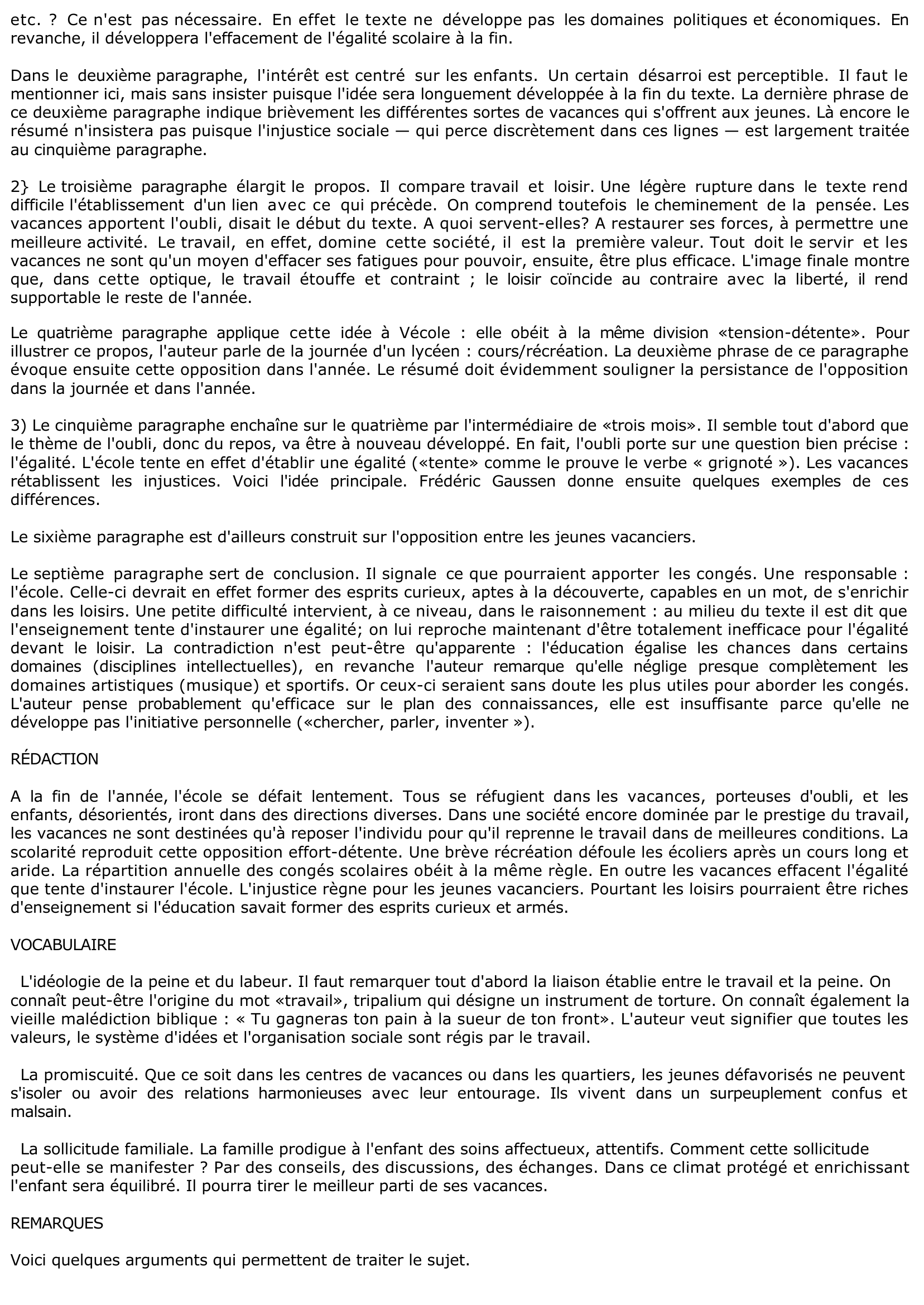Vacances. Frédéric Gaussen, Le Monde de l'Education
Publié le 24/02/2011
Extrait du document
Comme chaque année, l'approche des vacances se vit comme une lente débandade. L'heure de la sortie, c'est en fait, les derniers conseils de classe qui la sonnent. Passera, passera pas dans la classe supérieure? Ce problème résolu, la classe se délite (1). Le ciment de la sanction finale n'étant plus là, du coup la vie scolaire perd sa fragile signification. Elèves et enseignants se trouvent aspirés par l'apesanteur des vacances. Ces vacances qui absorbent les crises et les révolutions, annulent le temps. Vacances-torpeur. Vacances-oubli. Pour les enfants, elles commencent par le tournoiement un peu déboussolé dans l'appartement vide ou la rue. Par l'ennui déjà. Après, viendront la transhumance familiale, la «colo« ou — pour les plus chanceux — le voyage... Une société met longtemps à digérer ses conquêtes. La nôtre ne s'est pas encore habituée au droit aux vacances qu'elle s'est concédé. L'idéologie de la peine et du labeur pèse sur elle si fortement que le loisir ne va pas sans mauvaise conscience. Il faut d'abord «récupérer« (sa force de travail), retrouver la «forme« (avant de prendre le «collier«). Il faut vivre à pleins poumons pour supporter l'asphyxie progressive des onze mois d'activité sérieuse. Cette dichotomie (2) de la tension et de la détente, la société l'a imposée aux enfants de façon quasiment forcenée. Les écoliers français sont ceux qui ont dans l'année le moins d'heures de cours et le plus de choses à apprendre. Le plus de matières intellectuelles et le moins de sports et de musique. Leur vie est une alternance minutieusement réglée d'immobilité et de déchaînement. Une heure pour écouter le maître, cinq minutes pour hurler dans la cour. Neuf mois de classe, trois mois d'oisiveté forcée. Trois mois pour oublier, pour permettre aux inégalités de regagner le terrain grignoté en classe. Pour les enfants, les vacances sont l'expression la plus sournoise de l'injustice sociale. Notre société égalitaire peut dormir sur ses deux oreilles. Les vacances sont là pour rétablir les différences. Pendant les vacances chacun retrouve ses quartiers et son milieu. Elles remettent chacun à sa place. Aux uns les livres, la culture, les voyages à l'étranger, la sollicitude familiale, la richesse de la conversation, les jeux qui ouvrent l'esprit. Aux autres, la promiscuité, la rue, le silence des adultes, l'entourage absent, la télévision, la bousculade. Les vacances peuvent être le temps de la découverte, du contact, de la création, de l'imprévu. Encore faut-il avoir appris quelque part à chercher, à parler, à inventer. Lorsque la famille ne peut le faire, c'est à l'école de s'en acquitter. Tant que celle-ci n'aura pas fait de ces objectifs les principes de son action, les individus resteront démunis devant la vacuité des loisirs. Frédéric Gaussen, Le Monde de l'Education, Juillet 1975. (1) se désagrège. (2) division. QUESTIONS 1) Résumez ce texte en une douzaine de lignes. 2) Expliquez : — « l'idéologie de la peine et du labeur> ; — « la promiscuité«; — « la sollicitude familiale « 3) Pensez-vous, comme l'auteur, que les vacances soulignent les inégalités sociales tandis que la vie scolaire les atténue? (Développement composé de 30 à 50 lignes.)
«
etc.
? Ce n'est pas nécessaire.
En effet le texte ne développe pas les domaines politiques et économiques.
Enrevanche, il développera l'effacement de l'égalité scolaire à la fin.
Dans le deuxième paragraphe, l'intérêt est centré sur les enfants.
Un certain désarroi est perceptible.
Il faut lementionner ici, mais sans insister puisque l'idée sera longuement développée à la fin du texte.
La dernière phrase dece deuxième paragraphe indique brièvement les différentes sortes de vacances qui s'offrent aux jeunes.
Là encore lerésumé n'insistera pas puisque l'injustice sociale — qui perce discrètement dans ces lignes — est largement traitéeau cinquième paragraphe.
2} Le troisième paragraphe élargit le propos.
Il compare travail et loisir.
Une légère rupture dans le texte renddifficile l'établissement d'un lien avec ce qui précède.
On comprend toutefois le cheminement de la pensée.
Lesvacances apportent l'oubli, disait le début du texte.
A quoi servent-elles? A restaurer ses forces, à permettre unemeilleure activité.
Le travail, en effet, domine cette société, il est la première valeur.
Tout doit le servir et lesvacances ne sont qu'un moyen d'effacer ses fatigues pour pouvoir, ensuite, être plus efficace.
L'image finale montreque, dans cette optique, le travail étouffe et contraint ; le loisir coïncide au contraire avec la liberté, il rendsupportable le reste de l'année.
Le quatrième paragraphe applique cette idée à Vécole : elle obéit à la même division «tension-détente».
Pourillustrer ce propos, l'auteur parle de la journée d'un lycéen : cours/récréation.
La deuxième phrase de ce paragrapheévoque ensuite cette opposition dans l'année.
Le résumé doit évidemment souligner la persistance de l'oppositiondans la journée et dans l'année.
3) Le cinquième paragraphe enchaîne sur le quatrième par l'intermédiaire de «trois mois».
Il semble tout d'abord quele thème de l'oubli, donc du repos, va être à nouveau développé.
En fait, l'oubli porte sur une question bien précise :l'égalité.
L'école tente en effet d'établir une égalité («tente» comme le prouve le verbe « grignoté »).
Les vacancesrétablissent les injustices.
Voici l'idée principale.
Frédéric Gaussen donne ensuite quelques exemples de cesdifférences.
Le sixième paragraphe est d'ailleurs construit sur l'opposition entre les jeunes vacanciers.
Le septième paragraphe sert de conclusion.
Il signale ce que pourraient apporter les congés.
Une responsable :l'école.
Celle-ci devrait en effet former des esprits curieux, aptes à la découverte, capables en un mot, de s'enrichirdans les loisirs.
Une petite difficulté intervient, à ce niveau, dans le raisonnement : au milieu du texte il est dit quel'enseignement tente d'instaurer une égalité; on lui reproche maintenant d'être totalement inefficace pour l'égalitédevant le loisir.
La contradiction n'est peut-être qu'apparente : l'éducation égalise les chances dans certainsdomaines (disciplines intellectuelles), en revanche l'auteur remarque qu'elle néglige presque complètement lesdomaines artistiques (musique) et sportifs.
Or ceux-ci seraient sans doute les plus utiles pour aborder les congés.L'auteur pense probablement qu'efficace sur le plan des connaissances, elle est insuffisante parce qu'elle nedéveloppe pas l'initiative personnelle («chercher, parler, inventer »).
RÉDACTION
A la fin de l'année, l'école se défait lentement.
Tous se réfugient dans les vacances, porteuses d'oubli, et lesenfants, désorientés, iront dans des directions diverses.
Dans une société encore dominée par le prestige du travail,les vacances ne sont destinées qu'à reposer l'individu pour qu'il reprenne le travail dans de meilleures conditions.
Lascolarité reproduit cette opposition effort-détente.
Une brève récréation défoule les écoliers après un cours long etaride.
La répartition annuelle des congés scolaires obéit à la même règle.
En outre les vacances effacent l'égalitéque tente d'instaurer l'école.
L'injustice règne pour les jeunes vacanciers.
Pourtant les loisirs pourraient être richesd'enseignement si l'éducation savait former des esprits curieux et armés.
VOCABULAIRE
L'idéologie de la peine et du labeur.
Il faut remarquer tout d'abord la liaison établie entre le travail et la peine.
Onconnaît peut-être l'origine du mot «travail», tripalium qui désigne un instrument de torture.
On connaît également lavieille malédiction biblique : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front».
L'auteur veut signifier que toutes lesvaleurs, le système d'idées et l'organisation sociale sont régis par le travail.
La promiscuité.
Que ce soit dans les centres de vacances ou dans les quartiers, les jeunes défavorisés ne peuvents'isoler ou avoir des relations harmonieuses avec leur entourage.
Ils vivent dans un surpeuplement confus etmalsain.
La sollicitude familiale.
La famille prodigue à l'enfant des soins affectueux, attentifs.
Comment cette sollicitudepeut-elle se manifester ? Par des conseils, des discussions, des échanges.
Dans ce climat protégé et enrichissantl'enfant sera équilibré.
Il pourra tirer le meilleur parti de ses vacances.
REMARQUES
Voici quelques arguments qui permettent de traiter le sujet..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Frédéric GAUSSEN. Vacances. (Le Monde de l'éducation)
- Frédéric Gaussen, Le monde
- Frédéric Gaussen, Le monde dimanche
- Frédéric Gaussen, Le Monde
- Frédéric Gaussen, Le Monde Dimanche, 14 février 1982 (Littérature)