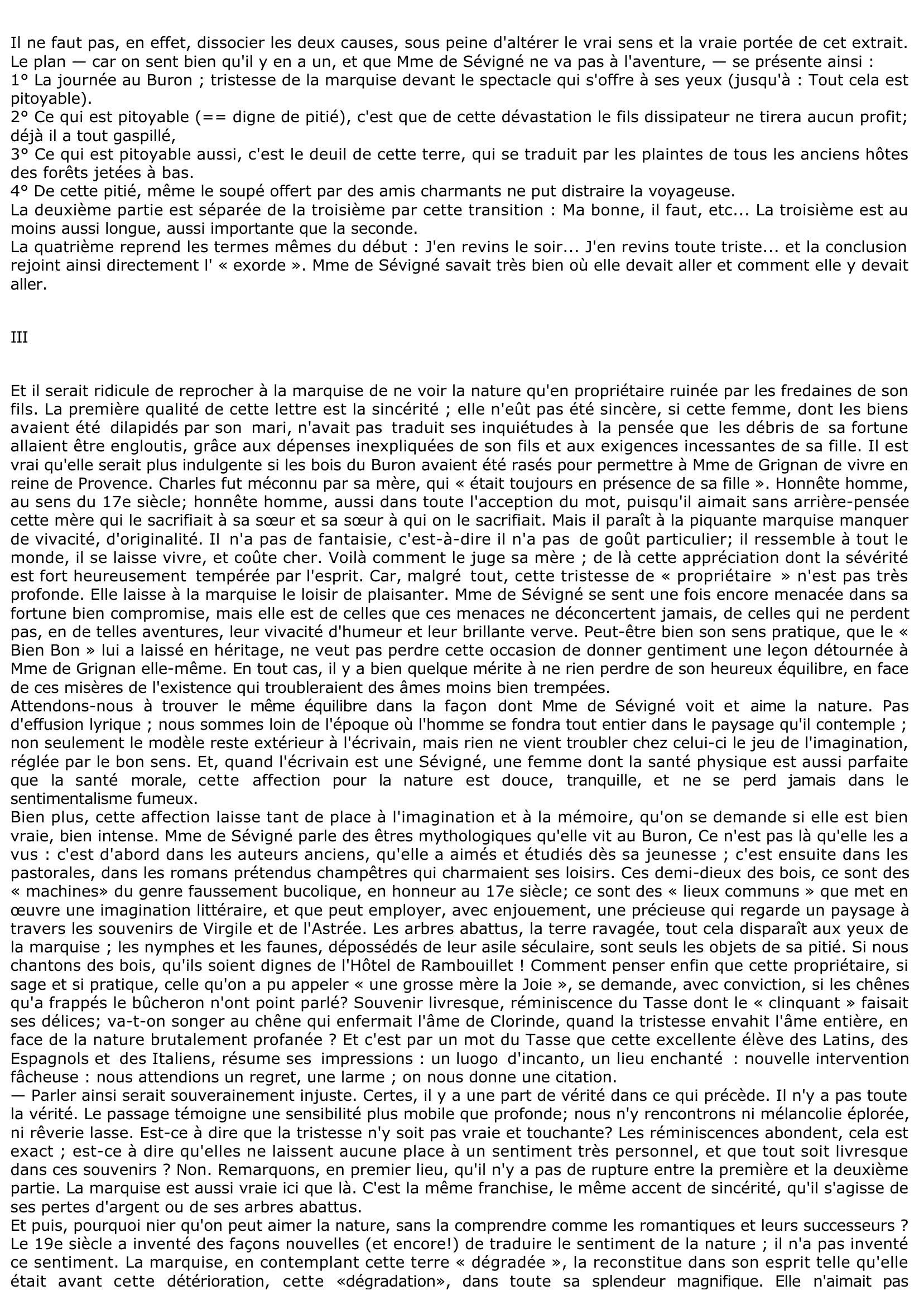UNE LETTRE DE Mme DE SÉVIGNÉ. Le Buron.
Publié le 03/07/2011
Extrait du document
Je fus hier au Buron, j'en revins le soir; je pensai pleurer en voyant la dégradation de cette terre : il y avait les plus vieux bois du monde ; mon fils, dans son dernier voyage, lui a donné les derniers coups de cognée. Il a encore voulu vendre un petit bouquet qui faisait une assez grande beauté; tout cela est pitoyable : il en a rapporté quatre cents pistoles, dont il n'eut pas un sou un mois après. Il est impossible de comprendre ce qu'il fait, ni ce que son voyage de Bretagne lui a coûté, où il était comme un gueux, car il avait renvoyé ses laquais et son cocher à Paris ; il n'avait que le seul Larmechin dans cette ville, où il fut deux mois. Il trouve l'invention de dépenser sans paraître, de perdre sans jouer, et de payer sans s'acquitter ; toujours une soif et un besoin d'argent,, en paix comme en guerre; c'est un abîme de je ne sais pas quoi, car il n'a aucune fantaisie, mais sa main est un creuset qui fond l'argent. Ma bonne, il faut que vous essuyiez tout ceci. Toutes ces dryades affligées que je vis hier, tous ces vieux sylvains qui ne savent plus où se retirer, tous ces anciens corbeaux établis depuis deux cents ans dans l'horreur de ces bois, ces chouettes qui, dans cette obscurité, annonçaient, par leurs funestes cris, les malheurs de tous les hommes ; tout cela me fit hier des plaintes qui me touchèrent sensiblement le cœur; et que sait-on même si plusieurs de ces vieux chênes n'ont point parlé, comme celui où était Clorinde ? Ce lieu était un luogo d'incanto, s'il en fut jamais : j'en revins toute triste; le soupé que me donna le premier président et sa femme ne fut point capable de me réjouir. (Mme DE SÉVIGNÉ, Lettres : A Mme de Grignan, à Nantes, lundi au soir, 27 mai 1680).
MATIÈRE. — 1° Vous analyserez les sentiments exprimés par MmE de Sévigné dans ce fragment de lettre, et, en particulier, son sentiment de la nature. 2° Vous vous efforcerez de dégager de votre étude les principaux mérites du style de Mme de Sévigné.
Conseils pratiques. Je ne crois pas que le travail de localisation soit inutile. Au contraire. Il est clair qu'on ne saurait exiger de vous que vous replaciez de mémoire le fragment dans la lettre du 27 mai ; ce serait pourtant un excellent moyen d'en préciser la valeur exacte. Toujours est-il que vous ne pourriez vous dispenser de la situer brièvement dans l'histoire de Mme de Sévigné. Comment d'ailleurs, sans ce travail, comprendre «les sentiments exprimés « par la marquise ? Il serait trop commode de ne voir ici que son goût pour la nature (« et, en particulier «, vous dit la matière). Sans doute, ce sera là le sentiment général du morceau, mais il y en a bien d'autres : tristesse de la propriétaire rurale qui voit ses bois abattus, de la femme pratique qui souffre de ces gaspillages, de la mère qui voudrait bien gronder son fils prodigue, et qui, à défaut, trace de lui un portrait qui n'est peut-être pas très flatteur, tout cela se mêle dans son âme au moment où elle écrit, et se traduit dans cette lettre, confidence sincère et sans apprêt. Mais rien ne trouble l'heureux équilibre de la marquise, dont Bussy-Rabutin déclarait non sans méchanceté : « Toute sa chaleur était à l'esprit «.
«
Il ne faut pas, en effet, dissocier les deux causes, sous peine d'altérer le vrai sens et la vraie portée de cet extrait.Le plan — car on sent bien qu'il y en a un, et que Mme de Sévigné ne va pas à l'aventure, — se présente ainsi :1° La journée au Buron ; tristesse de la marquise devant le spectacle qui s'offre à ses yeux (jusqu'à : Tout cela estpitoyable).2° Ce qui est pitoyable (== digne de pitié), c'est que de cette dévastation le fils dissipateur ne tirera aucun profit;déjà il a tout gaspillé,3° Ce qui est pitoyable aussi, c'est le deuil de cette terre, qui se traduit par les plaintes de tous les anciens hôtesdes forêts jetées à bas.4° De cette pitié, même le soupé offert par des amis charmants ne put distraire la voyageuse.La deuxième partie est séparée de la troisième par cette transition : Ma bonne, il faut, etc...
La troisième est aumoins aussi longue, aussi importante que la seconde.La quatrième reprend les termes mêmes du début : J'en revins le soir...
J'en revins toute triste...
et la conclusionrejoint ainsi directement l' « exorde ».
Mme de Sévigné savait très bien où elle devait aller et comment elle y devaitaller.
III
Et il serait ridicule de reprocher à la marquise de ne voir la nature qu'en propriétaire ruinée par les fredaines de sonfils.
La première qualité de cette lettre est la sincérité ; elle n'eût pas été sincère, si cette femme, dont les biensavaient été dilapidés par son mari, n'avait pas traduit ses inquiétudes à la pensée que les débris de sa fortuneallaient être engloutis, grâce aux dépenses inexpliquées de son fils et aux exigences incessantes de sa fille.
Il estvrai qu'elle serait plus indulgente si les bois du Buron avaient été rasés pour permettre à Mme de Grignan de vivre enreine de Provence.
Charles fut méconnu par sa mère, qui « était toujours en présence de sa fille ».
Honnête homme,au sens du 17e siècle; honnête homme, aussi dans toute l'acception du mot, puisqu'il aimait sans arrière-penséecette mère qui le sacrifiait à sa sœur et sa sœur à qui on le sacrifiait.
Mais il paraît à la piquante marquise manquerde vivacité, d'originalité.
Il n'a pas de fantaisie, c'est-à-dire il n'a pas de goût particulier; il ressemble à tout lemonde, il se laisse vivre, et coûte cher.
Voilà comment le juge sa mère ; de là cette appréciation dont la sévéritéest fort heureusement tempérée par l'esprit.
Car, malgré tout, cette tristesse de « propriétaire » n'est pas trèsprofonde.
Elle laisse à la marquise le loisir de plaisanter.
Mme de Sévigné se sent une fois encore menacée dans safortune bien compromise, mais elle est de celles que ces menaces ne déconcertent jamais, de celles qui ne perdentpas, en de telles aventures, leur vivacité d'humeur et leur brillante verve.
Peut-être bien son sens pratique, que le «Bien Bon » lui a laissé en héritage, ne veut pas perdre cette occasion de donner gentiment une leçon détournée àMme de Grignan elle-même.
En tout cas, il y a bien quelque mérite à ne rien perdre de son heureux équilibre, en facede ces misères de l'existence qui troubleraient des âmes moins bien trempées.Attendons-nous à trouver le même équilibre dans la façon dont Mme de Sévigné voit et aime la nature.
Pasd'effusion lyrique ; nous sommes loin de l'époque où l'homme se fondra tout entier dans le paysage qu'il contemple ;non seulement le modèle reste extérieur à l'écrivain, mais rien ne vient troubler chez celui-ci le jeu de l'imagination,réglée par le bon sens.
Et, quand l'écrivain est une Sévigné, une femme dont la santé physique est aussi parfaiteque la santé morale, cette affection pour la nature est douce, tranquille, et ne se perd jamais dans lesentimentalisme fumeux.Bien plus, cette affection laisse tant de place à l'imagination et à la mémoire, qu'on se demande si elle est bienvraie, bien intense.
Mme de Sévigné parle des êtres mythologiques qu'elle vit au Buron, Ce n'est pas là qu'elle les avus : c'est d'abord dans les auteurs anciens, qu'elle a aimés et étudiés dès sa jeunesse ; c'est ensuite dans lespastorales, dans les romans prétendus champêtres qui charmaient ses loisirs.
Ces demi-dieux des bois, ce sont des« machines» du genre faussement bucolique, en honneur au 17e siècle; ce sont des « lieux communs » que met enœuvre une imagination littéraire, et que peut employer, avec enjouement, une précieuse qui regarde un paysage àtravers les souvenirs de Virgile et de l'Astrée.
Les arbres abattus, la terre ravagée, tout cela disparaît aux yeux dela marquise ; les nymphes et les faunes, dépossédés de leur asile séculaire, sont seuls les objets de sa pitié.
Si nouschantons des bois, qu'ils soient dignes de l'Hôtel de Rambouillet ! Comment penser enfin que cette propriétaire, sisage et si pratique, celle qu'on a pu appeler « une grosse mère la Joie », se demande, avec conviction, si les chênesqu'a frappés le bûcheron n'ont point parlé? Souvenir livresque, réminiscence du Tasse dont le « clinquant » faisaitses délices; va-t-on songer au chêne qui enfermait l'âme de Clorinde, quand la tristesse envahit l'âme entière, enface de la nature brutalement profanée ? Et c'est par un mot du Tasse que cette excellente élève des Latins, desEspagnols et des Italiens, résume ses impressions : un luogo d'incanto, un lieu enchanté : nouvelle interventionfâcheuse : nous attendions un regret, une larme ; on nous donne une citation.— Parler ainsi serait souverainement injuste.
Certes, il y a une part de vérité dans ce qui précède.
Il n'y a pas toutela vérité.
Le passage témoigne une sensibilité plus mobile que profonde; nous n'y rencontrons ni mélancolie éplorée,ni rêverie lasse.
Est-ce à dire que la tristesse n'y soit pas vraie et touchante? Les réminiscences abondent, cela estexact ; est-ce à dire qu'elles ne laissent aucune place à un sentiment très personnel, et que tout soit livresquedans ces souvenirs ? Non.
Remarquons, en premier lieu, qu'il n'y a pas de rupture entre la première et la deuxièmepartie.
La marquise est aussi vraie ici que là.
C'est la même franchise, le même accent de sincérité, qu'il s'agisse deses pertes d'argent ou de ses arbres abattus.Et puis, pourquoi nier qu'on peut aimer la nature, sans la comprendre comme les romantiques et leurs successeurs ?Le 19e siècle a inventé des façons nouvelles (et encore!) de traduire le sentiment de la nature ; il n'a pas inventéce sentiment.
La marquise, en contemplant cette terre « dégradée », la reconstitue dans son esprit telle qu'elleétait avant cette détérioration, cette «dégradation», dans toute sa splendeur magnifique.
Elle n'aimait pas.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mme de Sévigné, Lettre à Mme de Grignan (1672).
- Mme de Sévigné lettre a sa fille
- Lettre de Mme de Sévigné à M de Coulange
- Lettre sur la mort de M. de La Rochefoucauld. Mme de Sévigné
- Lettre sur la mort du Comte de Guiche. Mme de Sévigné