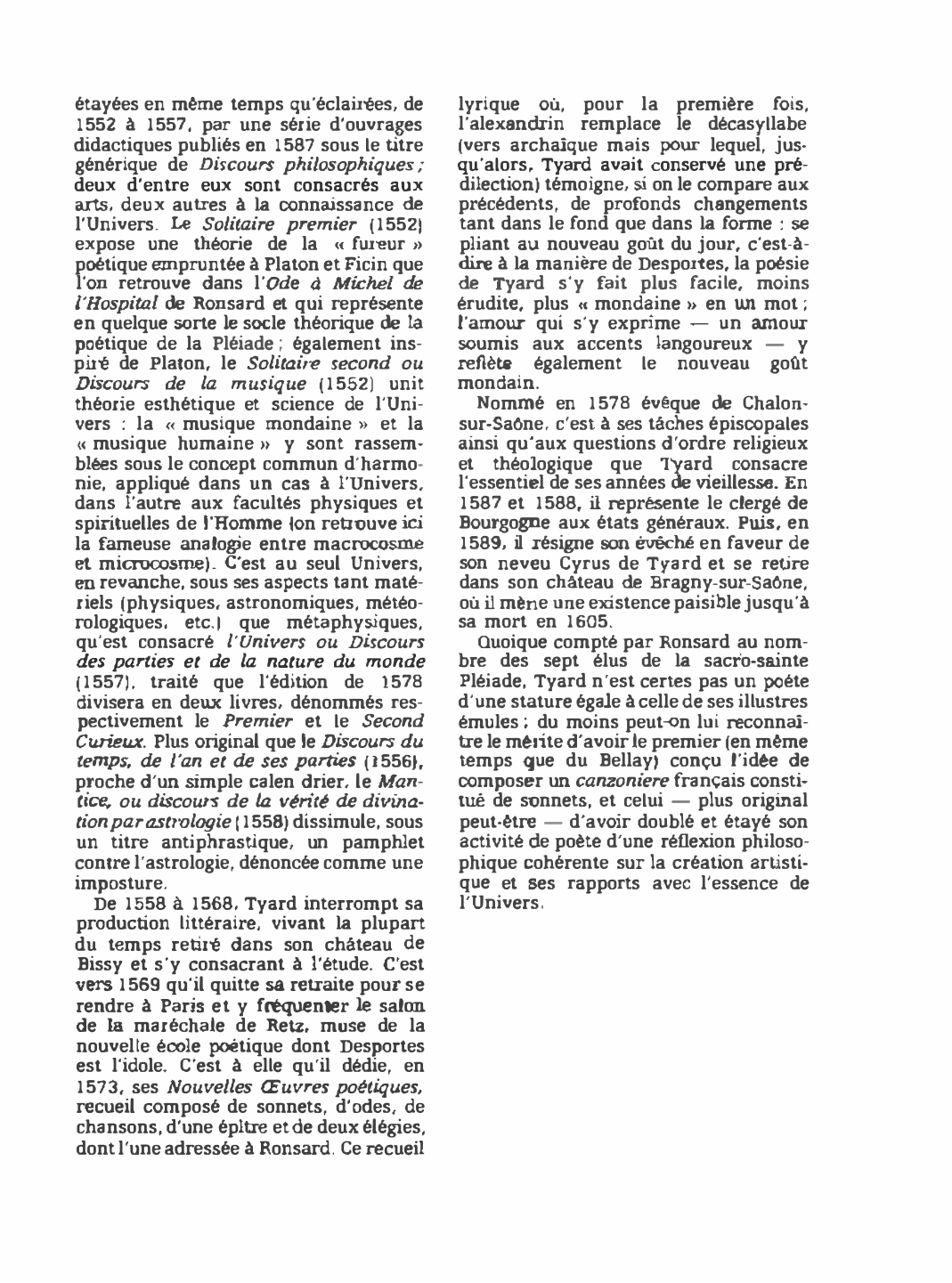TYARD (Pontus de)
Publié le 20/05/2019
Extrait du document
TYARD (Pontus de), poète français (Château de Bissy, Mâconnais, 1521 -Bragny-sur-Saône 1605). On sait peu de choses de sa vie. Fils d'une famille de noblesse ancienne, destiné de bonne heure à l'Église, il est, en 1537, étudiant à l'université de Paris. C'est à son retour en Bourgogne qu'il publie en 1549 (la même année que l'Olive de du Bellay) sa première œuvre poétique, les Erreurs amoureuses, recueil de sonnets décasyl-
labiques et de chansons voué à une certaine Pasithée : nom qui dissimule (plusieurs détails du recueil l'attestent) l'identité d'une femme bien réelle, mais transfigurée par le poète en un être idéal, image de la divinité et de la science suprême qui constituent pour lui l'objet de la quête poétique. À l'influence de Pétrarque et des strambottistes italiens auxquels Tyard emprunte leurs thèmes et leur rhétorique maniériste (à l'instar des poètes de la Pléiade) s'ajoutent en effet, dans les Erreurs de 1549, celle de Scève et celle du néoplatonisme, connu du poète par l'Italien Léon Hébreu dont il traduira, en 1552, les Dialogues d'amour. Pasithée,
«
étayées
en même temps qu'éclairées.
de
1552 à 1557, par une série d'ouvrages
didactiques publiés en 1587 sous le titre
générique de Discours philosophiques;
deux d'entre eux sont consacrés aux
arts.
deux autres à la connaissance de
l'Univers.
Le Solitaire premier (1552)
expose une théorie de la « fureur »
poétique empruntée à Platon et Ficin que
l'on retrouve dans l'O de cl Michel de
l'Hospiwl de Ronsard et qui représente
en quelque sorte le socle théorique de la
poétique de la Pléiade ; également ins
piré de Platon.
le Solitaire second ou
Discours de la musique (1552) unit
théorie esthétique et science de l'Uni
vers : la « musique mondaine >> et la
« musique humaine » y sont rassem
blées sous le concept commun d'harmo
nie, appliqué dans un cas à l'Univers.
dans l'autre aux facultés physiques et
spirituelles de l'Homme (on retrouve ici
la fameuse analogie entre macrocosme
et microcosme).
C'est au seul Univers,
en revanche, sous ses aspects tant maté
riels (physiques, astronomiques, météo
rologiques.
etc.) que métaphysiques,
qu'est consacré l'Univers ou Discours
des parties et de la nature du monde
(1557).
traité que l'édition de 1578
divisera en deux livres.
dénommés res
pectivement le Premier et le Second
Curieux.
Plus original que le Discours du
temps, de l'an et de ses parties (1556),
proche d'un simple calen drier, le Man
Lice, ou discours de la vérité de divina
tion par astrologie ( 1558) dissimule, sous
un titre antiphrastique, un pamphlet
contre l'astrologie, dénoncée comme une
imposture.
De 1558 à 1568, Tyard interrompt sa
production littéraire, vivant la plupart
du temps retiré dans son château de
Bissy et s'y consacrant à l'étude.
C'est
vers 1569 qu'il quitte sa retraite pour se
rendre à Paris et y fréquenter le salon
de la maréchale de Reu, muse de la
nouvelle école poétique dont Desportes
est l'idole.
C'est à elle qu'il dédie, en
1573, ses Nouvelles Œuvres poétiques,
recueil composé de sonnets, d'odes, de
chansons.
d'une épltre et de deux élégies.
dont l'une adressée à Ronsard.
Ce recueil lyrique
où, pour la première fois,
l'alexandrin remplace le décasyllabe
(vers archalque mais pour lequel, jus
qu'alors, Tyard avait conservé une pré
dilection) témoigne.
si on le compare aux
précédents, de profonds changements
tant dans le fond que dans la forme : se
pliant au nouveau goût du jour, c'est-à
dire à la manière de Desportes, la poésie
de Tyard s'y fait plus facile, moins
érudite, plus.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ERREURS AMOUREUSES (Les ). de Pontus de Tyard (ou de Thiard) (résumé)
- Tyard ou Thiard ( Pontus de), 1521-1605, né au château de Bissy (Mâconnais), poète français.
- Tyard, Pontus de - littérature.
- TYARD Pontus de (vie et oeuvre)
- Phorcys (Phorcus; Old man of the sea) Greek An ancient sea god; son of Gaia and Pontus; husband to his sister Ceto.