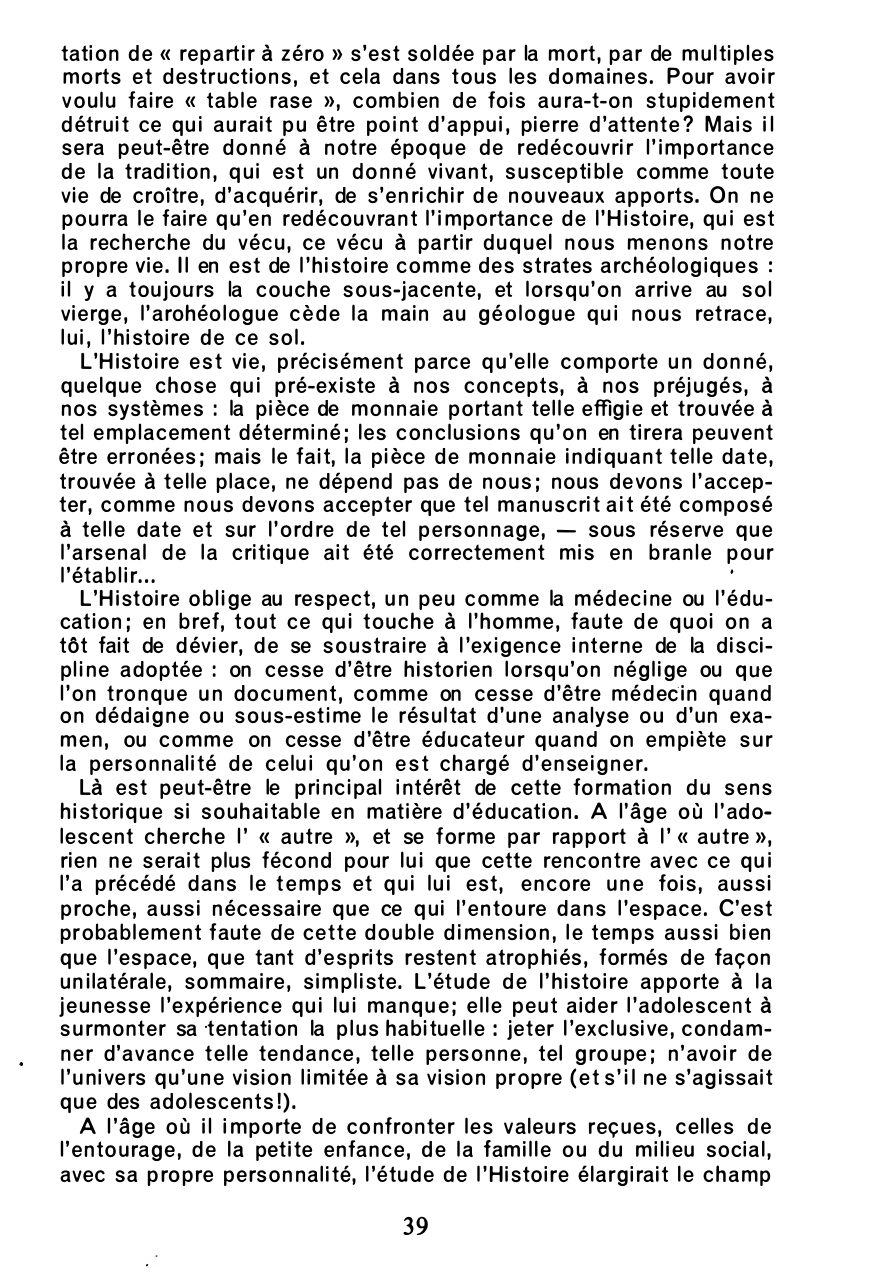THÈME DE RÉFLEXION: le roman et le réel.
Publié le 04/11/2016
Extrait du document
La rapide promotion du roman au firmament des lettres vient de sa nature expansionniste : puisant dans les divers genres — dont il abolit la pertinence — il en fait des vassaux dont l’existence même dépend de son propre succès; il n’est jusqu’au réel qu’il ne s’annexe en l’investissant au moyen des sciences humaines. Colonisateur par atavisme, totalitaire par essence, libertaire par fonction, le roman parasite et la littérature et la vie : à la première il emprunte à loisir formes et techniques, dans la seconde il puise librement ses thèmes d’inspiration, sans que ni l’une ni l’autre n’aient de droits à faire valoir.
Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, 1972.
Du « miroir que l’on promène le long d’un chemin » dont parle Stendhal au « récit d’événements fictifs » dans lequel Maurois voit la nature même du roman, le rapport du genre au réel a toujours été au centre de la création romanesque. Par-delà les subdivisions en catégories secondaires — le roman peut-être historique, psychologique, fantastique, poétique, philosophique, etc. — c’est le lien du textuel (les mots et les phrases) avec l’extra-textuel (thèmes et sujets) qui est l’objet même des querelles qui de préfaces en manifestes, de formules en développements, tentent d’édifier une théorie du roman. En fait, le problème du réel
«
tat
ion de « re par tir à zér o » s'est soldée par la mor t, par de mu ltip les
mor ts et destruc tions, et cela dans tous les domai nes.
Pour avoir
voulu faire « table rase », combien de fois aura-t- on stupideme nt
dé truit ce qui aurait pu être point d'appui, pierre d'att ente ? Ma is il
ser a peut -être donné à notre époq ue de redécouvr ir l'impor tance
de la tr aditio n, qui est un donné vivant, suscept ible comme toute
vie de croitre , d'acquér ir, de s'en richir de nouv eaux appor ts.
On ne
pou rra le faire qu'en redécou vrant l'impor tance de l'Hi stoire, qui est
la rec her che du vécu, ce vécu à pa rtir duq uel nous menons notre
pr opr e vie .
Il en est de l'histoir e comme des strates archéologi ques :
il y a toujour s la couche sous-jacente, et lorsqu'on arrive au sol
vie rge, l'arohé ologue cède la ma in au géologue qui nous retrace,
lu i, l'histo ire de ce sol.
L'Hi stoire est vie, pr éci sément parce qu'elle compor te un don né,
quelque chose qui pré-existe à nos concepts, à nos préjug és, à
nos systèmes : la pièce de monna ie por tant telle effigie et trouv ée à
tel empl acement détermin é; les conclus ions qu'on en tire ra peuvent
être erronées ; ma is le fait, la pièce de monna ie indiquant telle date,
trou vée à telle place, ne dépend pas de nous ; nous devons l'a ccep
ter, comme nous devons accepter que tel manuscrit ait été compo sé
à telle date et sur l'ordre de tel person nage, -sous réser ve que
l' ar senal de la cr itique ait été correct ement mis en branle pour
l' éta blir...
·
L'Hi stoire oblige au resp ect, un peu comme la méd ecine ou l'édu
cati on; en bref, tout ce qui touche à l'homme, faute de quo i on a
tôt fait de dévie r, de se sous trair e à l'exig ence interne de la disci
pline adoptée : on cesse d'être histo rie n lor squ'on néglige ou que
l'on tronque un docu ment, comme on cesse d'être médeCin quand
on déda igne ou sous-estime le rés ultat d'une analyse ou d'un exa
men, ou comme on cesse d'être éducateur quand on empiète sur
la per sonn alité de celui qu'on est char gé d'en seigner.
Là est peut-être le principal intérêt de cette form atio n du sens
histor ique si souha itable en ma tière d'éduc ation.
A l'âge où l'ado
lescent cherche l' « autr e », et se forme par rappor t à l'« autr e»,
ri en ne serait plus fécond pour lui que cette rencontr e avec ce qui
l'a précédé dans le temps et qui lui est, encor e une fois, auss i
pr oche, aussi néces sair e que ce qui l'ent oure dans l'espace.
C'est
prob ablement faute de cette double dimens ion, le tem ps auss i bien
que l'es pace, que tant d'espr its reste nt atrophiés , formés de façon
uni latér ale, sommaire, sim pliste.
L'étude de l'histoire apporte à la
jeune sse l'expér ience qui lui manq ue; elle peut aider l'adolesc ent à
sur monter sa ten tation la plus habitu elle : jeter l'ex clus ive, condam
ner d'avance telle tendanc e, telle personne, tel group e ; n'avoir de
l'u nive rs qu'une vision limitée à sa vision propr e (et s'il ne s'agissait
que des adole scents !).
A l'âge où il impor te de confr ont er les valeurs reç ues, celles de
l'ent ourage, de la petite enfance, de la famil le ou du milieu social,
avec sa propr e per son nalité, l'étu de de l'His toire élargir ait le champ
39.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ► Un roman doit-il chercher à faire oublier au lecteur que ses personnages sont fictifs ? Vous fonderez votre réflexion sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en classe et sur vos lectures r ujet - Objet d’étude : « roman », « personnages [...] fictifs » -» le roman. - Thème précis : « Un roman doit-il... » vous devez parler des caractéristiques que l’on peut attendre d’un roman, mais précisément en ce qui concerne les « personnages » (et non pas tous les éléments
- Le personnage de roman aide notre lecteur à pouvoir se connaitre mentalement et connaitre l’identité des autres car le roman prend ses racines dans le réel car il influence le lecteur.
- Un personnage de roman doit-Il être un être réel ?
- Le roman copie-t-il le réel ?
- Commentez cette réflexion de P.-A. Touchard dans L'Amateur de théâtre ou la Règle du jeu: « Il y a une fatalité dans le roman comme il y a une fatalité au théâtre, mais la fatalité du roman est dans le personnage, celle du théâtre dans la situation. Le roman tend à nous faire souvenir que l'homme est déterminé par ses propres passions; le théâtre à nous rappeler que son destin demeure le jouet des événements. » ?