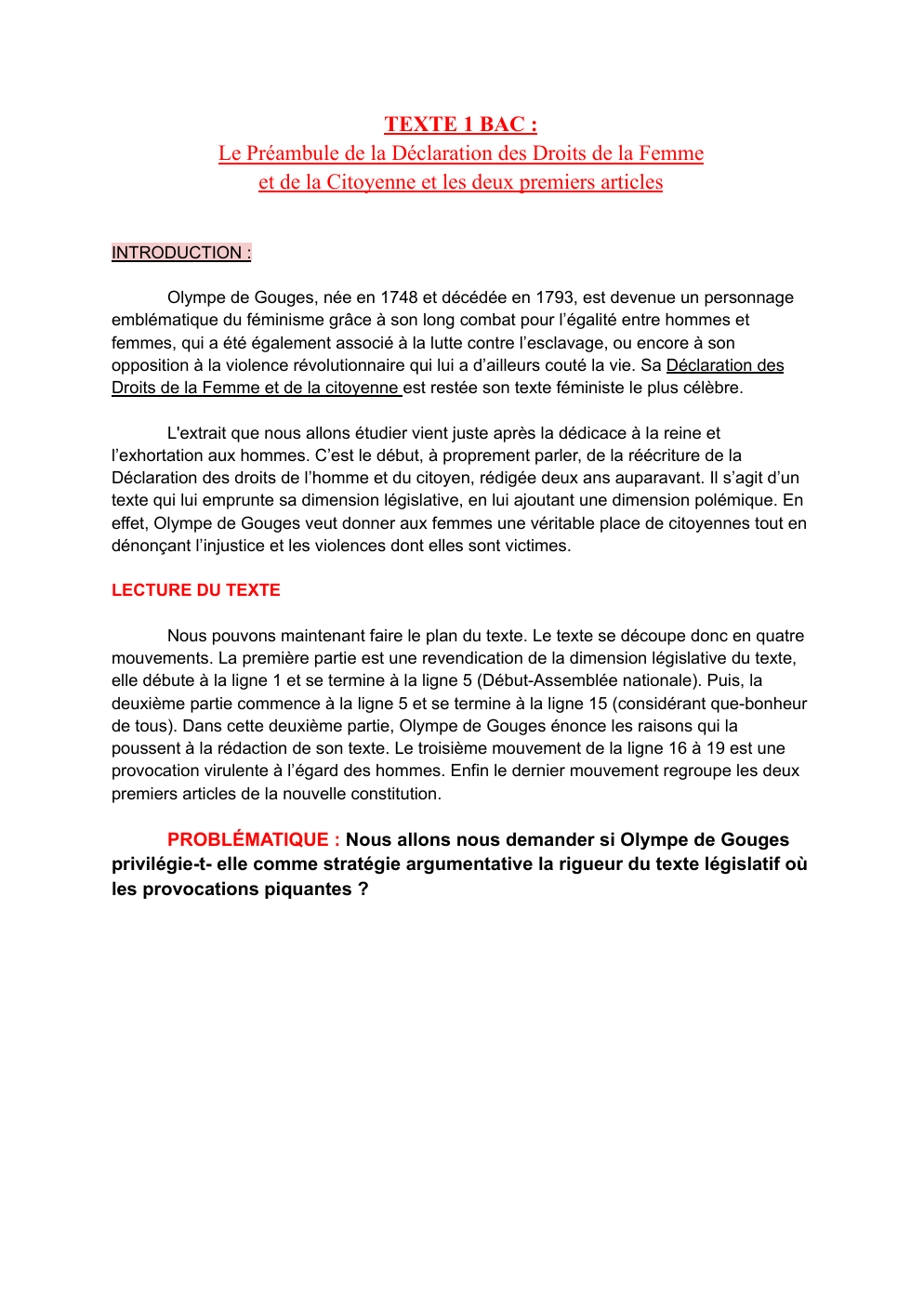TEXTE 1 BAC : Le Préambule de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne et les deux premiers articles
Publié le 17/04/2025
Extrait du document
«
TEXTE 1 BAC :
Le Préambule de la Déclaration des Droits de la Femme
et de la Citoyenne et les deux premiers articles
INTRODUCTION :
Olympe de Gouges, née en 1748 et décédée en 1793, est devenue un personnage
emblématique du féminisme grâce à son long combat pour l’égalité entre hommes et
femmes, qui a été également associé à la lutte contre l’esclavage, ou encore à son
opposition à la violence révolutionnaire qui lui a d’ailleurs couté la vie.
Sa Déclaration des
Droits de la Femme et de la citoyenne est restée son texte féministe le plus célèbre.
L'extrait que nous allons étudier vient juste après la dédicace à la reine et
l’exhortation aux hommes.
C’est le début, à proprement parler, de la réécriture de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, rédigée deux ans auparavant.
Il s’agit d’un
texte qui lui emprunte sa dimension législative, en lui ajoutant une dimension polémique.
En
effet, Olympe de Gouges veut donner aux femmes une véritable place de citoyennes tout en
dénonçant l’injustice et les violences dont elles sont victimes.
LECTURE DU TEXTE
Nous pouvons maintenant faire le plan du texte.
Le texte se découpe donc en quatre
mouvements.
La première partie est une revendication de la dimension législative du texte,
elle débute à la ligne 1 et se termine à la ligne 5 (Début-Assemblée nationale).
Puis, la
deuxième partie commence à la ligne 5 et se termine à la ligne 15 (considérant que-bonheur
de tous).
Dans cette deuxième partie, Olympe de Gouges énonce les raisons qui la
poussent à la rédaction de son texte.
Le troisième mouvement de la ligne 16 à 19 est une
provocation virulente à l’égard des hommes.
Enfin le dernier mouvement regroupe les deux
premiers articles de la nouvelle constitution.
PROBLÉMATIQUE : Nous allons nous demander si Olympe de Gouges
privilégie-t- elle comme stratégie argumentative la rigueur du texte législatif où
les provocations piquantes ?
Première partie de la ligne 1 à 5 :
Le mode infinitif "à décréter" (l.1) a une valeur d’ordre, tout en restant impersonnel :
c'est une manière pour Olympe de Gouges de donner à son propos l'importance d'un texte
de loi, dans une phrase liminaire qu'elle ajoute au texte de 1789.
Par ailleurs, les séances de
la législature en cours ou de la prochaine (l.
1-2) mentionnées ici, confèrent une dimension
très concrète à la démarche de l'autrice : elle envisage véritablement sa Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne comme un texte à porter législative.
Cela nous est confirmé par la phrase suivante qui réclame pour les femmes le droit
de siéger à l’Assemblée, comme égales des hommes.
L’énumération “les mères, les filles,
les soeurs” (l.4), qui est une périphrase pour désigner “les femmes”, sonne, quant à elle
davantage comme une provocation : les femmes sont envisagées sous l’angle des liens du
sang, qui les tient aussi bien aux femmes qu’aux hommes, et non sous l’angle légal de
l’épouse, nécessairement soumise à l’époux, à l’époque de la rédaction du texte.
Par
ailleurs, elles se présentent ainsi comme une famille de femmes unies et déterminées à
obtenir ce qu’elles demandent.
Il s’agit ici d’un argument naturaliste qu’Olympe de Gouges
avait déjà utilisé dans le texte précédent : l’exhortation aux hommes.
Deuxième partie de la ligne 5 à 16 :
Ce passage est très fidèle au texte d’origine, ce qui rend chaque variation
particulièrement lourde de sens.
Il s’agit d’une longue et unique phrase qui reprend le
propos solennel de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, introduite par le
participe présent “considérant que” (l.5) qui recourt au vocabulaire législatif.
En remplaçant
le nom “Homme”, compris comme “être humain”, par la “femme”(l.6) sans majuscule, elle
dénonce le mensonge du texte de 1789 qui oublie, sans en avoir l’air, la moitié de la
population adulte française.
Elle entend ainsi proclamer que les femmes ne sont pas les
seules concernées par leurs malheurs; le texte a donc une portée universelle, telle qu’aurait
dû avoir celui de 1789.
En effet, les mauvais traitements infligés aux femmes ont des
conséquences pour tout le monde puisqu’ils sont à l’origine des “malheurs publics et de la
corruption des gouvernements.” (l.6-7)
Reprenant ensuite les structures ternaires de la phrase de 1789, composée de la
conjonction de subordination “afin que” (l.9-11-13) répétée trois fois en anaphore, pour
énumérer les trois objectifs de la Déclaration, ainsi que des gradations ascendantes
“l’ignorance, l’oubli ou le mépris” (l.6) et (l.8) “les droits naturels, inaliénables et sacrés de la
femme”, le texte de l’autrice a tout le sérieux d’un texte de loi.
Il emprunte également au texte de 1789 le champ lexical de la solennité avec le terme
“sacrés” (l.9) mais également celui de la permanence avec les termes “inaliénables”,
“constamment” et “sans cesse”.
L’énonciation des deux premiers objectifs de la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication linéaire du préambule et des 4 premiers articles Intro: La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
- Lecture linéaire n°5: Préambule de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
- Lecture linéaire n°5 : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : postambule
- Analyse linéaire postambule Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe de Gouges
- Proposition de lecture linéaire-Dédicace à la Reine, Olympe de Gouges, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Parcours - Ecrire et combattre pour l’égalité