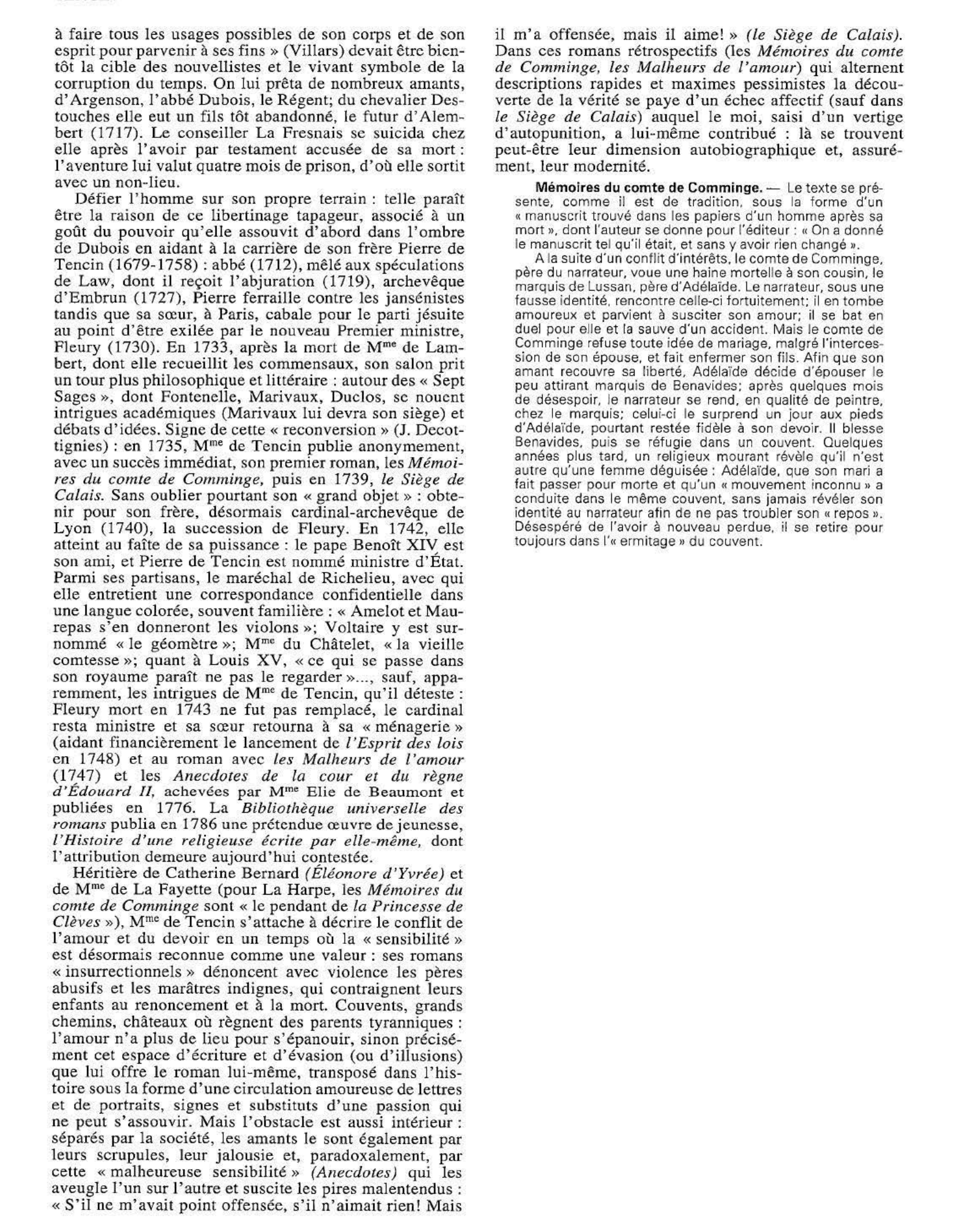TENCIN Claudine Alexandrine Guérin de, dite Mme de
Publié le 14/10/2018
Extrait du document
TENCIN Claudine Alexandrine Guérin de, dite Mme de (1682-1749). Romancière, née à Grenoble dans une famille de robe. Contrainte à seize ans de prendre le voile chez les dominicaines, elle n’attendit pas son retour à l'état laïc (1712) pour se rendre à Paris et briller chez sa sœur Mme de Ferriol, où elle rencontra Fontenelle, Prior et lord Bolingbroke. Cette « intrigante accoutuméeà faire tous les usages possibles de son corps et de son esprit pour parvenir à ses fins » (Villars) devait être bientôt la cible des nouvellistes et le vivant symbole de la corruption du temps. On lui prêta de nombreux amants, d’Argenson, l’abbé Dubois, le Régent; du chevalier Destouches elle eut un fils tôt abandonné, le futur d’Alem-bert (1717). Le conseiller La Fresnais se suicida chez elle après l’avoir par testament accusée de sa mort : l’aventure lui valut quatre mois de prison, d’où elle sortit avec un non-lieu.
Défier l’homme sur son propre terrain : telle paraît être la raison de ce libertinage tapageur, associé à un goût du pouvoir qu’elle assouvit d’abord dans l’ombre de Dubois en aidant à la carrière de son frère Pierre de Tencin (1679-1758) : abbé (1712), mêlé aux spéculations de Law, dont il reçoit l’abjuration (1719), archevêque d’Embrun (1727), Pierre ferraille contre les jansénistes tandis que sa sœur, à Paris, cabale pour le parti jésuite au point d’être exilée par le nouveau Premier ministre, Fleury (1730).
«
à faire tous l es usages possible s de son corps et de son esprit pour parveni r à ses fins » (Villars) devait être bien tôt la cible de s nouvellistes et le vivan t symbole de la
corruption du tem ps.
On lui pr êta de nombreux amants, d'Argenson, l'abbé Dubois, le Régent; du chevalier Des touches elle eut un fils tôt abandonné, le f utur d' Alem bert (1717).
Le conseiller La Fresnais se suicida chez elle après 1' avoir par testament accusée de sa mort : l'aventure lui valu t quatre mois de prison, d'où elle sortit avec un non-lieu.
Défier l'homme sur son propre terrain : telle paraît être la raison de ce libe rtinage tapageur, associé à un goût du pouvoir qu' elle assouvit d'abord dans l'ombre de Dubois en aidant à la carrière de son frère Pierre de Tencin (1679-1758) : abbé (1712), mêlé aux spéculations de Law, dont il reçoit l'abjuration (1719), archevêque d'Embrun (1727), Pierre ferraille contre les jansénistes tandis que sa sœur, à Paris, cabale pour le parti jésuite au poin t d'être exilée par le nouveau Premi er ministre,
Fleury (1730).
En 1733, apr ès la mort de Mme de Lam bert, dont elle recueillit les commensaux, so n salon prit un tour plus philosophique et littéraire : autour des « Sept Sages», dont Fontenelle, Marivaux, Duclos, se nouent intr igues académiques (Marivaux lui devra son siège) et débats d'idées.
Signe de cette « reconversion » (J.
Decot tignies): en 1735, Mme de Tencin publie anonymement, avec un succès immédiat, son premier roman, les Mémoi res du comte de Comminge, puis en 1739 , le Siège de Calais .
Sans oublier pourtant son « grand objet » : obte nir pour son frère, désormais cardinal-archevêque de Lyon (1740), la success ion de Fleury.
En 1742, elle
atteint au faîte de sa puissance : le pape Benoît XIY_ est son ami, et Pierre de Tencin est nommé ministre d'E tat.
Parmi ses partisans , le maréchal de Richelieu, avec qui elle entretient une correspo ndance confidentielle dans une langue colorée, souvent familière : « Amelot et Mau repas s'en donne ront les violons)>; Voltaire y est sur nommé « le géomètre»; Mm • du Châtelet, «la vieille
comtesse>>; quant à Louis XV, «ce qui se passe dans son royaume paraît ne pas le regarder» ...
, sauf, appa remment, les intrigues de Mm • de Tencin, qu'il déteste: Fleury mort en 1743 ne fut pas remplacé, le cardinal
resta ministre et sa sœur retourna à sa « ménagerie >> (aidant financièrement le lancement de l'Esprit des lois en 1748) et au roman avec les Malheurs de l'amour (17 4 7) et les Anecdotes de la cour et du règne d'Édouard Il, achevées par Mme Elie de Beaumont et publiées en 1776 .
La Bibliothèque universelle des romans publ ia en 1786 une prétendue œuvre d e jeunesse, l'Histoire d'une religieuse écrite par elle -même, dont l'attribution demeure auj ourd 'hui contestée.
H éritière de Catherine Bernard (Éléonore d'Yvrée) et de Mme de La Fayette (pour La Harpe, les Mémoires du comte de Comminge sont« le pendant de La Princesse de Clè ves >> ), Mme de Tenc in s'attache à décrire le conflit de
l 'amour et du devoir en un temps où la «sensibilité» est désormais reconnue comm e une valeur : ses romans «insurrectionne ls » dénoncent avec violence les pères
abusifs et les marâtres indignes, qui contra ignent leurs
enfants au renoncement et à la mort.
Couven t s , grands
chemins, châteaux.
où règnent des parents tyranniques : l'amour n'a plus de lieu pour s'épanouir, sinon précisé ment cet espace d'écriture et d'évasion (ou d'illusions) que lui offre le roman lui-même, transposé dans l'his toire sous la forme d'une circulation amoureuse de lettres et de portraits, signes et substituts d'une passion qui
ne p eut s'assouvir.
Mais l'obstacle est aussi intérieur: séparés par la société, les amants le son t également par leurs scrupules, leur jalousie et, paradoxalement, par cette «malheureuse sensibilité>> (Anecdotes) qui les aveugle l'un sur l'au tre et suscite les pires ma len tendus: «S'il ne m'avait point offensée, s'il n'aimait rien! Mais
il m'a o ffensée, mais il aime! >> (le Siège de Calais).
Dans ces romans rétrospecti fs (les Mémoires du comte de Comminge, les Malheurs de l'amour) qui alternen t
descriptions rapides et max imes pessimistes la décou verte de la vérité se paye d'un échec affectif (sauf dans le Siège de Calai s) au quel le moi, saisi d'un vertige d'autopunition, a lui-même contribué : là se trouvent peut -être leur dimension autobiographique et, assuré ment, leur modernité.
Mémoires du comte de Comminge .
- Le tex te se pré sente , comme il est de tradi tion, sous la forme d'un « ma nus crit trouvé dans les pap ie rs d'un homme ap rès sa mor t », dont l'auteur se donne pour l'éditeur:" On a do nné le manusc r it tel qu 'il était, et sans y avoir rien changé».
A la suite d'un conflit d'intérêts.
le com te de Comminge , père du narrateur, voue une haine morte lle à son cousi n.
le
marqu is de Lussan.
pè re d'A délaïd e.
Le nar rateur.
sous une
fausse identité.
rencont re ce lle-c i fortu itement; il en tombe
amoureux et parv ient à susciter son amour; il se bat en duel pour elle et la sauve d'un accident.
Mais le comte de Comm inge ref use tou te idée de mariage.
ma lgr é l'in te rces sion de son épouse.
et fa it enfermer son fils.
Afin que son
amant recouvre sa lib e rté.
Adé la ïde déc ide d'épouser le peu attirant marquis de Benav ides : ap rès que lq ues mo is
de désespoir, le narrateu r se rend, en qual ité de peintr e.
chez le marquis: celu i- ci le surprend un jour aux pieds
d'Adé la ïde, pourtant restée fidèle à son devoir.
Il bless e Benavides.
puis se réfugi e dans un couven t.
Que lques
a n nées plu s ta r d, un re lig ieux mou rant révèle qu'i l n'est autre qu'une femme déguisée : Adé laïde.
que son ma ri a
fa it passe r pour morte et qu'un «mouvemen t inconnu>> a
condu it e dans le même couvent.
sans jamais révé le r son
ide ntité au narrateur afin de ne pas troub ler son «repo s>>.
Dé sespéré de l'avoir à no uveau perd ue.
il se retire pour toujours dans l'« ermitage» du couven t..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TENCIN, Claudine-Alexandrine Guérin de, dite madame de (1681-1749) Mme de Tencin ne fut pas seulement célèbre pour son salon, mais aussi pour sa vie libertine.
- TENCIN, Claudine-Alexandrine Guérin de, dite madame de (1681-1749) Mme de Tencin ne fut pas seulement célèbre pour son salon, mais aussi pour sa vie libertine.
- TENCIN (Claudine Alexandrine Guérin de, dite Mme de)
- Tencin ( Claudine Alexandrine Guérin.
- TENCIN, Claudine-Alexandrine Guérin de, dite madame de (1681-1749)