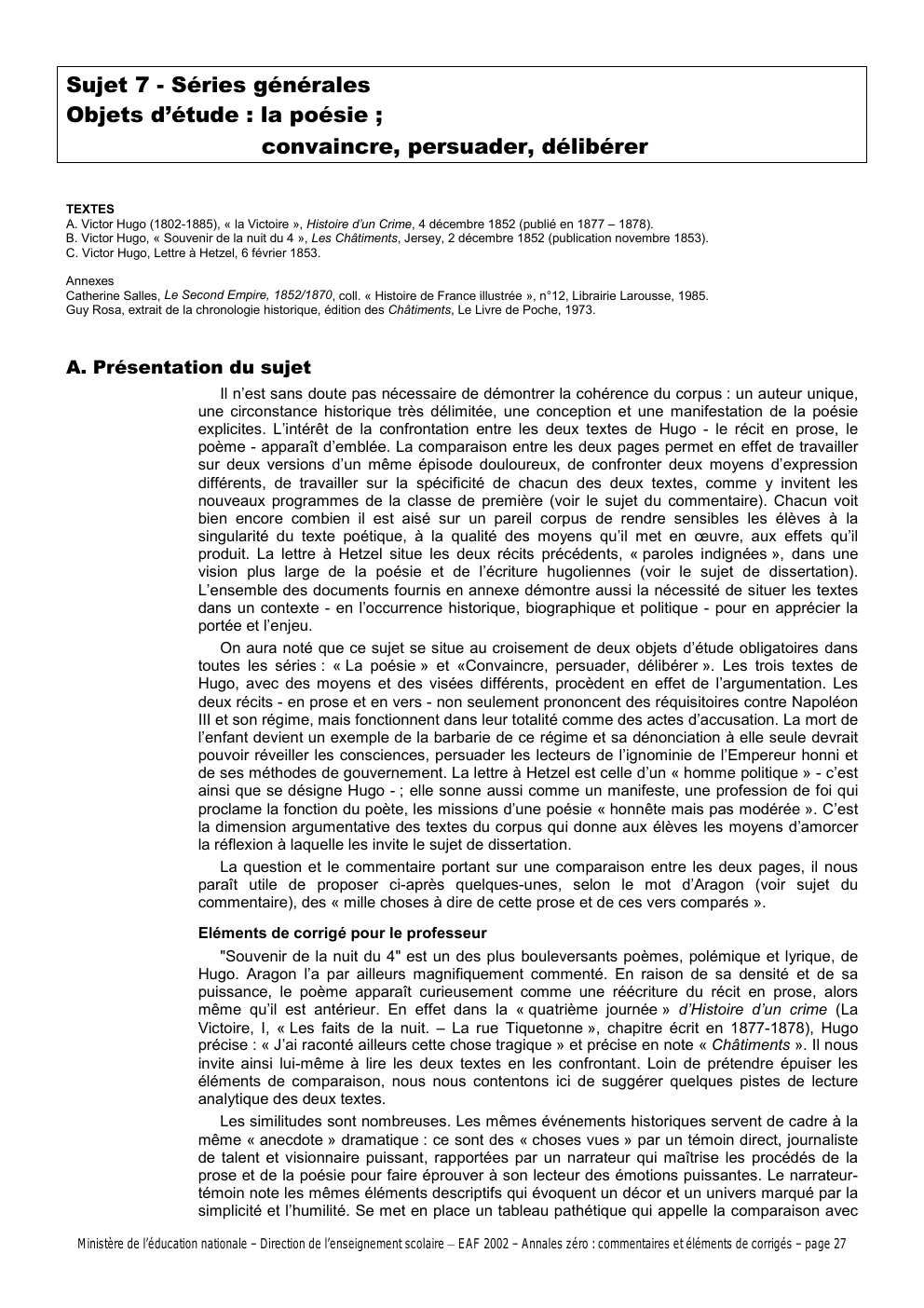Sujet 7 - Séries générales Objets d’étude : la poésie ; convaincre, persuader, délibérer
Publié le 29/03/2025
Extrait du document
«
Sujet 7 - Séries générales
Objets d’étude : la poésie ;
convaincre, persuader, délibérer
TEXTES
A.
Victor Hugo (1802-1885), « la Victoire », Histoire d’un Crime, 4 décembre 1852 (publié en 1877 – 1878).
B.
Victor Hugo, « Souvenir de la nuit du 4 », Les Châtiments, Jersey, 2 décembre 1852 (publication novembre 1853).
C.
Victor Hugo, Lettre à Hetzel, 6 février 1853.
Annexes
Catherine Salles, Le Second Empire, 1852/1870, coll.
« Histoire de France illustrée », n°12, Librairie Larousse, 1985.
Guy Rosa, extrait de la chronologie historique, édition des Châtiments, Le Livre de Poche, 1973.
A.
Présentation du sujet
Il n’est sans doute pas nécessaire de démontrer la cohérence du corpus : un auteur unique,
une circonstance historique très délimitée, une conception et une manifestation de la poésie
explicites.
L’intérêt de la confrontation entre les deux textes de Hugo - le récit en prose, le
poème - apparaît d’emblée.
La comparaison entre les deux pages permet en effet de travailler
sur deux versions d’un même épisode douloureux, de confronter deux moyens d’expression
différents, de travailler sur la spécificité de chacun des deux textes, comme y invitent les
nouveaux programmes de la classe de première (voir le sujet du commentaire).
Chacun voit
bien encore combien il est aisé sur un pareil corpus de rendre sensibles les élèves à la
singularité du texte poétique, à la qualité des moyens qu’il met en œuvre, aux effets qu’il
produit.
La lettre à Hetzel situe les deux récits précédents, « paroles indignées », dans une
vision plus large de la poésie et de l’écriture hugoliennes (voir le sujet de dissertation).
L’ensemble des documents fournis en annexe démontre aussi la nécessité de situer les textes
dans un contexte - en l’occurrence historique, biographique et politique - pour en apprécier la
portée et l’enjeu.
On aura noté que ce sujet se situe au croisement de deux objets d’étude obligatoires dans
toutes les séries : « La poésie » et «Convaincre, persuader, délibérer ».
Les trois textes de
Hugo, avec des moyens et des visées différents, procèdent en effet de l’argumentation.
Les
deux récits - en prose et en vers - non seulement prononcent des réquisitoires contre Napoléon
III et son régime, mais fonctionnent dans leur totalité comme des actes d’accusation.
La mort de
l’enfant devient un exemple de la barbarie de ce régime et sa dénonciation à elle seule devrait
pouvoir réveiller les consciences, persuader les lecteurs de l’ignominie de l’Empereur honni et
de ses méthodes de gouvernement.
La lettre à Hetzel est celle d’un « homme politique » - c’est
ainsi que se désigne Hugo - ; elle sonne aussi comme un manifeste, une profession de foi qui
proclame la fonction du poète, les missions d’une poésie « honnête mais pas modérée ».
C’est
la dimension argumentative des textes du corpus qui donne aux élèves les moyens d’amorcer
la réflexion à laquelle les invite le sujet de dissertation.
La question et le commentaire portant sur une comparaison entre les deux pages, il nous
paraît utile de proposer ci-après quelques-unes, selon le mot d’Aragon (voir sujet du
commentaire), des « mille choses à dire de cette prose et de ces vers comparés ».
Eléments de corrigé pour le professeur
"Souvenir de la nuit du 4" est un des plus bouleversants poèmes, polémique et lyrique, de
Hugo.
Aragon l’a par ailleurs magnifiquement commenté.
En raison de sa densité et de sa
puissance, le poème apparaît curieusement comme une réécriture du récit en prose, alors
même qu’il est antérieur.
En effet dans la « quatrième journée » d’Histoire d’un crime (La
Victoire, I, « Les faits de la nuit.
– La rue Tiquetonne », chapitre écrit en 1877-1878), Hugo
précise : « J’ai raconté ailleurs cette chose tragique » et précise en note « Châtiments ».
Il nous
invite ainsi lui-même à lire les deux textes en les confrontant.
Loin de prétendre épuiser les
éléments de comparaison, nous nous contentons ici de suggérer quelques pistes de lecture
analytique des deux textes.
Les similitudes sont nombreuses.
Les mêmes événements historiques servent de cadre à la
même « anecdote » dramatique : ce sont des « choses vues » par un témoin direct, journaliste
de talent et visionnaire puissant, rapportées par un narrateur qui maîtrise les procédés de la
prose et de la poésie pour faire éprouver à son lecteur des émotions puissantes.
Le narrateurtémoin note les mêmes éléments descriptifs qui évoquent un décor et un univers marqué par la
simplicité et l’humilité.
Se met en place un tableau pathétique qui appelle la comparaison avec
Ministère de l’éducation nationale – Direction de l’enseignement scolaire – EAF 2002 – Annales zéro : commentaires et éléments de corrigés – page 27
les piétà : la grand-mère porte le corps de l’enfant mort, tout comme Marie soutient le corps de
Jésus à la descente de la croix.
Le même mouvement soulève les deux récits : on passe d’une
veillée funèbre à la condamnation d’un régime politique.
Les deux textes articulent les registres
tragique et polémique.
L’analyse du récit en prose révèle quelques traits d’écriture particuliers qui le distinguent
nettement du poème.
Le récit est localisé avec précision (Rue Tiquetonne).
Il indique la présence d’autres témoins
identifiés.
Ainsi il répond à l’objectif que s’assigne Hugo dans l’Histoire d’un crime : « J’(…) ai
déclaré que j’avais un devoir, celui de faire l’histoire immédiate et toute chaude de ce qui vient
de se passer.
Auteur, témoin et juge, je suis historien tout à fait.
» ou encore dans la Préface de
1877 : « Le proscrit s’est immédiatement fait historien.
Il emportait dans sa mémoire indignée
ce crime, et il a voulu n’en rien laisser perdre.
De là ce livre ».
Mais l’historien se fait procureur
et son récit se construit comme un acte d’accusation.
Soulignant un mouvement dramatique, il suit une progression chronologique et spatiale
régulière : le lecteur suit l’action de la rue obscure à la maison, de l’entrée à la chambre ; le
regard se focalise sur les objets, enfin sur le corps de l’enfant dont on détaille les parties : le
front, les yeux, la tête, l’épaule, les pieds… Ce mouvement est souligné encore par un effet de
dramatisation intense : « Une chose qui était dans l’ombre » amène « Je m’approchai » qui
conduit à fixer le regard sur le corps : « Ce qu’elle avait dans les bras, c’était un enfant mort ».
Mais le mouvement se prolonge encore, rapprochant le regard et le corps du narrateur de
l’enfant ensanglanté : « deux trous rouges au front », « deux filets de sang « , «J’avais du sang
aux lèvres ».
Ce mouvement lent, inexorable, éprouvant, traduit l’horreur qu’éprouve le
narrateur et produit sur le lecteur un effet de pathétique violent.
Le discours « farouche » de l’aïeule est rapporté essentiellement en discours indirect à
l’exception de quelques cris d’autant plus désespérés : « Je veux qu’on me le rende ».
La
douleur et la colère de la grand-mère sont marquées encore par l’éclatement du discours
narrativisé dont on entend des bribes, dont le texte souligne les exclamations, les
interrogations.
Le récit en prose apparaît comme un texte narratif d’une grande sobriété où apparaissent
des insistances puissantes : le motif du sang, le thème de la fragilité (« enfant », « petit » aux
multiples occurrences, « vieille »).
Il présente dans le même tableau dramatiquement construit
l’impuissance des « misérables » devant les horreurs d’un régime, l’impuissance des témoins
devant la douleur et le scandale de la mort, la révolte latente.
Le poème se construit en deux parties (un tableau dramatique / un discours politique), mais
l’unité de l’ensemble est fortement marquée par la construction en boucle : le dernier vers fait
écho au premier, mettant sous les yeux du lecteur le spectacle affligeant d’un enfant tué.
Dans la présentation de la scène tragique, Hugo a effacé l’inutile, l’accessoire : pas de
localisation précise, aucune identification des témoins, un « nous » sobre et général (« des
nôtres ») inclut le narrateur sans que son rôle soit mis en évidence.
Un groupe humain indéfini,
tel un chœur tragique, devient le témoin de la douleur pathétique d’une aïeule.
Identiquement,
les interventions du narrateur-témoin résonnent comme les commentaires du chœur de la
tragédie antique : « dans la rue où on en tuait d’autres » ; « Hélas ! ce que la mort touche de
ses mains froides… ».
La mise en scène focalise l’attention du lecteur sur l’essentiel, objet de
douleur et de scandale : l’enfant mort.
L’effet saisissant obtenu par le premier vers est ainsi
soutenu dans la totalité d’un poème.
Le fait-divers dramatique – comme souvent chez Hugo – se transforme en symbole.
Cette
élévation est sensible dans le discours de l’aïeule rapporté « directement ».
ce n’est pas la
seule différence avec le récit en prose.
Le discours est plus long et plus organisé.
Dès lors, sa
puissance et sa véhémence s’en trouvent accrues.
L’interpellation (« Avez-vous vu saigner la
mûre dans les haies ?....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Objet d’étude : Convaincre, persuader, délibérer.
- Objet d’étude : Convaincre, persuader, délibérer.
- Objet d’étude : Convaincre, persuader et délibérer : les formes et les fonctions de l’essai, du dialogue et de l’apologue.
- Objet d'étude : Convaincre, persuader, délibérer
- L'argumentation : convaincre, persuader et délibérer