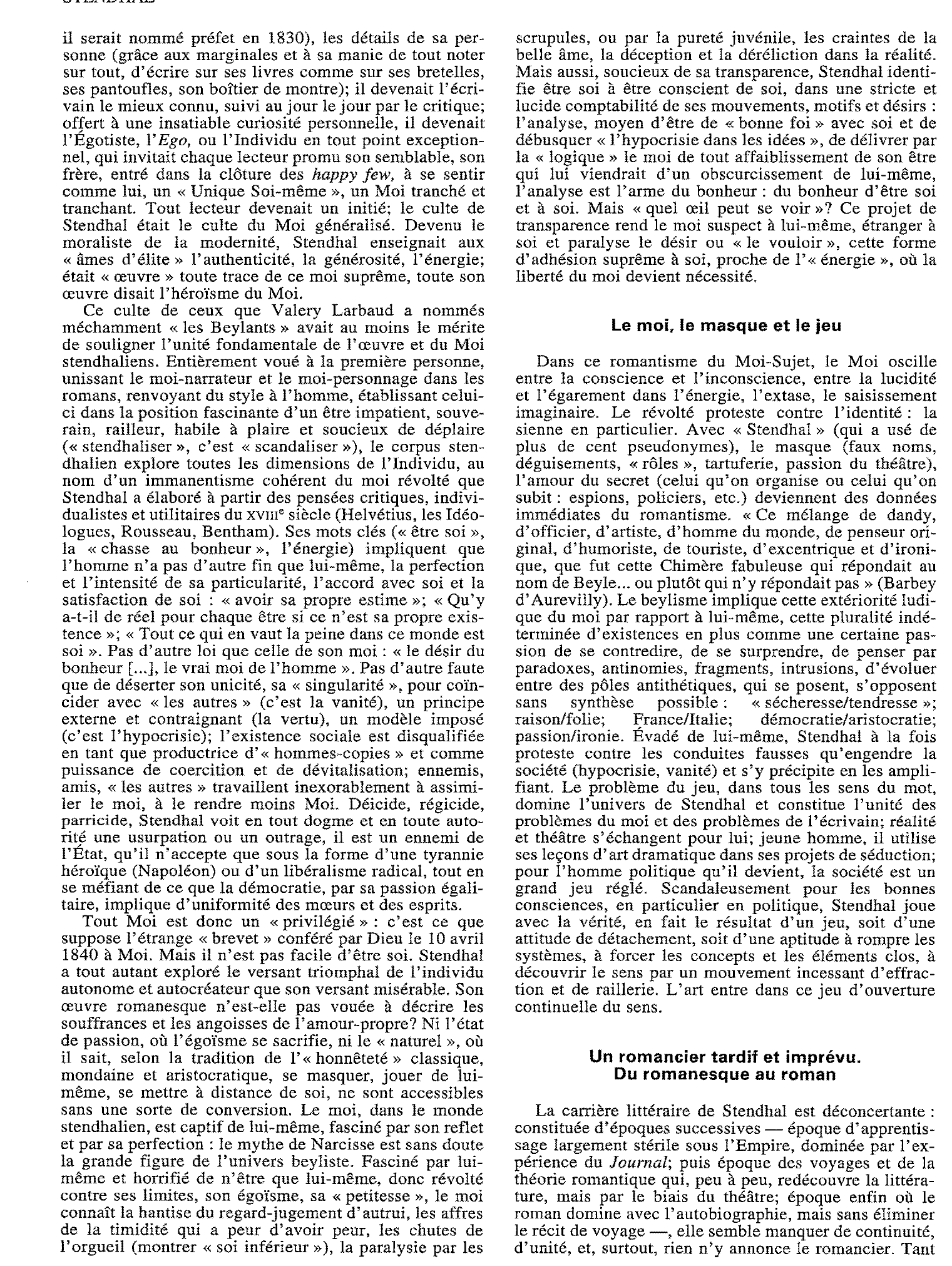STAËL, Anne Louise Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, dite de
Publié le 14/10/2018
Extrait du document

STAËL, Anne Louise Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, dite de (1766-1817). Fille de Necker et des Lumières, Mme de Staël s’est heurtée à une époque où les femmes ne recevaient guère le droit à la parole, surtout s’il s’agissait d’une parole philosophique ou politique. Penseur et écrivain, elle fut en prise directe sur une histoire tumultueuse. Elle en donnera une interprétation passionnante, en même temps qu’elle relancera une littérature malmenée par la Révolution et FEmpire, tant par ses analyses théoriques que par ses ouvertures européennes ou par sa propre production romanesque.
Des salons à l'exil
Issue d’un milieu brillant, Germaine Necker est très tôt confrontée à la politique active. Fille très aimante d’un banquier genevois protestant, l’un des hommes les plus considérés de son temps et recours d’une monarchie déclinante, elle côtoie dans le salon de sa mère encyclopédistes et philosophes et se prend d’enthousiasme pour Rousseau. La première fracture sera le mariage : elle épouse M. de Staël-Holstein, un baron suédois qu’elle n’aime pas, mais qui, ambassadeur de Suède, introduit sa jeune femme à la cour. Très vite, elle entretient une liaison avec Louis de Narbonne, premier d’une longue série d’amants, avec lesquels elle tentera de connaître ce bonheur qui lui fera si souvent défaut.
Si elle est d’abord favorable à la Révolution, dont les premiers temps lui paraissent favoriser ce progrès auquel elle aspire, Mme de Staël doit quitter une France de plus en plus livrée aux débordements. Après avoir risqué sa vie lors des massacres de septembre 1792, elle se rend à Coppet en Suisse, sans cesser de s’intéresser à la politique française et à ses amis en danger. Elle rencontre le
Suédois Ribbing, puis Benjamin Constant. Rentrée en 1795, avant d’être de nouveau chassée, Mme de Staël, qui compte déjà plusieurs œuvres à son actif, est devenue républicaine. Les vicissitudes de la vie politique sous le Directoire ne la font pas dévier : elle est favorable à une république modérée et raisonnable, fondée sur les idéaux des Lumières. Elle croit que le coup d’État de Brumaire va instaurer un ordre conforme à ses vœux. Il n’en sera rien. Bonaparte la déteste, et la condamne à l’exil à plus de quarante lieues de Paris. Il n’a apprécié ni le De la littérature (1800), rigoureuse analyse de la fonction moderne de l’écrivain et des conditions de production de la littérature, ni Delphine (1802), ni les positions politiques de Mrae de Staël ou de ses amis.
Mme de Staël est donc contrainte de parcourir l’Europe. D’Allemagne en Italie, d’Autriche en Russie puis en Angleterre, elle rencontre tout ce qui compte intellectuellement, et reçoit à Coppet une bonne partie de cette élite, opposée à FEmpire. Se fonde ainsi l’un des plus brillants et des plus actifs cercles intellectuels de l’Europe moderne, qui restera sous le nom de groupe de Coppet : Constant, Sismondi, Bonstetten, Schlegel, bien d’autres encore y multiplieront les échanges. Fuyant les armées napoléoniennes, approfondissant sa réflexion, Mmc de Staël, dont le roman Corinne (1807) n’a guère arrangé les affaires auprès du pouvoir impérial, publie à Londres De l'Allemagne en 1813, après que la première édition ait été mise au pilon à Paris (1810). Elle évoquera ces tribulations dans Dix Années d’exil, paru après sa mort en 1821.
Ayant obtenu dès 1800 la séparation d’avec M. de Staël, Mme de Staël a en 1812 un fils de John Rocca (elle l’épousera secrètement en 1816). Elle revient à Paris après la chute de Napoléon. Elle est alors au sommet de

«
il serait nommé préfet en 1830), les détails de sa per sonne (grâce aux marginales et à sa manie de tout noter sur tout, d'écrire sur ses livres comme sur ses bretelles, ses pantoufles, son boîtier de montre); il devenait l'écri vain le mieux connu, suivi au jour le jour par le critique; offert à une insatiable curiosité personnelle, il devenait l'Egotiste, l'Ego, ou l'Individu en tout point exception nel, qui invitait chaque lecteur promu son semblable, son frère, entré dans la clôture des happy few, à se sentir comme lui, un « Unique Soi-même », un Moi tranché et tranchant.
Tout lecteur devenait un initié; le culte de Stendhal était le culte du Moi généralisé.
Devenu le moraliste de la modernité, Stendhal enseignait aux «âmes d'élite» l'authenticité, la générosité, l'énergie; était « œuvre » toute trace de ce moi suprême, toute son œuvre disait l'héroïsme du Moi.
Ce culte de ceux que Valery Larbaud a nommés méchamment «les Beylants » avait au moins le mérite de souligner l'unité fondamentale de l'œuvre et du Moi stendhaliens.
Entièrement voué à la première personne, unissant le moi-narrateur et le moi-personnage dans les romans, renvoyant du style à l'homme, établissant celui ci dans la position fascinante d'un être impatient, souve rain, railleur, habile à plaire et soucieux de déplaire (« stendhaliser », c'est «scandaliser»), le corpus sten dhalien explore toutes les dimensions de l'Individu, au nom d'un immanentisme cohérent du moi révolté que Stendhal a élaboré à partir des pensées critiques, indivi dualistes et utilitaires du xvme siècle (Helvétius, les Idéo
logues, Rousseau, Bentham).
Ses mots clés («être soi», la «chasse au bonheur», l'énergie) impliquent que l'homme n'a pas d'autre fin que lui-même, la perfection et l'intensité de sa particularité, l'accord avec soi et la satisfaction de soi : «avoir sa propre estime»; «Qu'y a-t-il de réel pour chaque être si ce n'est sa propre exis tence»; «Tout ce qui en vaut la peine dans ce monde est soi».
Pas d'autre loi que celle de son moi: «le désir du bonheur[ ...
], le vrai moi de l'homme».
Pas d'autre faute que de déserter son unicité, sa « singularité », pour coïn cider avec «les autres» (c'est la vanité), un principe externe et contraignant (la vertu), un modèle imposé (c'est l'hypocrisie); l'existence sociale est disqualifiée en tant que productrice d'« hommes-copies» et comme puissance de coercition et de dévitalisation; ennemis, amis, «les autres» travaillent inexorablement à assimi ler le moi, à le rendre moins Moi.
Déicide, régicide, parricide, Stendhal voit en tout dogme et en toute auto ritft une usurpation ou un outrage, il est un ennemi de l'Etat, qu'il n'accepte que sous la forme d'une tyrannie héroïque (Napoléon) ou d'un libéralisme radical, tout en se méfiant de ce que la démocratie, par sa passion égali taire, implique d'uniformité des mœurs et des esprits.
Tout Moi est donc un «privilégié»: c'est ce que suppose l'étrange« brevet» conféré par Dieu le 10 avril 1840 à Moi.
Mais il n'est pas facile d'être soi.
Stendhal a tout autant exploré le versant triomphal de l'individu autonome et autocréateur que son versant misérable.
Son œuvre romanesque n'est-elle pas vouée à décrire les
souffrances et les angoisses de l'amour-propre? Ni l'état de passion, où l'égoïsme se sacrifie, ni le « naturel », où il sait, selon la tradition de l'« honnêteté » classique,
mondaine et aristocratique, se masquer, jouer de lui même, se mettre à distance de soi, ne sont accessibles sans une sorte de conversion.
Le moi, dans le monde
stendhalien, est captif de lui-même, fasciné par son reflet et par sa perfection :le mythe de Narcisse est sans doute la grande figure de l'univers beyliste.
Fasciné par lui même et horrifié de n'être que lui-même, donc révolté contre ses limites, son égoïsme, sa « petitesse », le moi connaît la hantise du regard-jugement d'autrui, les affres de la timidité qui a peur d'avoir peur, les chutes de 1' orgueil (montrer « soi inférieur » ), la paralysie par les scrupules,
ou par la pureté juvénile, les craintes de la belle âme, la déception et la déréliction
dans la réalité.
Mais aussi, soucieux de sa transparence, Stendhal identi fie être soi à être conscient de soi, dans une stricte et lucide comptabilité de ses mouvements, motifs et désirs : l'analyse, moyen d'être de «bonne foi» avec soi et de débusquer« l'hypocrisie dans les idées », de délivrer par la « logique » le moi de tout affaiblissement de son être qui lui viendrait d'un obscurcissement de lui-même, l'analyse est l'arme du bonheur: du bonheur d'être soi et à soi.
Mais « quel œil peut se voir»? Ce projet de transparence rend le moi suspect à lui-même, étranger à soi et paralyse le désir ou « le vouloir», cette forme d'adhésion suprême à soi, proche de l'« énergie», où la liberté du moi devient nécessité.
Le moi, le masque et le jeu
Dans ce romantisme du Moi-Sujet, le Moi oscille entre la conscience et l'inconscience, entre la lucidité et l'égarement dans l'énergie, l'extase, le saisissement imaginaire.
Le révolté proteste contre l'identité: la sienne en particulier.
Avec « Stendhal » (qui a usé de plus de cent pseudonymes), le masque (faux noms, déguisements, «rôles », tartuferie, passion du théâtre), l'amour du secret (celui qu'on organise ou celui qu'on subit : espions, policiers, etc.) deviennent des données immédiates du romantisme.
«Ce mélange de dandy, d'officier, d'artiste, d'homme du monde, de penseur ori ginal, d'humoriste, de touriste, d'excentrique et d'ironi que, que fut cette Chimère fabuleuse qui répondait au nom de Beyle ...
ou plutôt qui n'y répondait pas » (Barbey d' Aurevilly).
Le beylisme implique cette extériorité ludi que du moi par rapport à lui-même, cette pluralité indé terminée d'existences en plus comme une certaine pas sion de se contredire, de se surprendre, de penser par paradoxes, antinomies, fragments, intrusions, d'évoluer entre des pôles antithétiques, qui se posent, s'opposent sans synthèse possible : « sécheresse/tendresse »; raison/folie; France/Italie; démocratie/aristocratie;
passion/ironie.
Évadé de lui-même, Stendhal à la fois proteste contre les conduites fausses qu'engendre la société (hypocrisie, vanité) et s'y précipite en les ampli
fiant.
Le problème du jeu, dans tous les sens du mot, domine l'univers de Stendhal et constitue l'unité des problèmes du moi et des problèmes de l'écrivain; réalité et théâtre s'échangent pour lui; jeune homme, il utilise
ses leçons d'art dramatique dans ses projets de séduction; pour l'homme politique qu'il devient, la société est un grand jeu réglé.
Scandaleusement pour les bonnes consciences, en particulier en politique, Stendhal joue avec la vérité, en fait le résultat d'un jeu, soit d'une attitude de détachement, soit d'une aptitude à rompre les systèmes, à forcer les concepts et les éléments clos, à découvrir le sens par un mouvement incessant d'effrac
tion et de raillerie.
L'art entre dans ce jeu d'ouverture continuelle du sens.
Un romancier tardif et imprévu.
Du romanesque au roman
La carrière littéraire de Stendhal est déconcertante :
constituée d'époques successives- époque d'apprentis sage largement stérile sous l'Empire, dominée par l'ex
périence du Journal; puis époque des voyages et de la théorie romantique qui, peu à peu, redécouvre la littéra
ture, mais par le biais du théâtre; époque enfin où le roman domine avec l'autobiographie, mais sans éliminer le récit de voyage -, elle semble manquer de continuité, d'unité, et, surtout, rien n'y annonce le romancier.
Tant.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- STAEL-HOLSTEIN, Anne Louise Germaine Necker baronne de Staël-Holstein, dite madame de Staël (22 avril 1766-14 juillet 1817) Ecrivain Elle est la fille du banquier ministre de Louis XVI qu'est Jacques Necker.
- STAEL-HOLSTEIN, Anne Louise Germaine Necker baronne de Staël-Holstein, dite madame de Staël (22 avril 1766-14 juillet 1817) Ecrivain Elle est la fille du banquier ministre de Louis XVI qu'est Jacques Necker.
- STAEL-HOLSTEIN, Anne Louise Germaine Necker baronne de Staël-Holstein, dite madame de Staël (22 avril 1766-14 juillet 1817) Ecrivain Elle est la fille du banquier ministre de Louis XVIF202 qu'est Jacques NeckerF183.
- De l'Allemagne. Essai de Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, dite Mme de Staël (analyse détaillée)
- STAËL (Germaine Necker, baronne de. Staël-Holstein, dite Mme de)