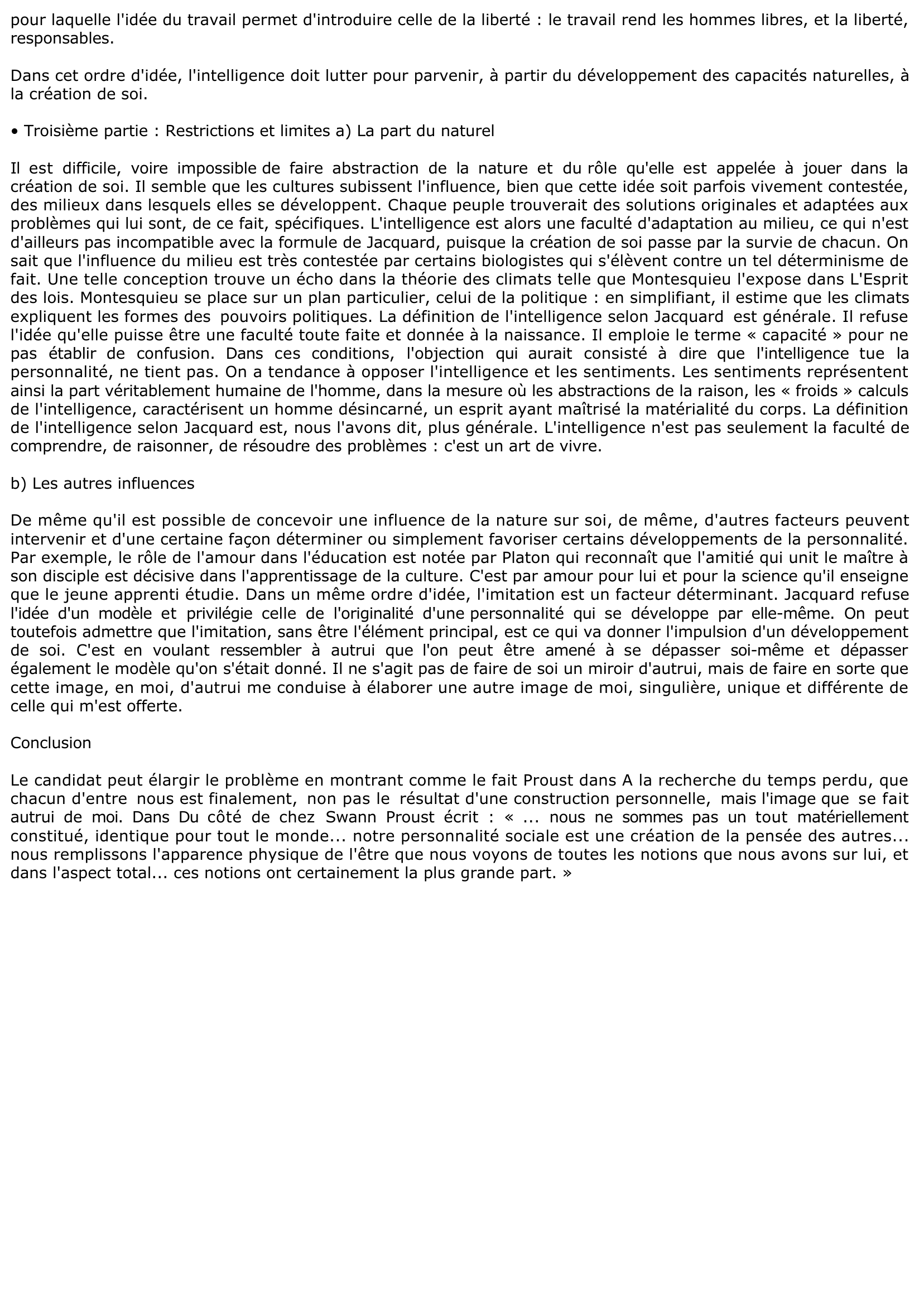Selon A. Jacquard « devenir intelligent (...) c'est se créer soi-même. » Dans un développement composé et argumenté, vous présenterez les réflexions que vous suggère ce point de vue.
Publié le 27/02/2011
Extrait du document
• Première partie : une définition de l'intelligence a) Les deux aspects de la définition Étymologiquement, l'intelligence est la faculté de comprendre. Une telle définition pose un sujet, celui qui comprend, un objet, ce qui est compris. Être intelligent, c'est établir une relation entre un sujet et un objet, c'est-à-dire entre l'esprit et une réalité donnée comme objet d'étude. La formule de Jacquard permet d'envisager l'intelligence de deux manières.
«
pour laquelle l'idée du travail permet d'introduire celle de la liberté : le travail rend les hommes libres, et la liberté,responsables.
Dans cet ordre d'idée, l'intelligence doit lutter pour parvenir, à partir du développement des capacités naturelles, àla création de soi.
• Troisième partie : Restrictions et limites a) La part du naturel
Il est difficile, voire impossible de faire abstraction de la nature et du rôle qu'elle est appelée à jouer dans lacréation de soi.
Il semble que les cultures subissent l'influence, bien que cette idée soit parfois vivement contestée,des milieux dans lesquels elles se développent.
Chaque peuple trouverait des solutions originales et adaptées auxproblèmes qui lui sont, de ce fait, spécifiques.
L'intelligence est alors une faculté d'adaptation au milieu, ce qui n'estd'ailleurs pas incompatible avec la formule de Jacquard, puisque la création de soi passe par la survie de chacun.
Onsait que l'influence du milieu est très contestée par certains biologistes qui s'élèvent contre un tel déterminisme defait.
Une telle conception trouve un écho dans la théorie des climats telle que Montesquieu l'expose dans L'Espritdes lois.
Montesquieu se place sur un plan particulier, celui de la politique : en simplifiant, il estime que les climatsexpliquent les formes des pouvoirs politiques.
La définition de l'intelligence selon Jacquard est générale.
Il refusel'idée qu'elle puisse être une faculté toute faite et donnée à la naissance.
Il emploie le terme « capacité » pour nepas établir de confusion.
Dans ces conditions, l'objection qui aurait consisté à dire que l'intelligence tue lapersonnalité, ne tient pas.
On a tendance à opposer l'intelligence et les sentiments.
Les sentiments représententainsi la part véritablement humaine de l'homme, dans la mesure où les abstractions de la raison, les « froids » calculsde l'intelligence, caractérisent un homme désincarné, un esprit ayant maîtrisé la matérialité du corps.
La définitionde l'intelligence selon Jacquard est, nous l'avons dit, plus générale.
L'intelligence n'est pas seulement la faculté decomprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes : c'est un art de vivre.
b) Les autres influences
De même qu'il est possible de concevoir une influence de la nature sur soi, de même, d'autres facteurs peuventintervenir et d'une certaine façon déterminer ou simplement favoriser certains développements de la personnalité.Par exemple, le rôle de l'amour dans l'éducation est notée par Platon qui reconnaît que l'amitié qui unit le maître àson disciple est décisive dans l'apprentissage de la culture.
C'est par amour pour lui et pour la science qu'il enseigneque le jeune apprenti étudie.
Dans un même ordre d'idée, l'imitation est un facteur déterminant.
Jacquard refusel'idée d'un modèle et privilégie celle de l'originalité d'une personnalité qui se développe par elle-même.
On peuttoutefois admettre que l'imitation, sans être l'élément principal, est ce qui va donner l'impulsion d'un développementde soi.
C'est en voulant ressembler à autrui que l'on peut être amené à se dépasser soi-même et dépasserégalement le modèle qu'on s'était donné.
Il ne s'agit pas de faire de soi un miroir d'autrui, mais de faire en sorte quecette image, en moi, d'autrui me conduise à élaborer une autre image de moi, singulière, unique et différente decelle qui m'est offerte.
Conclusion
Le candidat peut élargir le problème en montrant comme le fait Proust dans A la recherche du temps perdu, quechacun d'entre nous est finalement, non pas le résultat d'une construction personnelle, mais l'image que se faitautrui de moi.
Dans Du côté de chez Swann Proust écrit : « ...
nous ne sommes pas un tout matériellementconstitué, identique pour tout le monde...
notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres...nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui, etdans l'aspect total...
ces notions ont certainement la plus grande part.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Présentez sous forme d'un développement composé de trente à cinquante lignes, votre point de vue sur le pouvoir des grands média populaires pour créer l'événement. Vous chercherez à en préciser les limites, en songeant aux différents éléments qui interviennent (esprit critique, intérêts véritables du public, probité des journalistes...).
- Roger Martin du Gard, répondant à un de ses admirateurs qui lui demandait de le guider dans ses lectures, écrit : « Les lectures, comme les voyages, les promenades et les repas, ne prennent leur valeur que par le besoin qu'on en a. Tel livre que j'ai rejeté il y a un an sans pouvoir le finir, me bouleverse aujourd'hui... Lisez le livre qui vous sollicite, et n'hésitez pas à le rejeter si vous ne l'assimilez pas sans effort. Le moins de contrainte possible en ces matières ! » (Correspon
- Dans Ce bel aujourd'hui, Jacques Lacarrière écrit: «J'aime ce siècle où je suis né. Je m'y sens bien et je n 'ai jamais feint, comme tant d'autres, de m'y croire inadapté ou exilé. [...]Je n'ai ni regrets ni remords d'être un homme de ce temps. » Partagez-vous la satisfaction de cet auteur contemporain d'être un homme de ce temps ? Vous présenterez les réflexions que vous inspire ce point de vue sous une forme organisée en vous appuyant sur des exemples précis et diversifiés.
- Lors d'une émission de radio (sur France-Inter, le 7 décembre 1986), le biologiste et généticien Albert Jacquard a affirmé qu'« on n'est pas fait pour devenir un manuel, un intellectuel; on est fait pour devenir quelqu'un ! » . Quelles réflexions une telle remarque vous suggère-t-elle ? Correspond-elle à l'idée que vous vous faites de la formation, à la fois sociale et individuelle, de la personne humaine ?
- On ne peut se dispenser d'exercer autant de pression qu'il est nécessaire pour empêcher les spécimens les plus vigoureux de la nature humaine d'empiéter sur les droits des autres ; mais à cela, on trouve ample compensation, même du point de vue du développement humain.