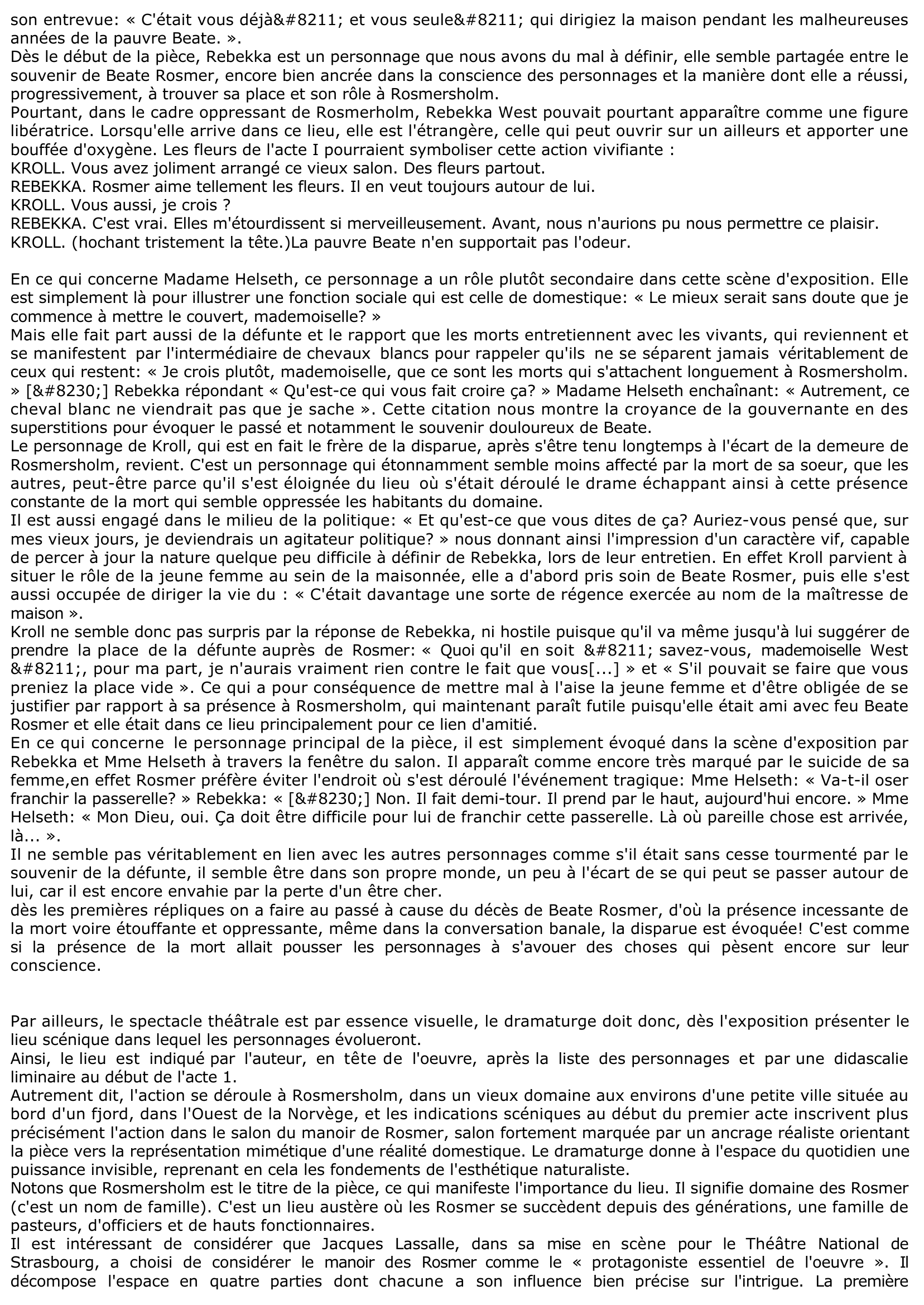Scène d'exposition de Rosmersholm
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
son entrevue: « C'était vous déjà– et vous seule– qui dirigiez la maison pendant les malheureusesannées de la pauvre Beate.
».Dès le début de la pièce, Rebekka est un personnage que nous avons du mal à définir, elle semble partagée entre lesouvenir de Beate Rosmer, encore bien ancrée dans la conscience des personnages et la manière dont elle a réussi,progressivement, à trouver sa place et son rôle à Rosmersholm.Pourtant, dans le cadre oppressant de Rosmerholm, Rebekka West pouvait pourtant apparaître comme une figurelibératrice.
Lorsqu'elle arrive dans ce lieu, elle est l'étrangère, celle qui peut ouvrir sur un ailleurs et apporter unebouffée d'oxygène.
Les fleurs de l'acte I pourraient symboliser cette action vivifiante :KROLL.
Vous avez joliment arrangé ce vieux salon.
Des fleurs partout.REBEKKA.
Rosmer aime tellement les fleurs.
Il en veut toujours autour de lui.KROLL.
Vous aussi, je crois ?REBEKKA.
C'est vrai.
Elles m'étourdissent si merveilleusement.
Avant, nous n'aurions pu nous permettre ce plaisir.KROLL.
(hochant tristement la tête.)La pauvre Beate n'en supportait pas l'odeur.
En ce qui concerne Madame Helseth, ce personnage a un rôle plutôt secondaire dans cette scène d'exposition.
Elleest simplement là pour illustrer une fonction sociale qui est celle de domestique: « Le mieux serait sans doute que jecommence à mettre le couvert, mademoiselle? »Mais elle fait part aussi de la défunte et le rapport que les morts entretiennent avec les vivants, qui reviennent etse manifestent par l'intermédiaire de chevaux blancs pour rappeler qu'ils ne se séparent jamais véritablement deceux qui restent: « Je crois plutôt, mademoiselle, que ce sont les morts qui s'attachent longuement à Rosmersholm.» […] Rebekka répondant « Qu'est-ce qui vous fait croire ça? » Madame Helseth enchaînant: « Autrement, cecheval blanc ne viendrait pas que je sache ».
Cette citation nous montre la croyance de la gouvernante en dessuperstitions pour évoquer le passé et notamment le souvenir douloureux de Beate.Le personnage de Kroll, qui est en fait le frère de la disparue, après s'être tenu longtemps à l'écart de la demeure deRosmersholm, revient.
C'est un personnage qui étonnamment semble moins affecté par la mort de sa soeur, que lesautres, peut-être parce qu'il s'est éloignée du lieu où s'était déroulé le drame échappant ainsi à cette présenceconstante de la mort qui semble oppressée les habitants du domaine.Il est aussi engagé dans le milieu de la politique: « Et qu'est-ce que vous dites de ça? Auriez-vous pensé que, surmes vieux jours, je deviendrais un agitateur politique? » nous donnant ainsi l'impression d'un caractère vif, capablede percer à jour la nature quelque peu difficile à définir de Rebekka, lors de leur entretien.
En effet Kroll parvient àsituer le rôle de la jeune femme au sein de la maisonnée, elle a d'abord pris soin de Beate Rosmer, puis elle s'estaussi occupée de diriger la vie du : « C'était davantage une sorte de régence exercée au nom de la maîtresse demaison ».Kroll ne semble donc pas surpris par la réponse de Rebekka, ni hostile puisque qu'il va même jusqu'à lui suggérer deprendre la place de la défunte auprès de Rosmer: « Quoi qu'il en soit – savez-vous, mademoiselle West–, pour ma part, je n'aurais vraiment rien contre le fait que vous[...] » et « S'il pouvait se faire que vouspreniez la place vide ».
Ce qui a pour conséquence de mettre mal à l'aise la jeune femme et d'être obligée de sejustifier par rapport à sa présence à Rosmersholm, qui maintenant paraît futile puisqu'elle était ami avec feu BeateRosmer et elle était dans ce lieu principalement pour ce lien d'amitié.En ce qui concerne le personnage principal de la pièce, il est simplement évoqué dans la scène d'exposition parRebekka et Mme Helseth à travers la fenêtre du salon.
Il apparaît comme encore très marqué par le suicide de safemme,en effet Rosmer préfère éviter l'endroit où s'est déroulé l'événement tragique: Mme Helseth: « Va-t-il oserfranchir la passerelle? » Rebekka: « […] Non.
Il fait demi-tour.
Il prend par le haut, aujourd'hui encore.
» MmeHelseth: « Mon Dieu, oui.
Ça doit être difficile pour lui de franchir cette passerelle.
Là où pareille chose est arrivée,là...
».Il ne semble pas véritablement en lien avec les autres personnages comme s'il était sans cesse tourmenté par lesouvenir de la défunte, il semble être dans son propre monde, un peu à l'écart de se qui peut se passer autour delui, car il est encore envahie par la perte d'un être cher.dès les premières répliques on a faire au passé à cause du décès de Beate Rosmer, d'où la présence incessante dela mort voire étouffante et oppressante, même dans la conversation banale, la disparue est évoquée! C'est commesi la présence de la mort allait pousser les personnages à s'avouer des choses qui pèsent encore sur leurconscience.
Par ailleurs, le spectacle théâtrale est par essence visuelle, le dramaturge doit donc, dès l'exposition présenter lelieu scénique dans lequel les personnages évolueront.Ainsi, le lieu est indiqué par l'auteur, en tête de l'oeuvre, après la liste des personnages et par une didascalieliminaire au début de l'acte 1.Autrement dit, l'action se déroule à Rosmersholm, dans un vieux domaine aux environs d'une petite ville située aubord d'un fjord, dans l'Ouest de la Norvège, et les indications scéniques au début du premier acte inscrivent plusprécisément l'action dans le salon du manoir de Rosmer, salon fortement marquée par un ancrage réaliste orientantla pièce vers la représentation mimétique d'une réalité domestique.
Le dramaturge donne à l'espace du quotidien unepuissance invisible, reprenant en cela les fondements de l'esthétique naturaliste.Notons que Rosmersholm est le titre de la pièce, ce qui manifeste l'importance du lieu.
Il signifie domaine des Rosmer(c'est un nom de famille).
C'est un lieu austère où les Rosmer se succèdent depuis des générations, une famille depasteurs, d'officiers et de hauts fonctionnaires.Il est intéressant de considérer que Jacques Lassalle, dans sa mise en scène pour le Théâtre National deStrasbourg, a choisi de considérer le manoir des Rosmer comme le « protagoniste essentiel de l'oeuvre ».
Ildécompose l'espace en quatre parties dont chacune a son influence bien précise sur l'intrigue.
La première.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le mariage de figaro: la scène d'exposition
- l'île des esclaves acte 1 scène 1 (fin de la scène d'exposition)
- En quoi le langage utilisé dans l'exposition d'Ubu Roi d'Alfred Jarry (Acte I, scène 1) a-t-il pu provoquer le scandale lors de la première représentation de la pièce ?
- Andromaque scène 1 acte 1 - Scène d’exposition
- Dom Juan, scène d'exposition