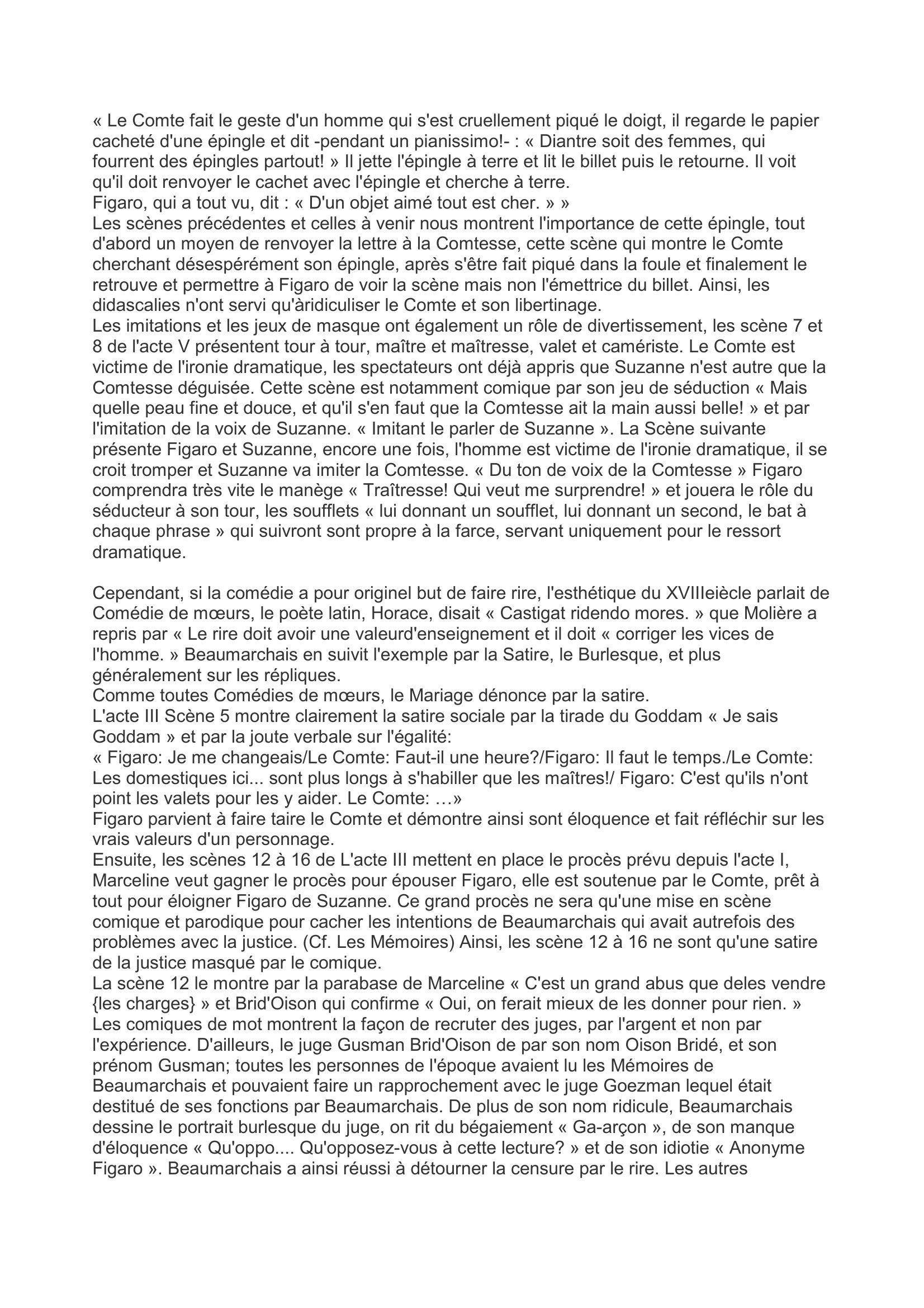Rire fait-il penser?
Publié le 07/10/2018
Extrait du document
La scène 15 de l'acte III montre une parodie d'un procès, les deux avocats se débattent sur la conjonction de coordination « ou » et la conjonction de subordination. « où ».
Ainsi, les scènes dresse la satire de la justice, le principe de recrutement, l'idiotie des recruteurs et du procès.
Enfin, la Scène 3 de l'acte V présente le monologue de Figaro, il parle un moment de laliberté d'expression. « Il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s’étend même à celles de la presse ; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni dé la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l’Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l’inspection de deux ou trois censeurs. » Ce comique de mots, dû à l'énumération et à l'hyperbole, montre un semblant de vérité, c'est un moment de parabase de Figaro, où Beaumarchais critique la censure et en échappe.
Cependant, il serait impensable de voir une comédie purement comique ou une comédie dont le comique ne servirait qu'à faire penser. Le Mariage de Figaro montre ainsi à la fois des comiques pour éviter de tomber dans le registre tragique et des comiques utiles pour masquer la censure et nous faire penser. La Commedia Dell'Arte même ne servait pas qu'à faire rire, le rôle du Vieux barbon, d'Arlequin, d'Isabella ou de Colombine sont des stéréotypes mais le valet du petit peuple renverse toujours le Vieux barbon, l'acteur italien Niccolô Barbieri de la Commedia Dell'Arte disait: « Les Comédiens étudient beaucoup et se munissent la mémoire d’une grandeprovision de choses[...] et leurs études sont en rapport avec les mœurs et les habitudes des personnages qu’ils représentent.» Les comédiens servaient à représenter le peuple et les mœurs de l'époque. Au XVIIIème siècle, Arlequin est renouvelé par Marivaux dans l'Île des esclaves: Alors qu'autrefois, il n'assurait qu'un rôle d'adjuvant, il acquiert maintenant un esprit et une conscience. Le conte théâtral philosophique présente Iphicrate, le maître, et Arlequin, le valet, qui échouent dans l'Île des esclaves, cette île est peuplée d'esclaves libres, et l'on échappe de cette île qu'en reconnaissant que les « hommes ne valent rien. » Arlequin donnera ainsi une leçon à son maître tyran, à la fois un Antonio à la bouteille de vin « j'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà ; j'en boirai les deux tiers, comme de raison, et puis je vous donnerai le reste. » et un Figaro défendant la cause des hommes. «Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi.»
«
« Le Comte fait le geste d'un homme qui s'est cruellement piqué le doigt, il regarde le papier
cacheté d'une épingle et dit -pendant un pianissimo!- : « Diantre soit des femmes, qui
fourrent des épingles partout! » Il jette l'épingle à terre et lit le billet puis le retourne.
Il voit
qu'il doit renvoyer le cachet avec l'épingle et cherche à terre.
Figaro, qui a tout vu, dit : « D'un objet aimé tout est cher.
» »
Les scènes précédentes et celles à venir nous montrent l'importance de cette épingle, tout
d'abord un moyen de renvoyer la lettre à la Comtesse, cette scène qui montre le Comte
cherchant désespérément son épingle, après s'être fait piqué dans la foule et finalement le
retrouve et permettre à Figaro de voir la scène mais non l'émettrice du billet.
Ainsi, les
didascalies n'ont servi qu'àridiculiser le Comte et son libertinage.
Les imitations et les jeux de masque ont également un rôle de divertissement, les scène 7 et
8 de l'acte V présentent tour à tour, maître et maîtresse, valet et camériste.
Le Comte est
victime de l'ironie dramatique, les spectateurs ont déjà appris que Suzanne n'est autre que la
Comtesse déguisée.
Cette scène est notamment comique par son jeu de séduction « Mais
quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la Comtesse ait la main aussi belle! » et par
l'imitation de la voix de Suzanne.
« Imitant le parler de Suzanne ».
La Scène suivante
présente Figaro et Suzanne, encore une fois, l'homme est victime de l'ironie dramatique, il se
croit tromper et Suzanne va imiter la Comtesse.
« Du ton de voix de la Comtesse » Figaro
comprendra très vite le manège « Traîtresse! Qui veut me surprendre! » et jouera le rôle du
séducteur à son tour, les soufflets « lui donnant un soufflet, lui donnant un second, le bat à
chaque phrase » qui suivront sont propre à la farce, servant uniquement pour le ressort
dramatique.
Cependant, si la comédie a pour originel but de faire rire, l'esthétique du XVIIIeiècle parlait de
Comédie de m œ urs, le poète latin, Horace, disait « Castigat ridendo mores.
» que Molière a
repris par « Le rire doit avoir une valeurd'enseignement et il doit « corriger les vices de
l'homme.
» Beaumarchais en suivit l'exemple par la Satire, le Burlesque, et plus
généralement sur les répliques.
Comme toutes Comédies de m œ urs, le Mariage dénonce par la satire.
L'acte III Scène 5 montre clairement la satire sociale par la tirade du Goddam « Je sais
Goddam » et par la joute verbale sur l'égalité:
« Figaro: Je me changeais/Le Comte: Faut-il une heure?/Figaro: Il faut le temps./Le Comte:
Les domestiques ici...
sont plus longs à s'habiller que les maîtres!/ Figaro: C'est qu'ils n'ont
point les valets pour les y aider.
Le Comte: …»
Figaro parvient à faire taire le Comte et démontre ainsi sont éloquence et fait réfléchir sur les
vrais valeurs d'un personnage.
Ensuite, les scènes 12 à 16 de L'acte III mettent en place le procès prévu depuis l'acte I,
Marceline veut gagner le procès pour épouser Figaro, elle est soutenue par le Comte, prêt à
tout pour éloigner Figaro de Suzanne.
Ce grand procès ne sera qu'une mise en scène
comique et parodique pour cacher les intentions de Beaumarchais qui avait autrefois des
problèmes avec la justice.
(Cf.
Les Mémoires) Ainsi, les scène 12 à 16 ne sont qu'une satire
de la justice masqué par le comique.
La scène 12 le montre par la parabase de Marceline « C'est un grand abus que deles vendre
{les charges} » et Brid'Oison qui confirme « Oui, on ferait mieux de les donner pour rien.
»
Les comiques de mot montrent la façon de recruter des juges, par l'argent et non par
l'expérience.
D'ailleurs, le juge Gusman Brid'Oison de par son nom Oison Bridé, et son
prénom Gusman; toutes les personnes de l'époque avaient lu les Mémoires de
Beaumarchais et pouvaient faire un rapprochement avec le juge Goezman lequel était
destitué de ses fonctions par Beaumarchais.
De plus de son nom ridicule, Beaumarchais
dessine le portrait burlesque du juge, on rit du bégaiement « Ga-arçon », de son manque
d'éloquence « Qu'oppo....
Qu'opposez-vous à cette lecture? » et de son idiotie « Anonyme
Figaro ».
Beaumarchais a ainsi réussi à détourner la censure par le rire.
Les autres.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En quoi peut on dire que Gargantua de Rabelais prête autant a rire qu’il donne à penser ?
- Le rire peut-il nous faire penser ?
- Faut-il penser a mal pour rire ?
- Rire Fait-Il Penser ?
- Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans l'exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique. Le Rire Bergson, Henri. Commentez cette citation.