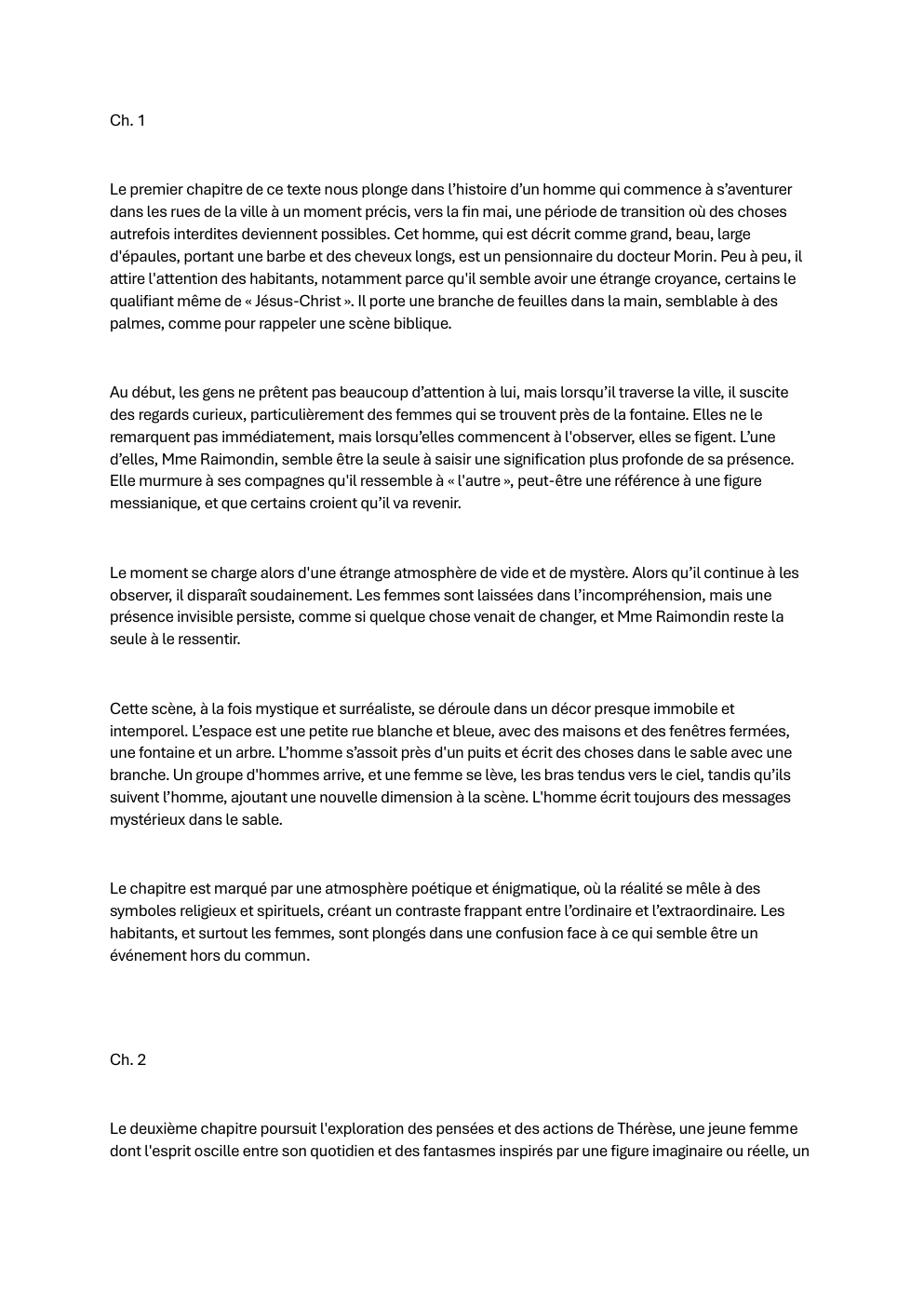Résume Ramuz l'amour du monde
Publié le 18/04/2025
Extrait du document
«
Ch.
1
Le premier chapitre de ce texte nous plonge dans l’histoire d’un homme qui commence à s’aventurer
dans les rues de la ville à un moment précis, vers la fin mai, une période de transition où des choses
autrefois interdites deviennent possibles.
Cet homme, qui est décrit comme grand, beau, large
d'épaules, portant une barbe et des cheveux longs, est un pensionnaire du docteur Morin.
Peu à peu, il
attire l'attention des habitants, notamment parce qu'il semble avoir une étrange croyance, certains le
qualifiant même de « Jésus-Christ ».
Il porte une branche de feuilles dans la main, semblable à des
palmes, comme pour rappeler une scène biblique.
Au début, les gens ne prêtent pas beaucoup d’attention à lui, mais lorsqu’il traverse la ville, il suscite
des regards curieux, particulièrement des femmes qui se trouvent près de la fontaine.
Elles ne le
remarquent pas immédiatement, mais lorsqu’elles commencent à l'observer, elles se figent.
L’une
d’elles, Mme Raimondin, semble être la seule à saisir une signification plus profonde de sa présence.
Elle murmure à ses compagnes qu'il ressemble à « l'autre », peut-être une référence à une figure
messianique, et que certains croient qu’il va revenir.
Le moment se charge alors d'une étrange atmosphère de vide et de mystère.
Alors qu’il continue à les
observer, il disparaît soudainement.
Les femmes sont laissées dans l’incompréhension, mais une
présence invisible persiste, comme si quelque chose venait de changer, et Mme Raimondin reste la
seule à le ressentir.
Cette scène, à la fois mystique et surréaliste, se déroule dans un décor presque immobile et
intemporel.
L’espace est une petite rue blanche et bleue, avec des maisons et des fenêtres fermées,
une fontaine et un arbre.
L’homme s’assoit près d'un puits et écrit des choses dans le sable avec une
branche.
Un groupe d'hommes arrive, et une femme se lève, les bras tendus vers le ciel, tandis qu’ils
suivent l’homme, ajoutant une nouvelle dimension à la scène.
L'homme écrit toujours des messages
mystérieux dans le sable.
Le chapitre est marqué par une atmosphère poétique et énigmatique, où la réalité se mêle à des
symboles religieux et spirituels, créant un contraste frappant entre l’ordinaire et l’extraordinaire.
Les
habitants, et surtout les femmes, sont plongés dans une confusion face à ce qui semble être un
événement hors du commun.
Ch.
2
Le deuxième chapitre poursuit l'exploration des pensées et des actions de Thérèse, une jeune femme
dont l'esprit oscille entre son quotidien et des fantasmes inspirés par une figure imaginaire ou réelle, un
autre modèle féminin, une sorte de "doppelgänger".
Ce chapitre est un mélange de descriptions
précises de ses gestes, de ses réflexions et de ses désirs.
Le soir, après que son père, M.
Panser, sergent-major de gendarmerie, soit parti pour ses activités
quotidiennes, Thérèse se retrouve seule.
Elle a l'habitude d'être seule jusqu'à dix heures, ce qui lui
permet de se retrouver dans une certaine intimité avec elle-même.
Elle entreprend des gestes
quotidiens : elle ferme la porte à clé, installe une lampe électrique et se regarde dans le miroir.
Dans
cette chambre simple, avec son papier fleuri et ses rideaux en fausse guipure crème, Thérèse semble
être en quête d'une transformation.
Elle est préoccupée par ses cheveux et son apparence, en
particulier par la comparaison qu'elle fait entre elle et une autre femme, une figure énigmatique et
séduisante.
Cette autre femme semble représenter la liberté et la beauté idéalisée, incarnant des traits
qu'elle désire ardemment adopter.
À travers des rêves et des visions, Thérèse s'imagine en train de s'élancer dans la mer, à la manière
d'une déesse ou d'une héroïne, conquérant l'élément liquide comme un acte de pouvoir.
Elle se
compare à cette figure, obsédée par ses propres cheveux et sa silhouette, des détails corporels qui
deviennent l'objet de ses préoccupations quotidiennes.
Thérèse est en pleine introspection, passant de
la contemplation de cette "autre" à une observation minutieuse de son propre corps, tout en se
maquillant et en polissant sa peau.
La métamorphose qu’elle cherche à réaliser se lit à travers ses
gestes : elle ajoute du rouge sur ses lèvres, utilise du fard pour ses yeux et polie ses bras avec de la
pierre ponce, cherchant à se faire aussi belle et désirable que l'autre femme de ses rêves.
Ce chapitre met en lumière la dualité entre la vie réelle de Thérèse, marquée par des gestes ordinaires,
et ses fantasmes et envies plus profonds, qu’elle nourrit en se projetant dans des rôles symboliques.
Elle devient une sorte de miroir de cette autre, que ce soit dans la solitude de sa chambre ou dans
l’espace mental qu’elle occupe, se transformant en une image idéalisée de la liberté et de la sensualité.
Sa transformation se déroule également sous l’œil d’un observateur extérieur, un "jeune premier" qui,
dans le même temps, achète un canot à moteur et se lance dans une aventure différente, mais
parallèle.
Enfin, Thérèse est prise entre deux mondes : le sien, qui est à la fois un univers quotidien et un lieu
d'introspection, et celui de cette figure mystérieuse, qui incarne une liberté qu’elle désire atteindre.
Elle
se perd dans l'idée d'un autre corps et se laisse envahir par la comparaison, tout en faisant des gestes
de beauté destinés à la rapprocher de cette image.
Ce chapitre présente ainsi une quête de soi
marquée par des fantasmes, une recherche d'identité et un besoin de transformation qui renvoie à des
préoccupations universelles d’apparence et de désir de transcender la réalité quotidienne.
Ch.
3
Le cadre de la petite ville
Le narrateur décrit une petite ville tranquille, avec une population de quatre à cinq mille habitants.
Cette ville se caractérise par son isolement, car bien que située sur la ligne des grands trains
internationaux, ces trains passent sans s’arrêter.
Les habitants de la ville sont principalement des
vignerons, ainsi que des personnes ayant des petits métiers ou des boutiques.
Ils mènent une vie
simple, centrée sur leurs besoins essentiels et apprécient particulièrement le plaisir de boire un verre
de vin entre amis.
Le quotidien est paisible, sans grande ambition matérielle, mais avec une volonté de
maintenir un juste équilibre.
Les enfants sont en bonne santé, les femmes sont d'humeur tranquille, et
les hommes font un peu de politique, mais pas de manière excessive.
Les habitants ne cherchent pas à comprendre ce qui se cache derrière les événements ou les
phénomènes qui les entourent.
Ils vivent simplement avec ce qu’ils ont, sans être dérangés par les
choses qu'ils ne peuvent pas percer, comme l'air, l'eau, la terre et la roche.
Ils considèrent que la
beauté du lieu, notamment la nature qui les entoure, est suffisante pour leur bonheur.
L'arrivée du changement
Le changement survient lorsqu'une société anonyme propose à la municipalité de louer une salle
communale, construite quelques années auparavant pour être utilisée par les sociétés locales.
Cependant, cette salle n’a jamais vraiment été utilisée car elle présente plusieurs inconvénients : elle
est mal chauffée, mal éclairée, mal située, trop grande et peu pratique.
Par conséquent, la plupart des
événements sociaux se tiennent ailleurs, dans un endroit plus convivial, le "Trois Chasseurs", où il est
également possible de boire et de manger.
La proposition de la société anonyme semble attrayante, car elle offre un loyer annuel de six mille
francs, ce qui représenterait un revenu....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Jeu de l’amour et du hasard 1730 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (résume et analyse complète)
- TOUT POUR L’AMOUR ou Le monde bien perdu (Résumé et analyse)
- Loin d'être un initiateur, André Chénier est la dernière expression d'un art expirant. C'est à lui qu'aboutissent le goût, l'idéal, la pensée du XVIIIe siècle. Il résume le style Louis XVI et l'esprit encyclopédique. Il est la fin d'un monde. Ce jugement d'un critique contemporain vous , paraît-il définir exactement la poésie d'André Chénier ?
- « Le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir profond de l'homme. Car il s'agit bien du même monde. La souffrance est la même, le mensonge et l'amour. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin et il n'est même jamais de si bouleversants héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion. »
- Tous les matins du monde est il un roman d'amour?