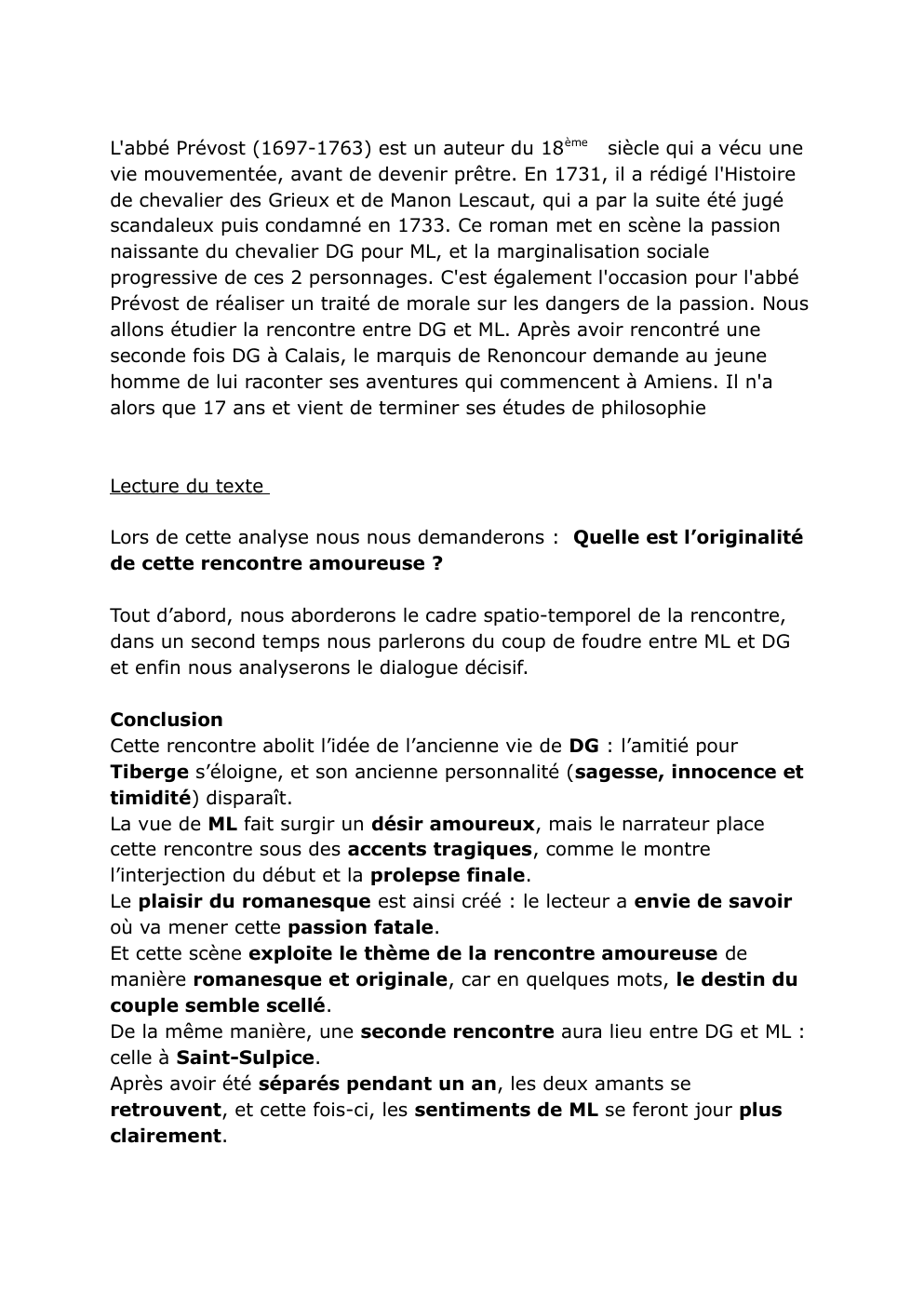rencontre manon et des grieux
Publié le 13/04/2025
Extrait du document
«
L'abbé Prévost (1697-1763) est un auteur du 18ème siècle qui a vécu une
vie mouvementée, avant de devenir prêtre.
En 1731, il a rédigé l'Histoire
de chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, qui a par la suite été jugé
scandaleux puis condamné en 1733.
Ce roman met en scène la passion
naissante du chevalier DG pour ML, et la marginalisation sociale
progressive de ces 2 personnages.
C'est également l'occasion pour l'abbé
Prévost de réaliser un traité de morale sur les dangers de la passion.
Nous
allons étudier la rencontre entre DG et ML.
Après avoir rencontré une
seconde fois DG à Calais, le marquis de Renoncour demande au jeune
homme de lui raconter ses aventures qui commencent à Amiens.
Il n'a
alors que 17 ans et vient de terminer ses études de philosophie
Lecture du texte
Lors de cette analyse nous nous demanderons : Quelle est l’originalité
de cette rencontre amoureuse ?
Tout d’abord, nous aborderons le cadre spatio-temporel de la rencontre,
dans un second temps nous parlerons du coup de foudre entre ML et DG
et enfin nous analyserons le dialogue décisif.
Conclusion
Cette rencontre abolit l’idée de l’ancienne vie de DG : l’amitié pour
Tiberge s’éloigne, et son ancienne personnalité (sagesse, innocence et
timidité) disparaît.
La vue de ML fait surgir un désir amoureux, mais le narrateur place
cette rencontre sous des accents tragiques, comme le montre
l’interjection du début et la prolepse finale.
Le plaisir du romanesque est ainsi créé : le lecteur a envie de savoir
où va mener cette passion fatale.
Et cette scène exploite le thème de la rencontre amoureuse de
manière romanesque et originale, car en quelques mots, le destin du
couple semble scellé.
De la même manière, une seconde rencontre aura lieu entre DG et ML :
celle à Saint-Sulpice.
Après avoir été séparés pendant un an, les deux amants se
retrouvent, et cette fois-ci, les sentiments de ML se feront jour plus
clairement.
Analyse linéaire :
1er mouvement – Le cadre spatio-temporel(l.
1 à 7)
📌 (L.1-2)
“j’avais marqué le temps de mon départ d’Amiens” “Hélas ! Que ne le
marquais-je un jour plus tôt !”
➔ 2 plus-que-parfait + ton grandiloquent sur la 2ème phrase >>>
DG entremêle le souvenir et le récit distancé
➔ (L.1) “Hélas” interjection + 2 tournures exclamatives >>> DG
dramatise le jour de la rencontre avec ML, souligne son regret et il ne
cache aucune émotion
➔ (L.1 et 5) “Amiens” “Arras” 2 noms de ville >>> pose un cadre
précis
➔ (L.1-3) “le temps” “un jour plus tôt” “la veille” champ lexical du
temps >>> cadre temporel précis
➔ (L.2-3) “j’aurais porté chez mon père toute mon innocence”
—> verbe au conditionnel passé >>> DG sous-entend que cette
rencontre va lui faire perdre sa naïveté + DG se présente comme
innocent et se pose en victime de cette rencontre >>> souligne le
regret de cette rencontre
📌 ➔ “toute mon innocence” expression polysémique >>> peut se
comprendre de 2 manières : par le jeune âge et par l’absence de péché
📌 (L.3-4) “je devais quitter cette ville” >>> expression de regret >>> le
destin du personnage semble scellé
📌 (L.4-5) “étant à me promener avec mon ami Tiberge, nous vîmes
arriver le coche d’Arras, et nous le suivîmes jusqu’à l’hôtellerie”
—> il souligne la valeur de l’amitié, et présente les différents
personnages de son roman
—> “nous” pronom personnel à la 2ème personne du pluriel >>> il
montre la complicité amicale qu’il a avec Tiberge
📌 (L.5-6) “le coche d’Arras” + “l’hôtellerie” + “voitures” détails de la
scène + “descendent” présent de vérité générale >>> ces détails
ancrent le récit dans un cadre urbain, une promenade dans la ville +
cela semble authentique
📌 (L.5-6) “nous vîmes arriver le coche d’Arras, et nous le suivîmes jusqu’à
l’hôtellerie où ces voitures descendirent” verbes au passé simple >>>
ils sont témoins d’une scène de rue
📌 (L.6-7) “nous n’avions pas d’autres motifs que la curiosité”
➔ explication motivant le rapprochement des 2 amis de ce coche : la
“curiosité”
➔ “ne…que” négation restrictive >>> il se justifie, se dédouane de
cette curiosité et de cette rencontre
📌 (L.7-8) “il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt”
➔ le narrateur montre le mouvement des femmes descendant du coche,
mais elles partent immédiatement
➔ “il en sortit” tournure impersonnelle + “quelques femmes”
déterminant indéfini >>> cela paraît comme une observation
anodine
➔ “sortit” “retirèrent” passé simple + “aussitôt” adverbe >>> créé un
effet curieux destiné à mettre en valeur ML, qui reste seule (elle est
déjà en marge des autres personnes de son âge)
le narrateur décrit un cadre spatio-temporel précis qui ancre le récit
dans la réalité.
Il décrit une promenade, et les 2 amis assistent ensuite à
une scène de rue, attirant le regard du narrateur
2ème mouvement – Le coup de foudre (l.7 à 17)
📌 (L.8) “Mais il en reste une, fort jeune, qui s’arrêta seule dans la cour”
➔ “Mais” conj.
de coordination d’opposition >> fait émerger une
femme, souligne la présence de ML
➔ “fort” adj intensif >>> insistance sur son jeune âge
➔ “qui s’arrêta” verbe au passé simple + antithèse avec “se retirèrent”
>>> son immobilité contraste avec l’agitation et le mouvement
d’arrière plan évoqué précédemment >>> elle se détache et n’agit pas
comme les autres
📌 (L.9-10) “pendant qu’un homme d’un âge avancé, qui paraissait lui
servir de conducteur, s’empressait pour faire tirer son équipage des
paniers”
➔ proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps
>>> description de l’arrière plan
➔ “paraissait” verbe d’état >>> le chevalier n’est plus un spectateur
passif, mais un spectateur omnibulé par cette femme
➔ chaque détail de la scène fait l’objet d’une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- rencontre de Manon et Des Grieux vue par Tiberge
- Rencontre Manon et Des Grieux
- HISTOIRE DU CHEVALIER DES GRIEUX ET DE MANON LESCAUT de L’abbé Prévost (résumé & analyse)
- Manon Lescaut [Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut] (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut (résumé & analyse)