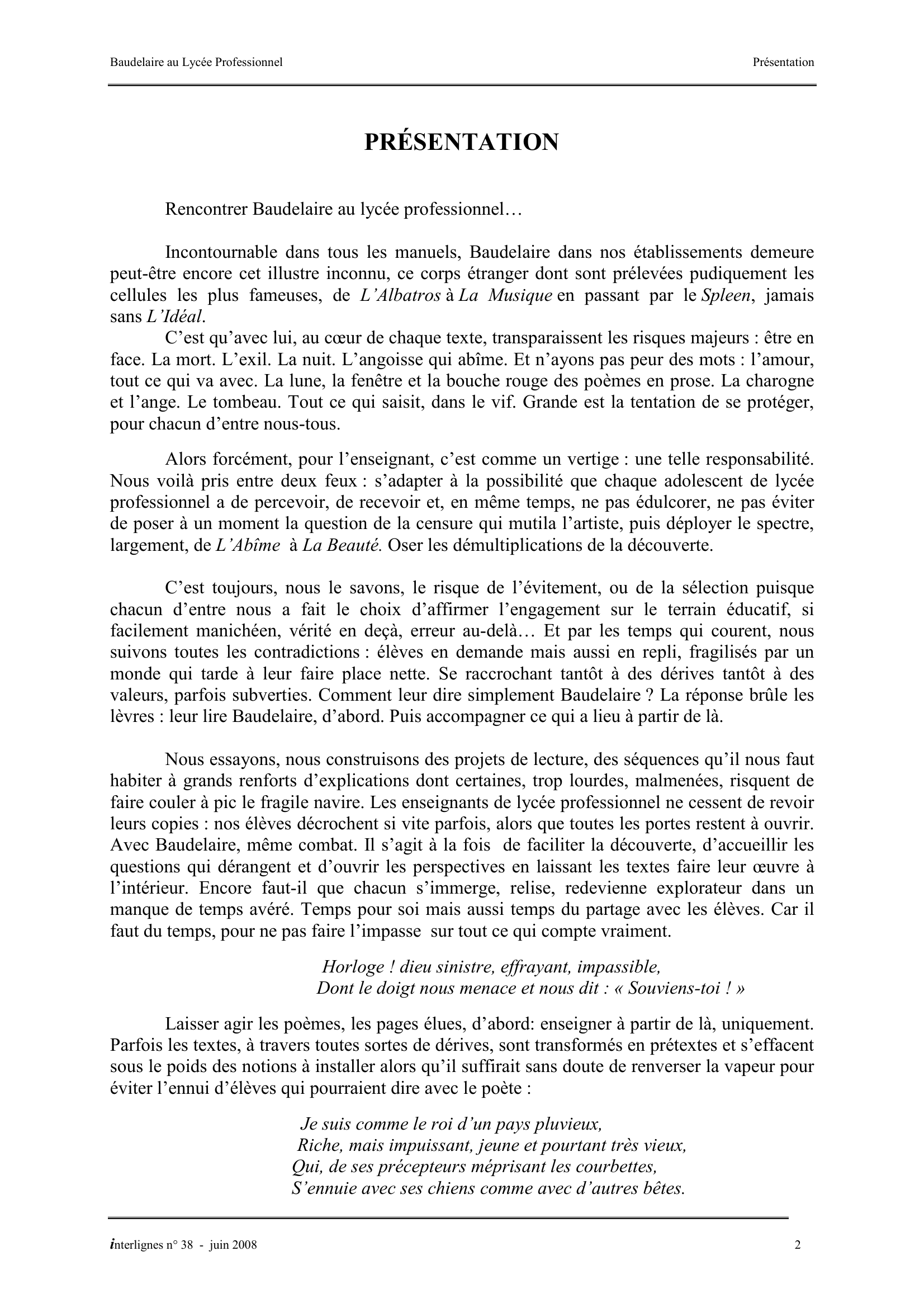Baudelaire au Lycée Professionnel SOMMAIRE Présentation Christine Eschenbrenner page 2 Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire Jacques Lucchesi page 5 L'oubli du chemin : une lecture du « Voyage » de Baudelaire Jacques Lucchesi page 13 De Baudelaire lu par Walter Benjamin François Bon page 16 L'Homme des foules François Bon page 18 Baudelaire, initiateur des écritures européennes Ludmilla Fermé page 23 Peut-on étudier Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire comme il y a dix ans ? Françoise Bollengier page 25 Lire un recueil de poésies du XIXe siècle Les Fleurs du Mal Commencer l'étude d'une oeuvre littéraire en « faisant vivre » l'écrivain disparu Joëlle Brouzeng page 35 D'un écrivain à l'autre Lecture croisée d'Edgar Poe et de Charles Baudelaire Christine Eschenbrenner page 46 Voyage au coeur d'une oeuvre poétique Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire Christine Eschenbrenner page 66 Du poème en prose au poème en vers L'exemple de La Belle Dorothée Christiane Rouyer page 70 Découvrir une autre facette du poète Baudelaire Aller au musée d'Orsay Suzanne Boudon page 75 Baudelaire : liens et liaisons Quelques choix en lignes pour interlignes Christine Eschenbrenner interlignes n° 38 - juin 2008 page 84 1 Baudelaire au Lycée Professionnel Présentation PRÉSENTATION Rencontrer Baudelaire au lycée professionnel... Incontournable dans tous les manuels, Baudelaire dans nos établissements demeure peut-être encore cet illustre inconnu, ce corps étranger dont sont prélevées pudiquement les cellules les plus fameuses, de L'Albatros à La Musique en passant par le Spleen, jamais sans L'Idéal. C'est qu'avec lui, au coeur de chaque texte, transparaissent les risques majeurs : être en face. La mort. L'exil. La nuit. L'angoisse qui abîme. Et n'ayons pas peur des mots : l'amour, tout ce qui va avec. La lune, la fenêtre et la bouche rouge des poèmes en prose. La charogne et l'ange. Le tombeau. Tout ce qui saisit, dans le vif. Grande est la tentation de se protéger, pour chacun d'entre nous-tous. Alors forcément, pour l'enseignant, c'est comme un vertige : une telle responsabilité. Nous voilà pris entre deux feux : s'adapter à la possibilité que chaque adolescent de lycée professionnel a de percevoir, de recevoir et, en même temps, ne pas édulcorer, ne pas éviter de poser à un moment la question de la censure qui mutila l'artiste, puis déployer le spectre, largement, de L'Abîme à La Beauté. Oser les démultiplications de la découverte. C'est toujours, nous le savons, le risque de l'évitement, ou de la sélection puisque chacun d'entre nous a fait le choix d'affirmer l'engagement sur le terrain éducatif, si facilement manichéen, vérité en deçà, erreur au-delà... Et par les temps qui courent, nous suivons toutes les contradictions : élèves en demande mais aussi en repli, fragilisés par un monde qui tarde à leur faire place nette. Se raccrochant tantôt à des dérives tantôt à des valeurs, parfois subverties. Comment leur dire simplement Baudelaire ? La réponse brûle les lèvres : leur lire Baudelaire, d'abord. Puis accompagner ce qui a lieu à partir de là. Nous essayons, nous construisons des projets de lecture, des séquences qu'il nous faut habiter à grands renforts d'explications dont certaines, trop lourdes, malmenées, risquent de faire couler à pic le fragile navire. Les enseignants de lycée professionnel ne cessent de revoir leurs copies : nos élèves décrochent si vite parfois, alors que toutes les portes restent à ouvrir. Avec Baudelaire, même combat. Il s'agit à la fois de faciliter la découverte, d'accueillir les questions qui dérangent et d'ouvrir les perspectives en laissant les textes faire leur oeuvre à l'intérieur. Encore faut-il que chacun s'immerge, relise, redevienne explorateur dans un manque de temps avéré. Temps pour soi mais aussi temps du partage avec les élèves. Car il faut du temps, pour ne pas faire l'impasse sur tout ce qui compte vraiment. Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, Dont le doigt nous menace et nous dit : « Souviens-toi ! » Laisser agir les poèmes, les pages élues, d'abord: enseigner à partir de là, uniquement. Parfois les textes, à travers toutes sortes de dérives, sont transformés en prétextes et s'effacent sous le poids des notions à installer alors qu'il suffirait sans doute de renverser la vapeur pour éviter l'ennui d'élèves qui pourraient dire avec le poète : Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, Qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes, S'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. interlignes n° 38 - juin 2008 2 Baudelaire au Lycée Professionnel Présentation Ce numéro d'interlignes convoque pour Baudelaire des expériences, des parcours réalisés, des projets vivants, des idées, des reprises, des approches différentes, des inventions qu'il ne faut cesser de nourrir dans le Laboratoire permanent de nos lycées professionnels. Pour cela, il faut du temps. Le temps d'approcher, le temps de lire et de faire lire. Le temps de donner à voir un visage - le portrait photographique tout en intensité de la collection Viollet ; le visage peint par Fantin-Latour dans l'angle droit du tableau Hommage à Delacroix; le Charles Baudelaire de Courbet absorbé par le livre. Et ce visage criant qui transparait dans chaque texte. Le temps d'opérer les rapprochements, du mot à l'image et réciproquement ; le temps d'éveiller Les Correspondances, le temps de répondre à L'Invitation au voyage. Le temps de retrouver le chemin du soulèvement dans Réversibilité. Le temps de faire un saut dans le temps et de voir comment s'opère la jonction, de Charles Baudelaire à Léo Ferré jusqu'à la reprise Charles et Léo par Jean-Louis Murat. De l'éclatement du Second Empire à aujourd'hui, quelles questions, quels nouveaux espaces et quels redéploiements ? Lire Baudelaire appelle tout cela. Le temps d'inventer de nouveaux voyages avec le poète sans trahir sa quête et celle des élèves à qui pourraient être soustraits, si l'on n'y prenait garde, tant de possibles. Le temps de prendre la juste mesure quand, à voix nue, François Bon donne à entendre Baudelaire dans l'enregistrement audio Comme un aboi farouche, les deux voix coïncidant à tel point qu'un élève fait cette remarque simple : « Quand on écoute l'enregistrement, on dirait que c'est Baudelaire lui-même qui parle en direct, comme à travers une brume ». Ce qui lui fait dire cela : la place de l'écoute, temps précieux, et menacé dans le grand fracas ambiant, et puis cette voix unique qui porte. Baudelaire nous entraîne sans relâche d'un lieu l'autre. Et nous nous retrouvons avec lui au coeur de la ville comme au coeur d'un rêve où tout se déplace douloureusement. Entraîner nos élèves jusque là, et à cela : découverte d'un espace, d'une musique, inaltérables. Paris change ! mais rien dans ma mélancolie N'a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Il est arrivé, lors d'une mémorable séquence, que ces vers, essentiels, soient appris par coeur, les élèves y découvrant un sens ardent pour eux, je me souviens. Un peu comme si le seul fait d'avoir en mémoire quatre vers représentait une clé pour la porte d'accès au monde symbolique, ancré dans le quotidien. À nos élèves habitants de la dalle et autres excroissances de la ville, Baudelaire lui-même répond : « C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant ». Encore des séquences à inventer, guidés par Baudelaire dans la multitude : « se promener et regarder ». Tant de fenêtres à ouvrir, depuis Les Fleurs du Mal jusqu'aux Petits Poèmes en prose, en passant par les éclats accessibles du Peintre de la vie moderne, ou en abordant comme autant de passerelles envisageables ces textes et traductions qui unissent Poe et Baudelaire. interlignes n° 38 - juin 2008 3 Baudelaire au Lycée Professionnel Présentation Ce numéro d'interlignes, au-delà des propositions de chaque enseignant et de l'hommage évident au poète, rappelle que Baudelaire est toujours force de proposition pour aujourd'hui. « J'aime passionnément le mystère parce que j'ai toujours l'espoir de le débrouiller », une telle phrase à elle seule pourrait représenter un sésame pour toute notre pédagogie... Avec Baudelaire, nos élèves peuvent se diriger vers un Ailleurs, dont l'oeuvre délivre le secret, lorsque le poète offre à qui veut bien suivre le mouvement « là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! » Christine ESCHENBRENNER Lycée polyvalent F. Léger, ARGENTEUIL Formatrice IUFM Ce numéro a été coordonné par Joëlle Brouzeng et Christine Eschenbrenner L'équipe d'interlignes remercie très vivement François Bon et Jacques Lucchesi pour leur précieuse et aimable collaboration. interlignes n° 38 - juin 2008 4 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire LE SENTIMENT DE LA VIEILLESSE DANS L'OEUVRE POÉTIQUE DE BAUDELAIRE Introduction Moins glosée, sans doute, que son « satanisme », la compassion -littéraire- de Baudelaire pour les déshérités n'est, cependant, plus à démontrer. Tout au long des Fleurs du Mal, comme du Spleen de Paris, reviennent ces figures de mendiants et d'enfants pauvres (mais aussi d'animaux tels l'âne ou le chien) auxquels le poète s'identifie peu ou prou, établissant avec eux un rapport de sympathie qui est, dans son essence, oppositionnel aux symboles de l'ordre bourgeois. En ce sens, Baudelaire ne fait que joindre sa voix au choeur des grands et des petits romantiques que domine Victor Hugo, son aîné admiré1 malgré des positions politiques peu à peu antagonistes. De cette galerie de portraits tristes et fraternels émergent singulièrement, tant par leur fréquence que leur intensité, ceux qui décrivent des gens âgés, principalement des vieilles femmes. On le sait : c'est à propos des Sept Vieillards et des Petites Vieilles qui lui furent dédiés et envoyés que Hugo, en 1859, parlera - le mot est devenu célèbre - d'un « frisson nouveau ». Mais Baudelaire multiplie aussi les notations poétiques sur son propre vieillissement2, de même que les représentations symboliquement en correspondance avec le déclin de la vie. Cette esthétique crépusculaire ne semble pas sans rapport avec une ébauche de philosophie regardant la démocratie et le « progrès à l'américaine » comme une décadence morale. Ce sont ces divers points que nous aborderons dans le cadre de cette étude. 1- LA FEMME ÂGÉE ET DÉSEXUALISÉE OU L'AFFECTION RETROUVÉE « La femme qu'on aime est celle qui ne jouit pas »3. Le mot de Baudelaire a connu un regain de célébrité sous la plume acerbe de Jean Paul Sartre dans l'essai brillant mais réducteur (au choix du destin) qu'il lui avait consacré. Ce processus d'idéalisation tendrait, selon Sartre, à établir une équation -critiquée- entre la froideur et la pureté. Mais, pour Baudelaire, la froideur n'est-elle pas finalement aussi détestable que la naturalité satisfaite ? Et si, assurément, la femme qu'il hait est celle qui ne souffre pas, c'est aussi celle-là qui l'attire et le fascine. 1 Car, malgré des traits caustiques dans Les Fusées, Baudelaire se reconnaissait dans le sentiment de charité que Hugo vouait aux pauvres gens. Il lui consacrera même un article très élogieux dans ses Réflexions sur quelquesuns de mes contemporains (C.F. la Pléiade, tome II), écrivant ainsi : « Victor Hugo était, dès le principe, l'homme le mieux doué, le plus visiblement élu pour exprimer par la poésie ce que j'appellerai le « mystère de la vie ». 2 Quiconque a tenu un exemplaire de Mon coeur mis à nu (Collection Le livre de poche) se souviendra de la photo de première de couverture où Baudelaire, quelques années avant sa mort, accuse un vieillissement tout à fait surprenant. Vieillissement prématuré qui n'est pas sans faire songer à celui d'Antonin Artaud dont le visage raviné de 1946 laisse l'observateur perplexe lorsqu'il le compare à celui, grave et élégant, qui caractérise les portraits faits avant son internement, en 1938. 3 Mot auquel fait écho, dans Mon coeur mis à nu, la virulente sentence : « La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable ». interlignes n° 38 - juin 2008 5 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire Non sans ironie, Le Fou et la Vénus (Le Spleen de Paris VII), qui dépeint un malheureux bouffon implorant une statue de déesse, résume assez bien cet aspect de la problématique baudelairienne. Après tout, si « l'affreuse juive au corps vendu »4 (Les Fleurs du Mal, XXXII) pouvait par « un pleur obtenu sans effort » « obscurcir la splendeur de ses froides prunelles », elle serait digne d'être aimée. Encore faudrait-il qu'elle versât moins de flamme que la « bizarre déité »5 de Sed non satiata (Les Fleurs du Mal XXVI). Que faire, dès lors, pour essayer de rétablir un équilibre ? Gémir, maudire, attaquer6 ? Espérer un jour, tel Le Revenant (Les Fleurs du Mal, LXIII), régner par l'effroi sur la femme désirée ? Situation qui peut, sous la pression de divers facteurs, être aussi réversible7 : ainsi La Belle Dorothée 8 (Le Spleen de Paris, XXV) qui se prostitue pour racheter sa jeune soeur de 11 ans -dévouement on ne peut plus méritoire pour Baudelaire- ou encore Sisina 9 (Les Fleurs du Mal LIX), galante amazone à l'âme charitable pour ses soupirants et qui pourrait constituer une sorte d'exception idéale. Et le poète de s'interroger, dans Ciel brouillé 10 (Les Fleurs du Mal, L), sur cette femme dangereuse : adorera-t-il aussi « sa neige et ses frimas » ? Oui, « c'est un dur métier que d'être belle femme » et, pour ceux qui subissent l'emprise de leur charme, une passion souvent funeste. Comment sortir de ce cercle infernal où la haine se renforce au brasier du désir ? Spinoza écrit dans L'Éthique 11 : « La pitié est la tristesse d'un mal qui est arrivé à un autre que nous imaginons être semblable à nous ». Ces femmes qui ne sont plus que « des âmes », « ces petites vieilles » (Les Fleurs du Mal, XCI) et ces « veuves » (Le Spleen de Paris, XIII) que Baudelaire suit et observe à leur insu lui révèlent une solitude au moins égale à la sienne. Elles lui apprennent surtout que la femme peut être aussi repoussée par tous et combien cet ostracisme psychologique est éprouvant pour elle : c'est d'ailleurs le sujet du Désespoir de la vieille (Le Spleen de Paris, II). De là peut s'ensuivre une communion dans la détresse qui n'exclut pas un sentiment paternel12 ; comme si le poète était le gardien d'un troupeau d'êtres souffrants. Les associations entre les vieilles femmes et les petits enfants ne manquent pas sous sa plume. Taille presque identique de leurs cercueils ; absence commune des dents et des cheveux ou encore, dans Les Petites Vieilles (Les Fleurs du Mal, XCL), ces deux vers à résonance platonicienne : « Il me semble toujours que cet être fragile S'en va tout doucement vers un nouveau berceau ». 4 Sara, une prostitué, peut-être celle qui lui transmit la syphilis. Jeanne Duval, l'amante, la « soeur », la « fille ». 6 Il faut rappeler l'étude de Jean-Pierre Richard sur Baudelaire (Poésie et profondeur, Le Seuil) et sa thèse du double sadisme visant « la trop froide » comme « la trop gaie » dans le but de rétablir un équilibre permettant la communication. En ce sens, la vieillesse parle pour la révélation d'un secret qui, par conséquent, n'a pas besoin d'être forcé. 7 Pour exemple, l'interrogation de Baudelaire dans le poème précisément intitulé Réversibilité (Les Fleurs du Mal, X LIV) : « Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse ? ». 8 Ainsi Baudelaire se brouilla avec Arsène Houssaye (à qui il avait pourtant dédié Le Spleen de Paris) après que celui-ci, alors directeur de La Revue Nationale, ait publié une version édulcorée de trois poèmes en prose dont La Belle Dorothée. Pour rappel, « son dos creux et sa gorge pointue » était devenu « les formes de son corps ». 9 Elisa Néri, amie de madame Sabatier. Et, par voie d'association, la révolutionnaire Théroigne de Méricourt. 10 Un des poèmes inspirés par la comédienne Marie Daubrun dont il fut vainement épris. 11 Chapitre De l'origine et de la nature des sentiments, proposition XVI. 12 Regard paternel qui n'exclut pas, non plus, un certain voyeurisme. Ainsi, dans Les Petites Vieilles : « Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins ». 5 interlignes n° 38 - juin 2008 6 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire Ce rapprochement des extrêmes n'empêche pas l'admiration pour le stoïcisme de ces « Èves octogénaires ». Ne sont-elles pas, en effet, autant d'exemples à méditer pour supporter sa propre souffrance d'exister ? Mais lorsque la curiosité reprend ses droits, elle se porte notamment sur les interfaces entre le monde extérieur et le monde intérieur, foyers de toutes les projections sentimentales. Un poème comme Les Fenêtres (Le Spleen de Paris, XXXV) illustre parfaitement la théorie esquissée dans Les Foules (Le Spleen de Paris, XII) selon laquelle l'esprit poétique peut vivre sur le mode imaginaire l'histoire de n'importe qui à sa convenance - en l'occurrence, celle d'une femme mûre, claustrée et laborieuse. Alors : « Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ? ». Contrairement à l'expérience cartésienne du cogito, celle de Baudelaire ne rejette nullement la sensation et l'illusion. Elle montre aussi les limites de son sentiment de pitié qui n'abolit les contours de son ego que pour mieux, dans un second temps, lui faire éprouver sa singularité. Il nous reste à examiner, dans le cadre de ce chapitre, une catégorie de femmes certainement plus ambiguë mais tout aussi significative de cette esthétique : la femme sur le retour d'âge, de quarante ans et plus. Ce sont de telles égéries qui inspirent des poèmes comme Le Monstre (Les Épaves, XII) ou Un Cheval de race (Le Spleen de Paris, XXXIX) : «Elle est bien laide. Elle est délicieuse pourtant ! ». Celle-là « aime comme on aime en automne ; on dirait que les approches de l'hiver allument dans son coeur un feu nouveau ». D'ailleurs, la femme vieillissante peut encore ranimer l'émoi devant la beauté. C'est le cas pour la grande et altière veuve (Les Veuves, déjà cité) qui traîne comme un boulet un gamin13 pour lequel elle restreint ses dépenses. Et la noblesse de son allure contraste autant avec la vulgarité de la foule qui se presse devant le kiosque à musique qu'avec le caractère capricieux de l'enfant. D'autres fois, comme dans Chant d'automne (Les Fleurs du Mal, LVI), c'est le poète qui demande à la femme aimée la tendresse et l'attention d'une mère. Peut-être pourra-t-elle ainsi apaiser l'angoisse que produit en lui le sentiment du temps inexorablement fuyant ? 2- LE REGARD NARCISSIQUE ET ANGOISSÉ SUR SON PROPRE DÉCLIN « Voilà que j'ai touché l'automne des idées » déclare Baudelaire dans L'Ennemi (Les Fleurs du Mal, X), énonçant, à la suite de diverses métaphores sur son art poétique, son horreur du « Temps qui mange la vie ». L'assertion a de quoi laisser perplexe si l'on tient compte que c'est un homme de trente ans qui l'avance. Pour rester dans le domaine des allégories saisonnières, tout se passe comme si Baudelaire n'avait pas eu d'été dans sa vie. Comme si, du printemps, -la jeunesse et sa versatilité-, il était directement entré dans l'automne et sa maturité frileuse. L'opposition Temps/Vie qui se dessine a des connotations mythologiques14 tant judéochrétienne -l'Eden, la Chute- que gréco-latine -dieu du Temps, Chronos mange, comme on le 13 L'enfance ne suggère pas à Baudelaire la tendresse et la complicité qu'elle inspire à Hugo, notamment dans L'Art d'être grand-père. Pour le poète des Fleurs du Mal, ce serait plutôt une curiosité empreinte de nostalgie. 14 En filigrane, ce sont aussi les vieilles oppositions philosophiques de l'Être (Parménide) et du Devenir (Héraclite). interlignes n° 38 - juin 2008 7 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire sait, ses enfants-. Elle renvoie à l'autre grande opposition baudelairienne du jour qui décroît et de la nuit qui augmente, ainsi que L'Horloge (Les Fleurs du Mal, LXXXV) nous le rappelle : « Souviens-toi que le Temps est un joueur avide15 Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c'est la loi. Le jour décroît ; la nuit augmente ; souviens-toi ! Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide. » Or, l'attrait indéniable du poète pour le crépuscule -figure métonymique du Temps- est aussi l'un des ferments avérés de son inspiration. Dans ces conditions, le Temps apparaît être le principe du désordre dans l'ordre cosmique, dissymétrie (selon le terme de Roger Caillois) d'où jaillit néanmoins, pour Baudelaire, la possibilité d'une double singularisation, existentielle (la révolte, le dandysme) et artistique (la quête passionnée du nouveau). C'est l'ambiguïté sempiternelle du Temps que d'être, à la fois, le constructeur et le dé-constructeur de tout être et de toute chose. Et privilégier un aspect sur l'autre relève, évidemment, de facteurs subjectifs. Cette conscience suraiguë que le poète a de lui-même et de sa valeur l'entraîne forcément à vouloir extraire fébrilement « l'or de la gangue de chaque minute » (L'Horloge, déjà cité). Mais c'est au risque de changer « l'or en fer/Et le paradis en enfer » (Alchimie de la douleur - Les Fleurs du Mal, LXXXI). Ou de devenir cet « Héautontimorouménos » (Les Fleurs du Mal, LXXXIII), vampire de son propre coeur. Une telle tension dialectique peut engendrer, on s'en doute bien, la lassitude et Le Goût du Néant (Les Fleurs du Mal », LXXX) où dormir « d'un sommeil de brute » est aussi une façon d'échapper -constat encore plus cruel !- au remords et à l'ennui qui semble figer le temps. Ce que Baudelaire exprime sans détours dans L'Examen de minuit (Les Épaves, VI) et dans À une heure du matin (Le Spleen de Paris », X). Mais « l'implacable Vie » rejaillira vite de la pendule (La Chambre double - Le Spleen de Paris, V). Et l'on voit bien ici le glissement et l'association Temps/Vie encore plus désespérante qui s'opèrent. Très tôt, Baudelaire a eu le sentiment d'un frein et d'un désaccord avec la vie immédiate. Cette relégation anticipée est le sujet même d'un poème, (Un Fantôme Les Fleurs du Mal, XXXVIII) : « Je suis comme un peintre qu'un Dieu moqueur Condamne à peindre, hélas ! sur les ténèbres ; Où, cuisinier aux appétits funèbres, Je fais bouillir et je mange mon coeur. » « Cloche fêlée » (Les Fleurs du Mal, LXXXIV) ou « Faux accord/Dans la divine symphonie » (L'Héautontimoroumenos, déjà cité) : les métaphores ne manquent pas, sous sa plume, pour exprimer son mal-confort. Mais pour l'approche qui nous occupe, la meilleure description que Baudelaire fait de lui-même, se trouve sans doute dans ces deux vers extraits de Spleen (Les Fleurs du mal, LXXVII) : « Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, Riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. » 15 Héraclite : « Le temps est un enfant qui joue au tric-trac : royauté d'un enfant ! » (fragment 52). interlignes n° 38 - juin 2008 8 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire Vers qui font d'ailleurs écho à l'alexandrin, célèbre entre tous, qui ouvre le poème précédent également titré Spleen : « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. » Souvenirs qui peuvent parfois lui donner l'impression d'être « plus lourds que des rocs » (Le Cygne - Les Fleurs du Mal, LXXXIX). Comment un tel sentiment de vieillesse -vu la relative jeunesse du poète- est-il possible ? Nous laissons à Simone de Beauvoir le soin d'une explication conclusive : « C'est parce que l'âge n'est pas vécu sur le mode du « pour soi », parce que nous n'en avons pas une expérience transparente qu'il est possible de se déclarer vieux de bonne heure ou de se croire jeune jusqu'à la fin ».16 3- SCÈNES DE DÉCLIN SYMBOLIQUE Ici, la délimitation du sujet peut paraître plus floue car -et d'aucuns penseront que cela vaut pour l'oeuvre toute entière- certains poèmes, plus que d'autres, offrent au lecteur plusieurs degrés de sens. Ainsi Les Sept Vieillards (Les Fleurs du Mal, XC) débute sur le mode anecdotique (Paris, la brume, la promenade matinale du poète), s'élève jusqu'au tableau allégorique (les vieillards menaçants et démultipliés) et exprime dans derniers les quatrains, une angoisse personnelle17. C'est sur le deuxième aspect, plus descriptif et impersonnel (quoique tout aussi subjectif) que nous voudrions porter notre regard. Il faut sans doute se reporter au poème V des Fleurs du Mal où Baudelaire laisse librecours à sa nostalgie d'une Antiquité idéalisée, dressant un constat sardonique sur la dégradation physique d'une espèce soumise au « dieu de l'Utile ». Opinion que nuance une touche d'optimisme dans la troisième et dernière partie du poème ; car : « Mais ces inventions de nos muses tardives N'empêcheront jamais les races maladives De rendre à la jeunesse un hommage profond. » Là, le décor est planté : cette époque est décadente avant la lettre18, ce qu'il faut, en connaissance de cause, accepter comme une fatalité19 et y trouver matière à une sublimation esthétique. Sublimation qui joue avec les inversions symboliques de façon très significative. Ainsi l'aube devient Le Crépuscule du matin20 (Les Fleurs du Mal, CIII) et « le sombre Paris », par voie de conséquence, ressemble à un « vieillard laborieux ». Ainsi, dans le célèbre sonnet Recueillement (Les Fleurs du Mal, XIII, 3ème édition), le long linceul 16 La Vieillesse, tome II, page 27. Et il en va de même pour Le voyage à Cythère (Les Fleurs du Mal, CXVI) 18 Perspective largement dégagée par Baudelaire. On sait quel intérêt ses épigones porteront, conjointement à l'occultisme, à la question des origines dans les dernières années du XIXème siècle. Citons, en particulier, René Ghil et sa vision, grandiose et scientiste, de l'évolution humaine qu'il mettra en poésie dans Le Dire des sangs. 19 Un poème comme Le Châtiment de l'orgueil (Les Fleurs du Mal, XVI), qui décrit la folie soudaine d'un théologien exalté, ne va pas dans le sens d'une incitation à la révolte contre la tradition judéo-chrétienne. De même que Les Hiboux (Les Fleurs du Mal, LXVII), symboles de la sagesse statique. 17 20 Littré : « Par abus, « crépuscule » se dit aussi pour la lumière qui précède le lever du soleil : il se nomme « aube ». » Même en faisant la part de la poésie, le choix de Baudelaire est significatif par son inclinaison. interlignes n° 38 - juin 2008 9 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire de la Nuit traîne à l'Orient, point cardinal traditionnellement positif en raison, bien sûr, du soleil qui s'y lève. Ou encore, dans le long et admirable poème Le Voyage (Les Fleurs du Mal, CXXVI), « l'égout », lieu d'aboutissement et de mort, désigne explicitement le vagin stérile sinon vicié- dans lequel va se perdre le « ruisseau » de la semence masculine. Mais la Beauté, à laquelle Baudelaire dédie un superbe sonnet (Les Fleurs du Mal, XVII) et un hymne éloquent (Les Fleurs du Mal, XXI), n'est-elle pas, à ses yeux, cette qualité qui réunit les contraires -le couchant et l'aurore- ? Pour cela, elle est comparée au vin qui revigore et apaise la souffrance des chiffonniers, des solitaires, des assassins et des amants. (Les Fleurs du Mal, CV à CVIII). D'autres fois, comme dans L'Irrémédiable21 (Les Fleurs du Mal, LXXXIV), Baudelaire peint avec ses mots des scènes catastrophiques. Plus délicats et philosophiques, les fameux sonnets de La Mort (Les Fleurs du Mal, CXXI à CXXIII) s'offrent au lecteur comme des variations imagées sur une réalité défiant toute connaissance. Mais le poète trouve aussi l'inspiration dans des oeuvres picturales en rapport avec ses goûts, tel « Le Tasse en prison » (Les Épaves, XVI) d'après Delacroix et son tableau du même titre. Cependant, un petit sonnet comme Le Portrait (dans Le Fantôme, déjà cité) nous parle du dépit qu'éprouve l'amant lorsqu'il compare le dessin de la femme aimée au souvenir vivace qu'il en garde. Certes, l'art ne peut qu'échouer quand on lui assigne de recréer la vie même. C'est manquer à son but qui est de créer un autre monde à partir du nôtre. Néanmoins, il reste un de nos moyens les plus spécifiques pour lutter contre la maladie et la mort, même si la mémoire peut sembler une alliée plus fidèle22. Là encore, il s'agit de repousser le Temps comparé à un « injurieux vieillard », « Noir assassin de la Vie et de l'Art ». Là non plus, les figures stylistiques de la vieillesse et de la vie ne sont pas fixées une fois pour toutes mais permutent de pôle en pôle, négatif ou positif. Pour Baudelaire, ce qui évoque le déclin insinue aussi la délectation, fût-elle morose. 4- LE MÉPRIS DU PROGRÈS À L'ÉCHELLE SOCIALE On connaît les diatribes de Baudelaire, dans ses journaux intimes, contre « l'absurdité du Progrès » et de « la Civilisation ne visant pas à diminuer un peu les traces du péché originel ». Dans ce qui semble être, de prime abord, un bric-à-brac de pensées et d'humeurs, on trouve, néanmoins, plusieurs constantes dont deux nous semblent ici importantes : la nostalgie d'une religion universelle et le culte de l'énergie. La première, en particulier, est à rechercher dans la lecture de Joseph De Maistre, farouche adversaire de la Révolution Française et de ses conséquences. Alors qu'un penseur comme Tocqueville (d'origine aristocratique, lui aussi) voit dans l'avancée de la démocratie et de l'égalitarisme un processus social positif et irréversible, De Maistre -et, à sa suite Baudelaire- ne trouve là que corruption morale et dégénérescence spirituelle. Entre platonisme et christianisme, De Maistre, dans Les Soirées de Saint-Pétersbourg, prend le radical contre-pied de l'optimisme post-révolutionnaire et des utopies, nombreuses en ce XIXème siècle, qui placent dans le futur l'Âge d'Or de l'Humanité. Pour lui, la grandeur de la 21 Malgré un préfixe et un caractère synonymique communs, L'Irrémédiable ne ressemble guère, dans sa structure comme par son sujet, à L'Irréparable (Les Fleurs du Mal, LIV). 22 Pensée qui se rapproche de l'ataraxie épicurienne : même dans les pires moments, le sage pourra être heureux par la remémoration des joies passées. interlignes n° 38 - juin 2008 10 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire science et de la civilisation se situe en amont, dans des temps très reculés. Le monde moderne se caractérise ainsi par un éloignement de la Vérité -une avec Dieu- et les signes de cette décadence ne manquent pas à ses yeux : maladies, chétivité des hommes actuels, dégradation du langage... Une telle philosophie incline au pessimisme le plus sombre, sans autre solution que la soumission totale aux lois divines. Évidemment, dans le système de De Maistre, l'ordre est une notion cardinale. À quoi Baudelaire fait écho lorsqu'il écrit, dans Les Fusées : « L'homme, c'est-à-dire chacun, est si naturellement dépravé qu'il souffre moins de l'abaissement universel que de l'établissement d'une hiérarchie raisonnable. » Si cette pensée, après tout, peut justifier par elle-même son droit de cité, il ne faut pas non plus évacuer le substrat psychologique de ceux qui s'en font les hérauts. Déchu de ses privilèges nobiliaires, De Maistre est un exilé qui parle, à sa façon, pour d'autres exclus dans lesquels Baudelaire (qui exècre autant les valeurs bourgeoises que l'insensibilité du peuple à la beauté) se reconnaît forcément. Le temps des poètes de cour est, en effet, révolu et c'est aux gazettes qu'il doit, comme Nerval et tant d'autres, vendre les articles qui complètent la maigre rente annuelle que lui verse sa famille après l'avoir fait déclarer prodigue. Ses démêlés avec la justice rebondiront, comme on le sait, avec la parution, en 1857, de la première édition des Fleurs du Mal. La même année, à l'issue du procès, six poèmes seront expurgés de l'oeuvre pour motif d'outrage à la morale publique et aux bonnes moeurs. Là encore, contraint et forcé, le poète devra faire acte de contrition auprès de l'impératrice, obtenant ainsi l'abaissement de son amende de 300 à 50 francs. Cette situation de soumission va, évidemment, attiser en retour la haine de Baudelaire contre une société où la bêtise progresse beaucoup plus vite que l'amélioration des conditions de vie de l'espèce. Quand, en 1861, il commence la rédaction de Mon coeur mis à nu (avec Rousseau pour modèle et adversaire) n'a-t-il pas déjà conscience qu'il va écrire « un livre de rancunes », comme il l'avouera plus tard dans une lettre à sa mère23 ? Là, pas d'opinion politique à proprement parler mais « des convictions qui ne peuvent être comprises par les gens de son temps ». Comme on est loin des barricades et des articles farouchement républicains qu'il écrivait, en 1848, dans La Tribune nationale et Le Salut public ! D'ailleurs, lorsque le poète se penche sur cette époque, il ne voit, pour justifier son enthousiasme, que « le goût de la vengeance et le plaisir de la démolition ». Cette attitude violente éclaire en partie le culte de l'énergie et du héros, thème nietzschéen avant la lettre qui parcourt maintes réflexions du Journal. Pour Baudelaire, en effet, « les nations n'ont de grands hommes que malgré elles » car la société s'oppose à toute élévation véritable24. À ses yeux, le seul progrès possible est celui qui naît de la valeur intrinsèque des individus ; sûrement pas « de la prise en charge de tous par tous » car cette mollesse n'engendre que la tyrannie. Régime qui, finalement, est celui qui convient le mieux au peuple : à l'extrême, « les dictateurs ne sont que ses pantins ». 23 « Je tournerai contre la France mon réel talent d'impertinence. J'ai besoin de vengeance comme un homme fatigué à besoin d'un bain ». (5 juin 1863). Mon Coeur mis à nu, que Baudelaire ne comptait publier que lorsque sa fortune serait convenable, resta en partie inachevé et ne parût pas de son vivant. 24 Nietzsche : « Un peuple et le détour que prend la nature pour produire six ou sept grands hommes - et ensuite pour s'en dispenser ». (Par delà bien et mal, maxime 126). interlignes n° 38 - juin 2008 11 Baudelaire au Lycée Professionnel Le sentiment de la vieillesse dans l'oeuvre poétique de Baudelaire En contrepoint apparaît le mythe du sauvage cher à la littérature du XVIIIème siècle. Les ombres de Rousseau et de Chateaubriand ne sont pas loin ; celle de De Maistre non plus, encore que Baudelaire donne au mot « sauvage » un sens moins alambiqué que l'auteur des Soirées...25. Ce vigoureux type humain, antithèse du civilisé débile, le poète croit le retrouver dans le nomade et, surtout, dans l'Indien, modèle que lui fournit Poe (et, moins spontanément, Longfellow) qu'il traduit. Où, sinon dans une époque et une société jugées décadentes, feraiton ces rêves d'éternelle jeunesse du monde ? Une des réactions les plus significatives de l'individu âgé est qu'il s'accroche à son passé et le sur-valorise à mesure que son futur potentiel diminue. Pour Baudelaire, esprit fourmillant de projets et qui n'a jamais été vieux, le passé en question est devenu peu à peu celui, philosophique, des idées. Une autre caractéristique de la vieillesse se trouve être, pour certains, leur besoin insatiable de nouveau. Cette exigence, on le sait, le poète l'a hautement revendiquée jusqu'à en faire l'emblème -et le moteur- de son art. Et il n'y a là qu'une contradiction aisément surmontable si on prend la mesure de l'écart existant entre l'art et la vie - entre Les Fleurs du Mal et Mon coeur mis à nu. Ce sont aussi les deux pôles de son profond mal-confort. À la fin des Fusées, on trouve une ébauche poétique des plus intéressantes, La Fin du monde qui annonce les fureurs de Léon Bloy et de Villiers de l'Isle-Adam. À lui seul, ce texte résume toute la pensée anti-progressiste de Baudelaire. Ici, la ruine ne viendra pas tant des nouvelles institutions politiques que de « l'avilissement des coeurs » et de « l'ardeur vers Plutus ». Ces lignes, qui commencent par le constat d'un affaiblissement de l'énergie vitale au niveau de l'espèce, se terminent par l'aveu d'une immense lassitude et de l'indifférence quant à la destination de toutes ces consciences. Indifférence qui est aussi la marque d'une différence absolue : différence d'où peut jaillir une fraternité de l'exclusion, encore que l'une ne réduise jamais l'autre. Ainsi « tout est pour le mieux dans le pire des mondes ».26 Jacques LUCCHESI (Étude initialement publiée aux Éditions Associatives CLAPAS) 25 ...« nous sommes précisément à l'homme primitif ce que le sauvage est à nous... : le barbare, qui est une espèce de moyenne proportionnelle entre l'homme civilisé et le sauvage, a pu et peut encore être civilisé par une religion quelconque ; mais le sauvage proprement dit ne l'a jamais été que par le christianisme. C'est un prodige du premier ordre, une espèce de rédemption, exclusivement réservée au véritable sacerdoce. » (Joseph De Maistre, Les Soirées de Saint-Pétersbourg », 2ème entretien). Le lecteur se sera fait une opinion sur la base de ces quelques lignes ; sinon qu'il aille au texte intégral. 26 Mot attribué à Schopenhauer qui paraphrasait ainsi la célèbre sentence de Leibniz « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. » interlignes n° 38 - juin 2008 12 Baudelaire au Lycée Professionnel L'oubli du chemin : une lecture du « Voyage » de Baudelaire L'OUBLI DU CHEMIN : UNE LECTURE DU « VOYAGE » DE BAUDELAIRE 126ème pièce dans l'ordre d'apparition des Fleurs du Mal, Le Voyage est sans aucun doute l'un des plus beaux et des plus philosophiques poèmes de Baudelaire. C'est aussi la pièce la plus longue du livre avec ses 144 alexandrins répartis en 37 quatrains et 8 sections. Écrite en février 1859, elle présente toutes les caractéristiques d'un testament spirituel. Qu'elle soit dédiée à Maxime Du Camp, photographe et grand voyageur, est hautement significatif de la part d'un poète à l'étroit dans ses rituels sédentaires, fussent-ils parisiens. La métaphore longuement, patiemment, filée du voyage va donc être le cadre -sinon le prétexte- pour exprimer, en des vers d'une assez rare densité, une esthétique inséparablement liée à sa vision de la vie. Elle se dévide ainsi selon un schéma temporel assez normatif qui va de l'enfance à la maturité puis la vieillesse. C'est d'ailleurs sur le ton de la confidence que débute le premier quatrain. Mais deux vers exclamatifs comme : « Ah ! Que le monde est grand à la clarté des lampes ! Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! » Donnent à cette expérience singulière une portée quasi-universelle. L'enthousiasme du départ, qui est aussi celui de la jeunesse, domine le ton de la première section, quitte à déboucher bien vite sur une forme de contrepoint mélancolique : « Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues » À n'en pas douter, c'est à cette catégorie qu'appartient le voyageur baudelairien. Ballotté par les flots à la recherche d'improbables Icaries, le voici donc jeté dans une dérive incessante. À chaque nouvel abordage, c'est un espoir qui s'éteint, révélant sa nature illusoire dans le heurt avec la dure réalité : « Amour... gloire... bonheur ! » Enfer ! C'est un écueil ! » Cependant, tel un vieil ivrogne honteux, notre homme veut encore y croire et persiste dans ses chimères au mépris de toute vérité. Son royaume à lui n'est pas, non plus, de ce monde. S'il connaît bien le charme vénéneux des Circé, il n'a pas, comme Ulysse, une Ithaque où l'attend une épouse fidèle. Il n'a pas, non plus, à l'instar du pieux pèlerin, un sanctuaire à honorer de l'autre côté de la terre. Il navigue sans boussole car le chemin qui est le sien est absent de toute carte, oublié depuis longtemps (si tant est qu'il en ait eu un). Sur lui semble peser, à l'instar du légendaire vaisseau fantôme, une mystérieuse malédiction qui le condamne à ne jamais parvenir à bon port. Et cependant, ce désastreux capitaine ne tire pas moins de ses errances une moisson de souvenirs. Le voici, malgré tout, riche d'une expérience enviable du monde. Les quatrains des sections III et IV ne laissent, sur ce point, planer aucun doute : « Étonnants voyageurs ! Quelles nobles histoires Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers ! » interlignes n° 38 - juin 2008 13 Baudelaire au Lycée Professionnel L'oubli du chemin : une lecture du « Voyage » de Baudelaire À ce niveau du poème, la parole change de pôle et ce n'est pas anodin. C'est toujours à la première personne du pluriel que Baudelaire poursuit son discours, mais sur un mode interrogatif qui met le premier narrateur en situation de transmission pour une hypothétique assemblée de jeunes curieux, eux qui ne voyageront jamais qu'en imagination : « Dites, qu'avez-vous vu ? » Sur ces esprits « tendus comme une toile », le film intérieur qui va se dévider porte en lui les promesses du futur cinématographe. Néanmoins, les évocations enchanteresses de leurs aînés vont encore se teinter assez vite de dépit. Aussi original et fastueux qu'il soit, le spectacle du monde ne peut détourner durablement de l'ennui l'homme baudelairien. À l'opposé, le désir, qui le travaille sans cesse, le fait irrémédiablement basculer dans l'inquiétude et ce n'est pas plus confortable. Cette acédia (que l'époque renommera spleen) réintroduit la notion morale de péché dans un contexte où elle ne manque pas de nous surprendre. À moins de comprendre que pour ce singulier explorateur, le monde est clos comme un bocal ; que l'inconnu tant espéré n'offre qu'un air de déjà-vu ; que l'autre, par conséquent, ne ramène jamais qu'au même : « Plusieurs religions semblables à la nôtre ». Changer de décor ne résout rien si c'est pour retrouver ailleurs sa propre image, surtout si elle est comparable à : « Un oasis d'horreur dans un désert d'ennui ! » Dans ces conditions, toute fuite, toute course à travers l'espace est vouée d'avance à l'échec. Partir ou rester, le dilemme initial, s'annule dans un « à quoi bon » qui met toute alternative dans une situation d'équivalence généralisée. Reste l'espace du dedans -celui des mangeurs d'opium- pour se délasser et s'étonner encore un peu des fantaisies de son esprit. De toute façon, le temps sera là aussi le plus fort. Pour Baudelaire, il n'a aucune faculté régénératrice, il est seulement cette avancée inexorable vers la mort. La mort : voilà sans doute la grande solution à ce mal-confort irrémédiable. Loin de la concevoir comme un pur néant où s'abolirait toute sensation -et donc toute souffrance-, le poète va la parer des séductions puisées dans sa culture mythologique. Sous sa plume, c'est « la mer des Ténèbres », cette étendue peuplée de spectres familiers et dévoués à tous ses désirs. C'est là que nous attendent ses Pylades et son Électre. C'est par-dessus tout ce suprême Inconnu -« Enfer ou Ciel, qu'importe ! »- propre à satisfaire inlassablement un appétit de nouveau que son voyage terrestre n'a pu apaiser. Alors que Dante, au terme de son périple dans l'autre monde, nous découvre le Paradis où l'a précédé Béatrice, Baudelaire ne nous concède que l'espérance d'un voyage sans fin. Mais un voyage où le désir aurait subsumé tout chemin et serait -ultime illusion- encore plus fort que la mort. Jacques LUCCHESI (Article publié dans la revue Diérèse n° 38) interlignes n° 38 - juin 2008 14 Baudelaire au Lycée Professionnel L'oubli du chemin : une lecture du « Voyage » de Baudelaire Jacques LUCCHESI Notice biographique de l'auteur Né en 1958. Journaliste et critique d'art depuis 1987. Nombreuses publications littéraires en revues. Une vingtaine de recueils et d'opuscules publiés chez divers éditeurs. Dernier titre paru : Les Hommes (essai, éditions Gros Textes, 2007) À paraître courant 2008 : Villes à venir (nouvelles, éditions du GRIL) Également éditeur associatif, conférencier et vidéaste amateur. interlignes n° 38 - juin 2008 15 Baudelaire au Lycée Professionnel De Baudelaire lu par Walter Benjamin DE BAUDELAIRE LU PAR WALTER BENJAMIN Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage... La fascination Baudelaire tient à un art particulier de la syncope et chant, d'un décalage neuf qui s'y instaure. La langue ne progresse pas en continu, elle le fait par sauts imprévus, qui s'accumulent. On les reconnaît chez La Fontaine ou Malherbe, on les reconnaîtra chez Rimbaud ou Apollinaire. Mais le maigre, le nerveux, l'angoissé Baudelaire nous offre une rupture encore plus majeure, un peu de la taille de celle de Rabelais ou de Proust : un basculement de force dans et par la langue, indissolublement lié aux contenus qu'elle apprend à charrier. Alors on y vient tous. Si Baudelaire nous brusque dans l'adolescence, et qu'il est bon d'en propager à cet âge le venin (« Verse nous ton poison pour qu'il nous réconforte »), c'est un accompagnement pour toujours ensuite : toujours révisable. Parce qu'il s'agit de toute façon d'une énigme très-obscure (en gardant ce trait d'union qui lui était cher) : cette façon particulière d'installer dans un tombé de l'avant le jeu des consonnes et voyelles. On a beaucoup écrit sur Baudelaire. Avec quelques sommets : principalement le texte que lui consacre Marcel Proust (ces quarante pages remplies de citations venues de tous les horizons de la poésie, de Racine à Vigny, d'Aubigné à Lamartine, et cette phrase tout à la fin : « On m'excusera d'éventuelles imprécisions, j'écris de mémoire, sur un lit d'hôpital... »). Mais celui qui renouvelle la présence aujourd'...