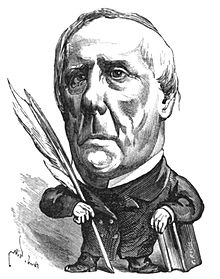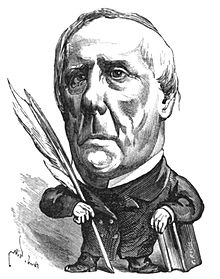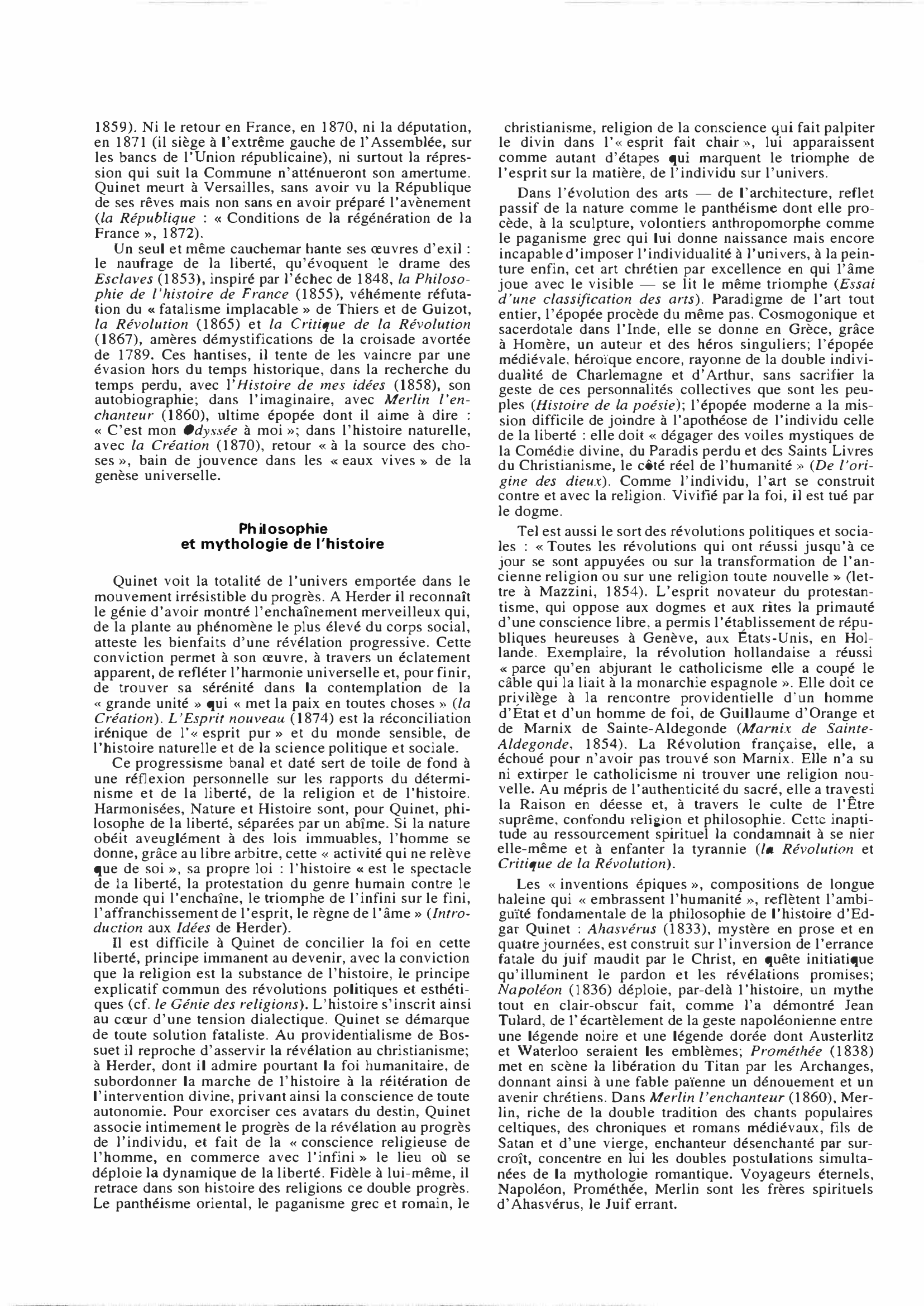QUINET Edgar (1803-1875). Aujourd’hui méconnu, Quinet pâtit d’une destinée posthume étrangement disproportionnée à l’ampleur d’une vie et d’une œuvre multiformes qui inquiètent autant qu’elles fascinent. Professeur, homme politique, historien, poète, Quinet nous entraîne, à travers l’histoire universelle, dans une errance fiévreuse qu'anime une convoitise de l’infini, signe en nous de la liberté.
Les chemins de la liberté
Enfant du siècle, il hérite de sa mère la rigueur du protestantisme genevois tempérée d'ironie voltairienne et d’un « enthousiasme » puisé dans le culte de Mme de Staël. A son père, soldat de la Révolution en 1792, commissaire des Guerres sous l’Empire, qui essaya d’oublier dans la passion pour la science sa haine à l'égard de l'Empereur, Quinet doit le ferment d’idées libérales qui lui permit de s'arracher à la légende napoléonienne.
Il naît à Bourg-en-Bresse, accomplit de brillantes études. Élève au collège de Bourg, puis au collège de Lyon, admissible dès 1820 à l’École polytechnique, il renonce néanmoins à la carrière scientifique qui ne lui inspire qu’ennui et dégoût et part pour Paris où il entreprend des études de droit, tout en se passionnant pour l’histoire et la poésie. 1825 est pour lui l’année des « illuminations » : Quinet rencontre Jules Michelet, son « frère de cœur et de pensée »; Victor Cousin, son idole provisoire, dont l’éclectisme ne tardera pas à lui apparaître comme une bâtarde apologie de la capitulation; il découvre surtout les Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité de Herder, dont il publie la traduction (1827-1828), précédée d'une longue Introduction qui est sa profession de foi historique. Attiré par l'Allemagne des Lumières et de la philosophie, il se rend, en 1827, à Heidelberg, pour un séjour de deux ans jalonné d’éblouissements intellectuels ei affectifs, première étape de ce pèlerinage à travers les patries spirituelles du romantisme qui le mène de la Grèce — qu'il découvre en 1829, ravagée par les guerres d'indépendance mais splendide dans son élan d’héroïsme libérateur (la Grèce moderne et ses rapports avec l'Antiquité, 1830; ouvrage refondu en 1857) — à l'Italie (1832-1833), où, plus encore que Rome et Naples, Venise le fascine : « J’aime tout d'ici, les pierres, l’eau, le ciel, les femmes [...]. C'est à en mourir de bonheur si c’était de cela que l’on meurt ». De cette initiation italienne naîtront, outre dont les premiers fragments paraissent en octobre 1833, un volume de notes dont les échos se prolongeront dans le Génie des religions (1841) et dans les Révolutions d'Italie (1848-1851).
La réalité est-elle la sœur du rêve? Quinet le croit un instant en 1830. L’annonce de la Révolution le surprend en Allemagne. Tout à son enthousiasme républicain, il franchit le Rhin pour arriver dans un Paris frémissant encore de l'« éclair de Juillet » : « Paris est vraiment
magnifique! Ce palais du roi écorché par la mitraille [...], tout ce flux de peuple rentré chez lui, mais qu’un rien remettrait en émoi, et ce divin drapeau tricolore qui flotte partout, ce sont des choses que nous n’espérions pas voir de notre vivant! » (lettre à sa mère, Paris, août 1830). Bientôt, pourtant, viennent les regrets : « Je ne me consolerai jamais de n’avoir pas marché avec les faubourgs! » et les illusions perdues : Louis-Philippe, roi d’une coterie, d'une bourgeoisie qui « ne voit plus », « n’entend plus la nation dont elle devrait être la parole vivante », « fait pis qu’oublier le peuple », il « s’en détourne ». Ironie du sort : c’est à cette monarchie abhorrée, qu’il malmène dans de violents pamphlets (« 1815 et 1840 », « Avertissement au pays », hostiles à la politique de Guizot), qu'Edgar Quinet doit la consécration universitaire. Pourvu en 1839 de la chaire de littérature étrangère à l’université de Lyon, il est nommé en 1841 à la chaire de langues et littératures méridionales au Collège de France, et devient rapidement, aux côtés de Michelet et de Mickiewicz, l'idole de la «jeunesse des écoles », l’apôtre des nationalités (Allemagne et Italie, 1839; le Rhin, 1841; les Révolutions d'Italie [première partie, parue en 1848]); il donne alors sa pleine mesure sur le double mode de la parole et de l’écriture, de l’histoire et de l'imaginaire. Dans le sillage d’une réflexion critique sur l’épopée (Des épopées françaises inédites du xiie siècle, 1831; Essai d'une classification des arts, thèse de doctorat soutenue à Strasbourg en 1839; De l'histoire de la poésie, 1836), il recrée, en une sorte de trilogie épique dont Ahasvérus (1833), Napoléon (1836), Prométhée (1838) sont autant de tableaux, « la tragédie universelle qui se joue entre Dieu, l'homme et le monde » — sujet par excellence de l’épopée moderne, qu’il veut humanitaire et religieuse. La religion est aussi l'inspiratrice d’un enseignement qui, du Génie des religions (1841) aux Jésuites (1843), de l'Ultramontanisme (1844) au Christianisme et la Révolution française (1845), se propose « d’embrasser la philosophie de la révélation » universelle. A travers l’aventure du Dieu fait homme, le christianisme, « idée la plus élevée du genre humain », a donné à l’histoire de l'humanité son modèle idéal de Passion, Mort et Résurrection. Mais le christianisme moderne, progressivement dégradé par le divorce de l’Église et de la Foi, dégénère. Tandis que l’Église romaine, pharisienne dans le jésuitisme, impérialiste dans l'ultramontanisme, esclave de la lettre et dépossédée de l’esprit chrétien, devient l’icône de la fatalité, la Révolution française inscrit dans la loi un Évangile de « liberté, égalité, fraternité ». Mais s’il s’affirme que « l’idéal de la Révolution est, à beaucoup d'égards, plus près du christianisme que ne l’est aujourd’hui l’Église », Quinet nous met en garde contre la tentation abusive, à laquelle cède notamment Michelet, de confondre État et Église, loi et dogme, assemblées et conciles. Cet anticléricalisme religieux attire à Quinet les foudres conjuguées du « parti prêtre », des libres penseurs et du gouvernement qui, en 1847, suspend définitivement de ses fonctions le professeur au Collège de France.
Après d’éphémères illusions, en 1848, sur le « génie divin des masses », Quinet poursuit, dans la lutte politique, son combat pour la liberté. Devenu député républicain de l'Ain, il réclame en 1850 la «séparation de l’école et de l’Église, de l’instituteur et du prêtre » et, avec l'Enseignement du peuple (1850), donne à la laïcité une « Défense et illustration » dont se souviendra Jules Ferry. Proscrit après le Deux-Décembre, il erre de la Belgique à la Suisse et, dans l’exil, grave ses « Châtiments » (le Livre de l'exilé, 1875). « Irréconciliable », il refuse, en 1859, l'amnistie offerte aux proscrits républicains : « Ceux qui ont besoin d'être amnistiés, ce ne sont pas les défenseurs des lois, ce sont ceux qui les renversent » (Protestation contre l'amnistie, 30 août 1859). Ni le retour en France, en 1870, ni la députation, en 1871 (il siège à l’extrême gauche de l'Assemblée, sur les bancs de l’Union républicaine), ni surtout la répression qui suit la Commune n’atténueront son amertume. Quinet meurt à Versailles, sans avoir vu la République de ses rêves mais non sans en avoir préparé l’avènement (la République : « Conditions de la régénération de la France », 1872).
Un seul et même cauchemar hante ses œuvres d’exil : le naufrage de la liberté, qu’évoquent le drame des Esclaves (1853), inspiré par l’échec de 1848, la Philosophie de l'histoire de France (1855), véhémente réfutation du « fatalisme implacable » de Thiers et de Guizot, la Révolution (1865) et la Critique de la Révolution (1867), amères démystifications de la croisade avortée de 1789. Ces hantises, il tente de les vaincre par une évasion hors du temps historique, dans la recherche du temps perdu, avec l'Histoire de mes idées (1858), son autobiographie; dans l’imaginaire, avec Merlin l'enchanteur (1860), ultime épopée dont il aime à dire : « C’est mon Odyssée à moi »; dans l’histoire naturelle, avec la Création (1870), retour «à la source des choses », bain de jouvence dans les « eaux vives » de la genèse universelle.
Philosophie et mythologie de l'histoire
Quinet voit la totalité de l’univers emportée dans le mouvement irrésistible du progrès. A Herder il reconnaît le génie d’avoir montré l’enchaînement merveilleux qui, de la plante au phénomène le plus élevé du corps social, atteste les bienfaits d’une révélation progressive. Cette conviction permet à son œuvre, à travers un éclatement apparent, de refléter l’harmonie universelle et, pour finir, de trouver sa sérénité dans la contemplation de la « grande unité » qui « met la paix en toutes choses » (la Création). L'Esprit nouveau (1874) est la réconciliation irénique de l’« esprit pur» et du monde sensible, de l’histoire naturelle et de la science politique et sociale.
Ce progressisme banal et daté sert de toile de fond à une réflexion personnelle sur les rapports du déterminisme et de la liberté, de la religion et de l’histoire. Harmonisées, Nature et Histoire sont, pour Quinet, philosophe de la liberté, séparées par un abîme. Si la nature obéit aveuglément à des lois immuables, l’homme se donne, grâce au libre arbitre, cette « activité qui ne relève que de soi », sa propre loi : l’histoire « est le spectacle de la liberté, la protestation du genre humain contre le monde qui l’enchaîne, le triomphe de l’infini sur le fini, l’affranchissement de l’esprit, le règne de l’âme » (Introduction aux Idées de Herder).
Il est difficile à Quinet de concilier la foi en cette liberté, principe immanent au devenir, avec la conviction que la religion est la substance de l’histoire, le principe explicatif commun des révolutions politiques et esthétiques (cf. le Génie des religions). L’histoire s’inscrit ainsi au cœur d’une tension dialectique. Quinet se démarque de toute solution fataliste. Au providentialisme de Bossuet il reproche d’asservir la révélation au christianisme; à Herder, dont il admire pourtant la foi humanitaire, de subordonner la marche de l’histoire à la réitération de l’intervention divine, privant ainsi la conscience de toute autonomie. Pour exorciser ces avatars du destin, Quinet associe intimement le progrès de la révélation au progrès de l’individu, et fait de la « conscience religieuse de l’homme, en commerce avec l’infini » le lieu où se déploie la dynamique de la liberté. Fidèle à lui-même, il retrace dans son histoire des religions ce double progrès. Le panthéisme oriental, le paganisme grec et romain, le