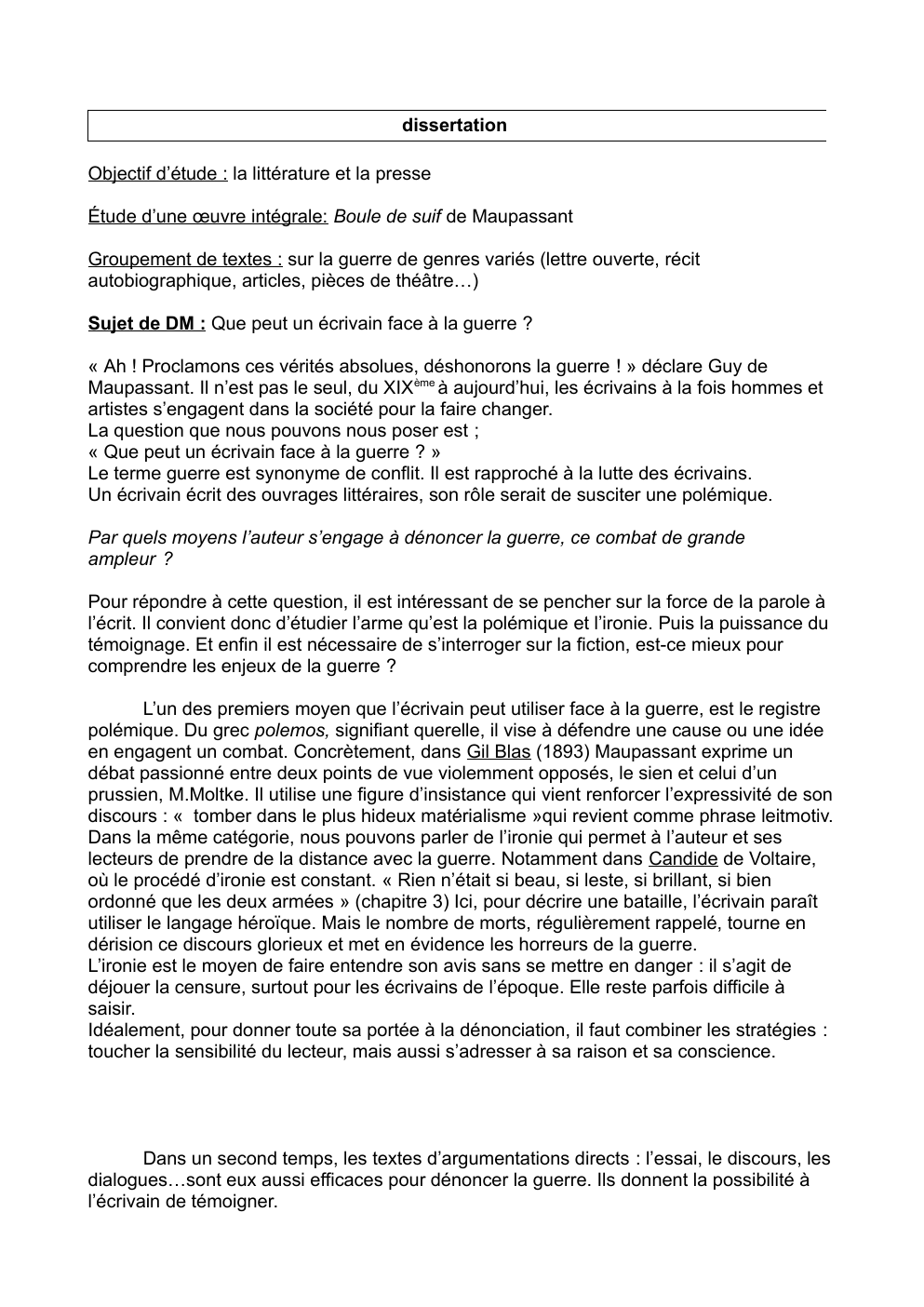Que peut un écrivain face à la guerre ?
Publié le 05/11/2022
Extrait du document
«
dissertation
Objectif d’étude : la littérature et la presse
Étude d’une œuvre intégrale: Boule de suif de Maupassant
Groupement de textes : sur la guerre de genres variés (lettre ouverte, récit
autobiographique, articles, pièces de théâtre…)
Sujet de DM : Que peut un écrivain face à la guerre ?
« Ah ! Proclamons ces vérités absolues, déshonorons la guerre ! » déclare Guy de
Maupassant.
Il n’est pas le seul, du XIX ème à aujourd’hui, les écrivains à la fois hommes et
artistes s’engagent dans la société pour la faire changer.
La question que nous pouvons nous poser est ;
« Que peut un écrivain face à la guerre ? »
Le terme guerre est synonyme de conflit.
Il est rapproché à la lutte des écrivains.
Un écrivain écrit des ouvrages littéraires, son rôle serait de susciter une polémique.
Par quels moyens l’auteur s’engage à dénoncer la guerre, ce combat de grande
ampleur ?
Pour répondre à cette question, il est intéressant de se pencher sur la force de la parole à
l’écrit.
Il convient donc d’étudier l’arme qu’est la polémique et l’ironie.
Puis la puissance du
témoignage.
Et enfin il est nécessaire de s’interroger sur la fiction, est-ce mieux pour
comprendre les enjeux de la guerre ?
L’un des premiers moyen que l’écrivain peut utiliser face à la guerre, est le registre
polémique.
Du grec polemos, signifiant querelle, il vise à défendre une cause ou une idée
en engagent un combat.
Concrètement, dans Gil Blas (1893) Maupassant exprime un
débat passionné entre deux points de vue violemment opposés, le sien et celui d’un
prussien, M.Moltke.
Il utilise une figure d’insistance qui vient renforcer l’expressivité de son
discours : « tomber dans le plus hideux matérialisme »qui revient comme phrase leitmotiv.
Dans la même catégorie, nous pouvons parler de l’ironie qui permet à l’auteur et ses
lecteurs de prendre de la distance avec la guerre.
Notamment dans Candide de Voltaire,
où le procédé d’ironie est constant.
« Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien
ordonné que les deux armées » (chapitre 3) Ici, pour décrire une bataille, l’écrivain paraît
utiliser le langage héroïque.
Mais le nombre de morts, régulièrement rappelé, tourne en
dérision ce discours glorieux et met en évidence les horreurs de la guerre.
L’ironie est le moyen de faire entendre son avis sans se mettre en danger : il s’agit de
déjouer la censure, surtout pour les écrivains de l’époque.
Elle reste parfois difficile à
saisir.
Idéalement, pour donner toute sa portée à la dénonciation, il faut combiner les stratégies :
toucher la sensibilité du lecteur, mais aussi s’adresser à sa raison et sa conscience.
Dans un second temps, les textes d’argumentations directs : l’essai, le discours, les
dialogues…sont eux aussi efficaces pour dénoncer la guerre.
Ils donnent la possibilité à
l’écrivain de témoigner.
L’expression « littérature de témoignage » désigne l’ensemble des œuvres où l’auteur
raconte des faits historiquement importants ou personnellement traumatisants dont il a été
le spectateur.
Dans ce genre littéraire, l’écrivain vivifie la réflexion par son implication
personnelle.
Pour cela, il dispose de moyens pour impliquer directement son lecteur :
Zola, dans sa lettre ouverte J’accuse où il s’adresse à la jeunesse par le biais de
l’apostrophe « Ô ».
Faire réfléchir, c’est aussi tenir compte de la dualité de son interlocuteur, être de raison et
d’émotion, recourir à des images fortes.
Dans le dialogue que nous avons....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quel Rôle pour l’Écrivain (et la Littérature) Face au Souvenir des années de plomb?
- Les États-Unis dans l'après-guerre par Roger Heacock Écrivain, Genève Qu'est-ce que les États-Unis en 1945 ?
- Jan Christiaan Smuts par Roger Heacock Écrivain, Genève Jan Christiaan Smuts fut le plus grand des hommes d'État et de guerre boers.
- Edith Cavell par Janet Adam Smith Elle a fait face aux horreurs de la guerre et de l'occupation allemande, en 1914, avec une activité courageuse et le plus bel esprit de sacrifice.
- l'engagement de l'écrivain, je suis neutraliste'j'hésite en face de l'engagement