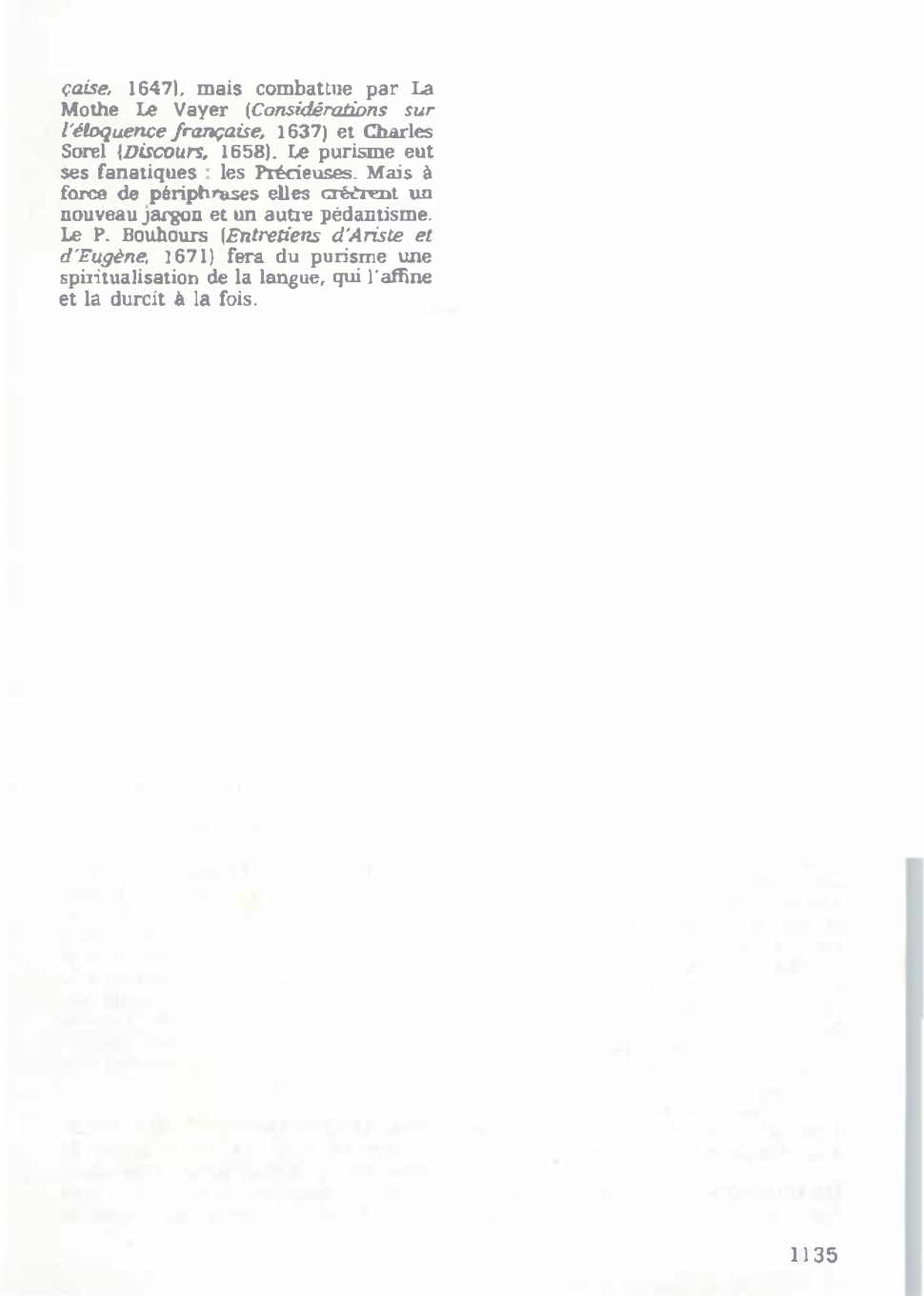PURISME
Publié le 17/03/2019
Extrait du document
«
çaise,
16471.
mais combattue par La
Mothe Le Vayer (Considérations sur
l'éloquence française, 1637) et Charles
Sorel (Discours, 1658).
Le purisme eut
ses fanatiques les Précieuses.
Mais à
force de périphrases ell es créèrent un
nouveau Jarg.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓