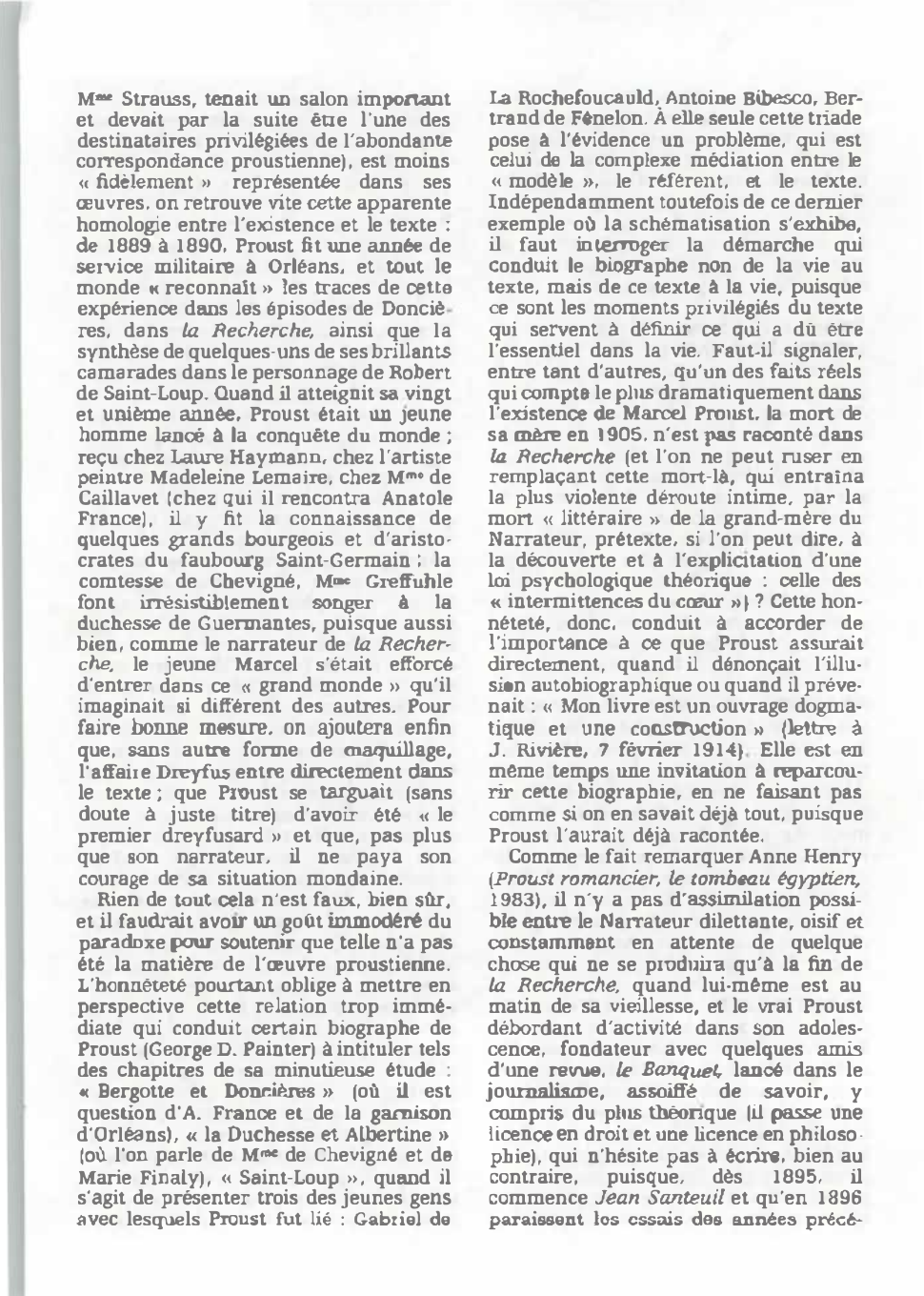PROUST (Marcel)
Publié le 17/03/2019
Extrait du document
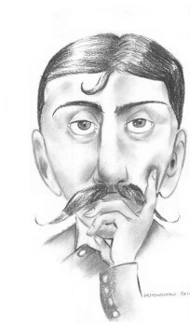
PROUST (Marcel), écrivain français (Paris 1871 - id. 1922). La vie de celui qui dissocia si nettement le moi de l'expérience et le moi de l'écriture a pourtant, avec toutes les médiations que l'on voudra, fourni la matière de son œuvre. De la tentative avortée de Jean Santeuil à la réalisation que constitue À la recherche du temps perdu, Proust a su de mieux en mieux choisir dans les matériaux qu'il avait à sa disposition, organisant les sensations et les souvenirs en vue d'une révélation ultime qui donne sens à ces moments émiettés et dispersés qui jusqu'au Temps retrouvé ne pouvaient trouver de loi conciliatrice. Sans même qu'on ait besoin de parler de cette œuvre comme d'une autobiographie fictive, on se plaît à souligner l'importance de la part du « vécu » dans le texte : le fils aîné, fragile et nerveux, du docteur Adrien Proust et de Jeanne Weil, grande bourgeoise juive, femme de culture, exigeante et belle, passa avec ses parents et son frère Robert de fréquentes vacances à Illiers, près de Chartres, que son panneau indicateur sous-titre aujourd'hui « Combray ». Quel écrivain « réaliste » du xix* s. n'eût souhaité pareille authentification ? L'épisode du baiser maternel que l'enfant attendait chaque soir avant de s'endormir, et qui forme un moment central de Jean Santeuil repris dans Du côté de chez Swann, eut pour théâtre, selon les biographes, la maison d'Auteuil qui servait aux Proust de « résidence secondaire » près de Paris, quand ils n'avaient pas le temps d'aller à Illiers. Asthmatique et constamment malade, Marcel fit de fréquents séjours à la montagne et à la mer, et Cabourg pourrait aussi se sous-titrer « Balbec ». Si la période lycéenne de Proust (études à Condorcet, entre 1882 et 1889), au cours de laquelle il noua des amitiés qui devaient servir sa carrière mondaine (avec Jacques Bizet notamment, dont la mère, Mme Strauss, tenait un salon important et devait par la suite être l'une des destinataires privilégiées de l'abondante correspondance proustienne), est moins « fidèlement » représentée dans ses œuvres, on retrouve vite cette apparente homologie entre l'existence et le texte : de 1889 à 1890, Proust fit une année de service militaire à Orléans, et tout le monde « reconnaît » les traces de cette expérience dans les épisodes de Donciè-res, dans la Recherche, ainsi que la synthèse de quelques-uns de ses brillants camarades dans le personnage de Robert de Saint-Loup. Quand il atteignit sa vingt et unième année, Proust était un jeune homme lancé à la conquête du monde ; reçu chez Laure Haymann, chez l'artiste peintre Madeleine Lemaire, chez Mme de Caillavet (chez qui il rencontra Anatole France), il y fit la connaissance de quelques grands bourgeois et d'aristocrates du faubourg Saint-Germain ; la comtesse de Chevigné, Mroc Greffuhle font irrésistiblement songer à la duchesse de Guermantes, puisque aussi bien, comme le narrateur de la Recherche, le jeune Marcel s'était efforcé d'entrer dans ce « grand monde » qu'il imaginait si différent des autres. Pour faire bonne mesure, on ajoutera enfin que, sans autre forme de maquillage, l'affaire Dreyfus entre directement dans le texte ; que Proust se targuait (sans doute à juste titre) d'avoir été « le premier dreyfusard » et que, pas plus que son narrateur, il ne paya son courage de sa situation mondaine.
Rien de tout cela n'est faux, bien sûr, et il faudrait avoir un goût immodéré du paradoxe pour soutenir que telle n'a pas été la matière de l'œuvre proustienne. L'honnêteté pourtant oblige à mettre en perspective cette relation trop immédiate qui conduit certain biographe de Proust (George D. Painter) à intituler tels des chapitres de sa minutieuse étude : « Bergotte et Doncières » (où il est question d'A. France et de la garnison d'Orléans), « la Duchesse et Albertine » (où l'on parle de M™ de Chevigné et de Marie Finaly), « Saint-Loup », quand il s'agit de présenter trois des jeunes gens avec lesquels Proust fut lié : Gabriel de
La Rochefoucauld, Antoine Bibesco, Bertrand de Fénelon. À elle seule cette triade pose à l'évidence un problème, qui est celui de la complexe médiation entre le « modèle », le référent, et le texte. Indépendamment toutefois de ce dernier exemple où la schématisation s'exhibe, il faut interroger la démarche qui conduit le biographe non de la vie au texte, mais de ce texte à la vie, puisque ce sont les moments privilégiés du texte qui servent à définir ce qui a dû être l'essentiel dans la vie. Faut-il signaler, entre tant d'autres, qu'un des faits réels qui compta le plus dramatiquement dans l'existence de Marcel Proust, la mort de sa mère en 1905, n'est pas raconté dans la Recherche (et l'on ne peut ruser en remplaçant cette mort-là, qui entraîna la plus violente déroute intime, par la mort « littéraire » de la grand-mère du Narrateur, prétexte, si l'on peut dire, à la découverte et à l'explicitation d'une loi psychologique théorique : celle des « intermittences du cœur ») ? Cette honnêteté, donc, conduit à accorder de l'importance à ce que Proust assurait directement, quand il dénonçait l'illusion autobiographique ou quand il prévenait : « Mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction » (lettre à J. Rivière, 7 février 1914). Elle est en même temps une invitation à reparcourir cette biographie, en ne faisant pas comme si on en savait déjà tout, puisque Proust l'aurait déjà racontée.
Comme le fait remarquer Anne Henry (Proust romancier, le tombeau égyptien, 1983), il n'y a pas d'assimilation possible entre le Narrateur dilettante, oisif et constamment en attente de quelque chose qui ne se produira qu'à la fin de la Recherche, quand lui-même est au matin de sa vieillesse, et le vrai Proust débordant d'activité dans son adolescence, fondateur avec quelques amis d'une revue, le Banquet, lancé dans le journalisme, assoiffé de savoir, y compris du plus théorique (il passe une licence en droit et une licence en philosophie), qui n'hésite pas à écrire, bien au contraire, puisque, dès 1895, il commence Jean Santeuil et qu'en 1896 paraissent les essais des années précé
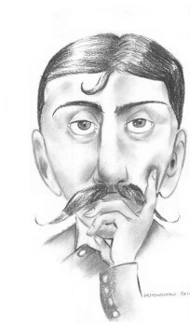
«
M ...
Strauss,
tenait un salon important
et devait par la suite être l'une des
destinataires privilégiées de l'abondante
correspondance proustienne), est moins
> représentée dans ses
œuvres.
on retrouve vite cette apparente
homologie entre l'existence et le texte :
do 1889 à 1890, Proust fit une année de
service militaire à Orlêans, et tout le
monde > les traces de cette
expêrience dans los 6pisodes de Donciè
res, dans la Recherche, ainsi que la
synthèse de quelques-uns de ses brillants
camarades dans le personnage de Robert
de Saint-Loup.
Quand il atteignit sa vingt
et unième année, Proust était un Jeune
homme lancé à la conquête du monde ;
reçu chez Laure Haymann, chez l'artiste
peintre Madeleine Lemaire, chez Mm• de
Caillavet (chez qui il rencontra Anatole
France), il y fit la connaissance de
quelques grands bourgeois et d'aristo
crates du faubour� Saint-Germain ; la
comtesse de Chevtgné, M-Greffuhle
f o n t irré sistibl em ent songer è la
duchesse de Guermantes, puisque aussi
bien, co=e le narrateur de la Recher
che, le jeune Marcel s'était efforcé
d'entrer dans ce «grand monde >> qu'il
imaginait si différent des autres.
Pour
faire bonne mesure.
on ajoutera enfin
que, sans autre forme de maquill age,
l'affaire Dreyfus emre directement dans
le texte ; que Proust se targuait (sans
doute à juste titre) d'avoir été « le
p rem ie r dreyfusard >> et que, pas plus
que son narrateur.
il ne paya son
courage de sa situation mondaine.
Rien de tout cela n'est fa ux , bien sftr,
et il fa udrai t avotr un goOt immodéré du
p ara doxe pour soutenir que telle n'a pas
été la matière de l'œuvre proustienne.
L'honnêteté pourtan t oblige à mettre en
pers pectiv e cette relat ion trop immé·
diate qui conduit certain biographe de
Proust (George D.
Painter) à intituJer tels
des chapitres de sa minutieuse étude :
« Bergotte et Doncières » (où il est
question d'A.
France et de la garnison
d'Orlêans).
« la Duchesse et Albertine >>
(où l'on parle de M100 de Chevigné et do
Marie Finaly), «Saint-Loup >>, quand il
s'agit de présenter trois des jeunes gens
Avec lesquels Proust fut lié : Gabriel de La
RochefoucauJd, Antoine Bibesco, Ber·
trand de Fé nelo n .
À elle seuJe cette triade
pose à l'évidence un problème, qui est
celui do la complexe médiation entre le
« modè le », le référent, et le texte.
Indépendamment toutefois de ce dernier
exemple où la schématisation s'exhibe,
il faut interroger la démarche qui
condwt le biographe non de la vie au
texte, mais de ce texte à la vie, puisque
ce sont les moments privilégiés du texte
qui servent à définir ce qui a dü être
l'essentiel dans la vie.
Faut�il signaler,
entre tant d'autres, qu'un des faits réels
qui compte le plus dramatiquement dans
l'existence de Marcel Pro us t.
la mort de
s a mère en 1905, n'est pas raconté dans
la Recherche (et l'on ne peut ruser en
rem plaçant cette mort-là, qui entraîna
la plu s violente déro ute intime, par la
mort « littéraire » de la grand-mère du
Narrateur, prétexte, si l'on peut dire, à
la découverte et à l'explicitation d'une
loi psychologique théorique : celle des
« intermittences du cœur »1? Cette hon·
nêteté, donc, conduit à accorder de
l'importance à ce que Proust assurait
directement.
quand il d6nonçait l'illu·
sion autobiographlque ou quand il préve
nait : « Mon livre est un ouvrage dogma·
tique et une construction » (lettre à
J.
Rivière, 7 février 1914) Elle est en
meme temps une inviteuon à repar cou
rir cet te biographle, en ne faisant pas
comme si on en savait déjà tout, puisque
Proust l'aurait déjà racontée.
Comme le fait remarquer Anne Henry
(Proust romancier, le tombeau égyptien,
1983), il n·y a pas d'assimil ation possi
ble entre Je Narrateur dilettante, oisif et
constamment en attente de quelque
chose qui ne se produira qu'à la fin de
la Recherche.
quand lui-même est au
matin de sa vieillesse, et le vrai Proust
débordant d'activité dans son adoles
cence, fondateur avec quelques amis
d'une revue.
le Banquet, lancé dans le
journalisme, assoiffé de savoir, y
compris du plus théonque (LI passe une
licence en droit et une licence en philoso
phle), qui n'hésite pas è écrire, bien au
contraire, puisque.
dès 1895.
il
commence Jean Santeuil et qu'en 1896
paraissent los osso.is des anné es prée�-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CONTRE SAINTE-BEUVE Marcel Proust (résumé & analyse)
- FRANÇOISE. Personnage de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust
- Le personnage de BLOCH Albert de Marcel Proust
- A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU de Marcel Proust
- GUERMANTES Oriane, duchesse de. Personnage de A la Recherche dU temps perdu de Marcel Proust