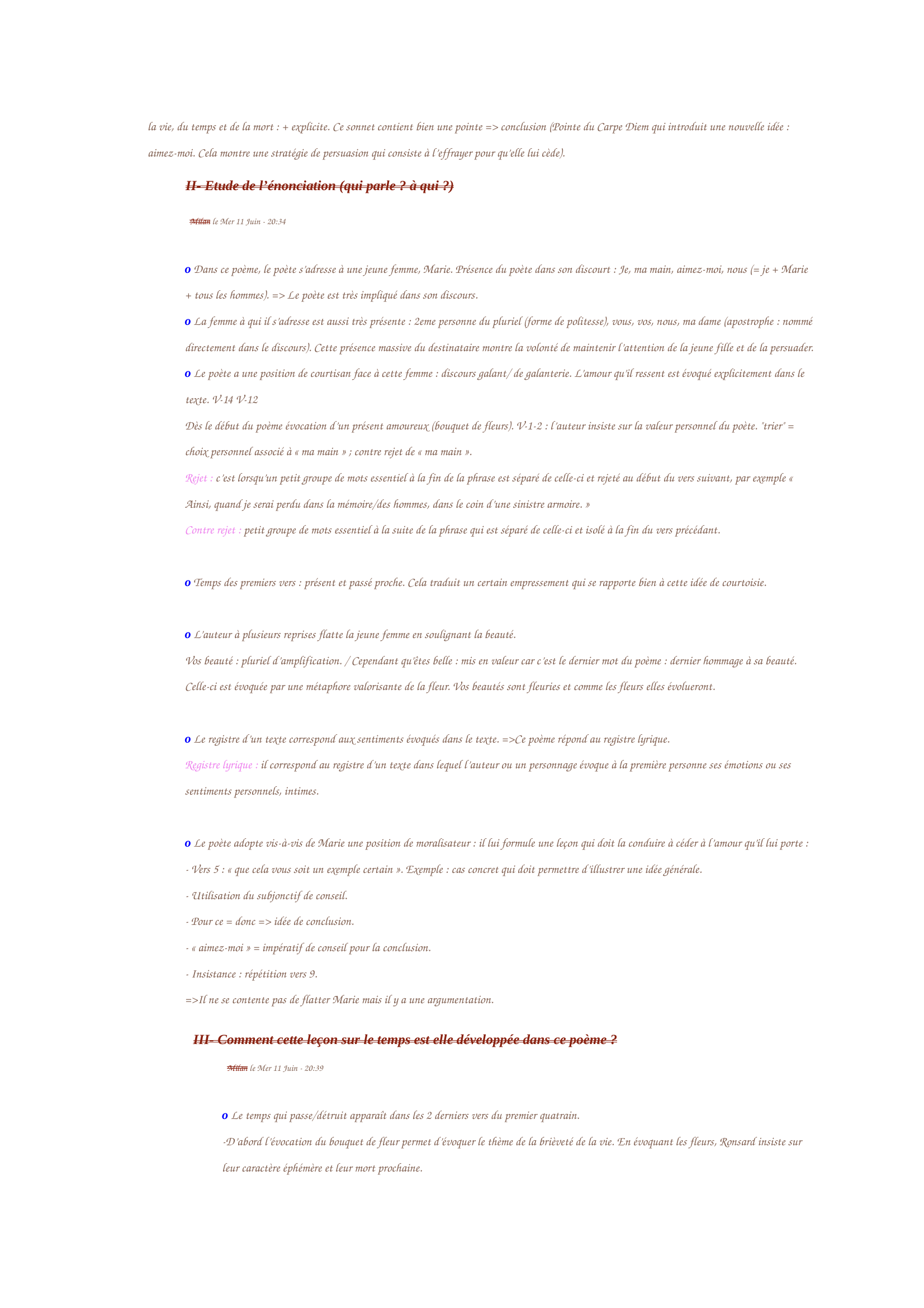poeme sonnet a marie
Publié le 11/05/2013
Extrait du document
«
la vie, du temps et de la mort : + explicite. Ce sonnet contient bien une pointe => conclusion (Pointe du Carpe Diem qui introduit une nouvelle idée :
aimezmoi. Cela montre une strat
égie de persuasion qui consiste à l’effrayer pour qu’elle lui c ède).
II- Etude de l’énonciation (qui parle ? à qui ?)
Milan le Mer 11 Juin 20:34
o Dans ce po
ème, le po ète s’adresse à une jeune femme, Marie. Pr ésence du po ète dans son discourt : Je, ma main, aimezmoi, nous (= je + Marie
+ tous les hommes). => Le po
ète est tr ès impliqu é dans son discours.
o La femme
à qui il s’adresse est aussi tr ès pr ésente : 2eme personne du pluriel (forme de politesse), vous, vos, nous, ma dame (apostrophe : nomm é
directement dans le discours). Cette pr
ésence massive du destinataire montre la volont é de maintenir l’attention de la jeune fille et de la persuader.
o Le po
ète a une position de courtisan face à cette femme : discours galant/ de galanterie. L’amour qu’il ressent est évoqu é explicitement dans le
texte. V14 V12
D
ès le d ébut du po ème évocation d’un pr ésent amoureux (bouquet de fleurs). V12 : l’auteur insiste sur la valeur personnel du po ète. "trier" =
choix personnel associ
é à « ma main » ; contre rejet de « ma main ».
Rejet : c’est lorsqu’un petit groupe de mots essentiel
à la fin de la phrase est s éparé de celleci et rejet é au d ébut du vers suivant, par exemple «
Ainsi, quand je serai perdu dans la m
émoire/des hommes, dans le coin d’une sinistre armoire. »
Contre rejet : petit groupe de mots essentiel
à la suite de la phrase qui est s éparé de celleci et isol é à la fin du vers pr écédant.
o Temps des premiers vers : pr
ésent et pass é proche. Cela traduit un certain empressement qui se rapporte bien à cette id ée de courtoisie.
o L’auteur
à plusieurs reprises flatte la jeune femme en soulignant la beaut é.
Vos beaut
é : pluriel d’amplification. / Cependant qu’ êtes belle : mis en valeur car c’est le dernier mot du po ème : dernier hommage à sa beaut é.
Celleci est évoqu ée par une m étaphore valorisante de la fleur. Vos beaut és sont fleuries et comme les fleurs elles évolueront. o Le registre d’un texte correspond aux sentiments évoqu és dans le texte. =>Ce po ème r épond au registre lyrique. Registre lyrique : il correspond au registre d’un texte dans lequel l’auteur ou un personnage évoque à la premi ère personne ses émotions ou ses sentiments personnels, intimes. o Le po ète adopte vis àvis de Marie une position de moralisateur : il lui formule une le çon qui doit la conduire à céder à l’amour qu’il lui porte : Vers 5 : « que cela vous soit un exemple certain ». Exemple : cas concret qui doit permettre d’illustrer une id ée générale. Utilisation du subjonctif de conseil. Pour ce = donc => id ée de conclusion. « aimezmoi » = imp ératif de conseil pour la conclusion. Insistance : r épétition vers 9. =>Il ne se contente pas de flatter Marie mais il y a une argumentation. III- Comment cette leçon sur le temps est elle développée dans ce poème ? Milan le Mer 11 Juin 20:39 o Le temps qui passe/d étruit appara ît dans les 2 derniers vers du premier quatrain. D’abord l’ évocation du bouquet de fleur permet d’ évoquer le th ème de la bri èveté de la vie. En évoquant les fleurs, Ronsard insiste sur leur caract ère éphémère et leur mort prochaine. . »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire du Sonnet à Marie de Ronsard
- Sonnet à Marie de Ronsard (Commentaire)
- Explication Regrets, Sonnet 53
- Commentaire: Comment à travers ce sonnet, Ronsard exprime-t-il sa passion à sa Dame ?
- La bataille On entendit des craquements et des cliquetis à l'intérieur du meuble, et Marie vit s'ouvrir brusquement les couvercles de toutes les boîtes où étaient cantonnées pour la nuit les troupes de Fritz.