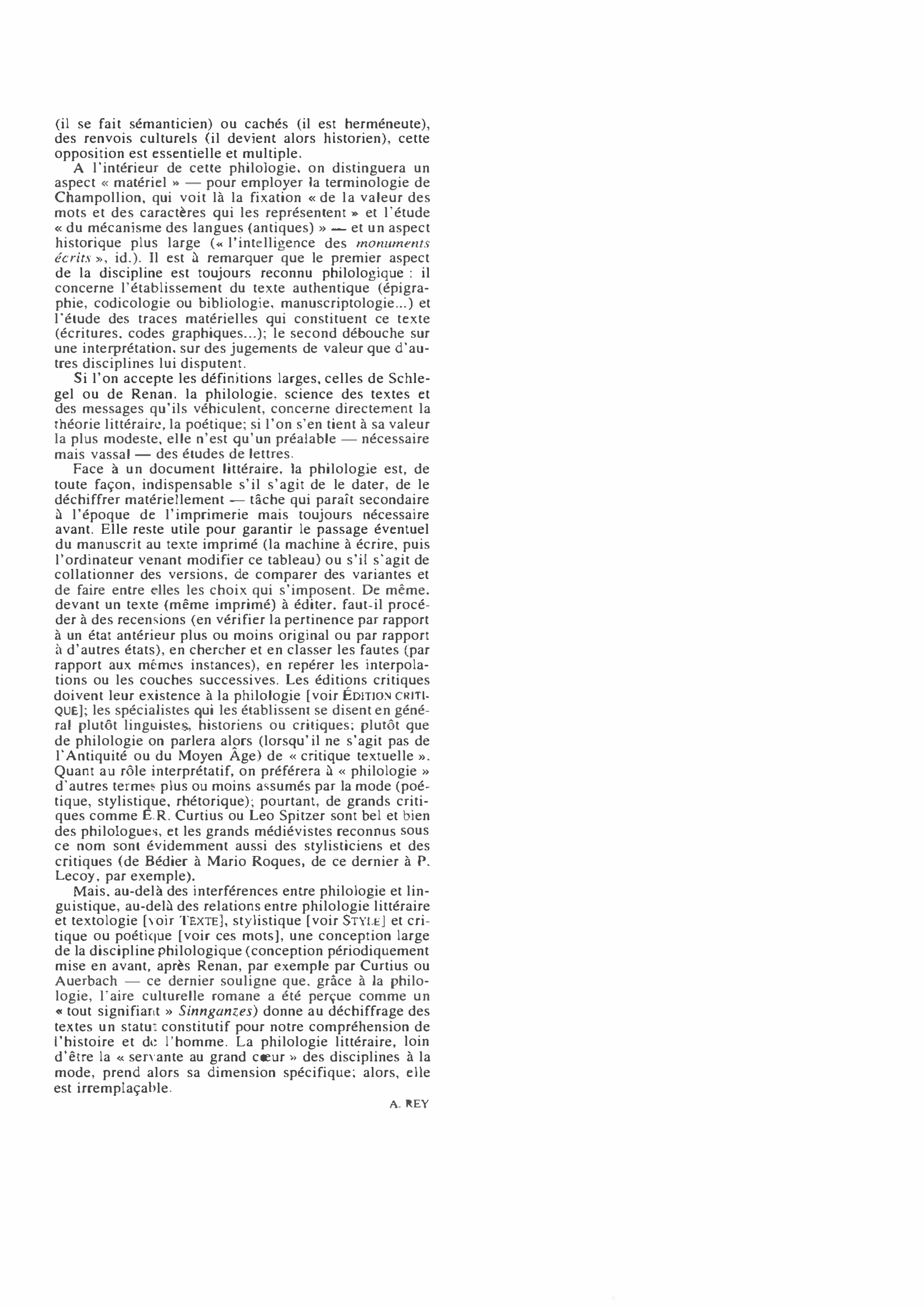PHILOLOGIE ET LITTÉRATURE
Publié le 27/11/2018
Extrait du document
PHILOLOGIE ET LITTÉRATURE. La philologie, au contraire de la linguistique, est hors de mode. C’est peut-être sa chance. Moins favorable est la confusion qui règne dans l’appréhension du concept, frontalier de plusieurs pratiques portant sur le langage (critique, histoire, herméneutique, établissement des textes) et sensible ou indifférent — selon les époques et les hommes — au caractère littéraire des objets étudiés. Le philologos, « amateur de langage, de mots » pour les Grecs est devenu en latin grammaticus. L’un comme l’autre étu
dient la lettre des textes, mais quittent le terrain du singulier, de l’objet unique en langage, soit pour décrire les fonctionnements sous-jacents — grammaire et rhétorique : Varron —, soit pour s’évader dans le commentaire, intuitif, encyclopédique, anecdotique. Pourtant, au Ve siècle, Martianus Capella, contant allégoriquement l’accession de Philologia au rang des dieux et l’union quasi charnelle des arts entre eux et avec la nature (De nuptiis Philologiae et Mercuri), donne à la philologie une valeur très haute et un pouvoir étendu.
A la Renaissance, la philologie oscille entre un formalisme textuel (nécessaire à la constitution du corpus humaniste) et une sémantique du monde, qui l’oriente vers l’encyclopédie et l’histoire (de Guillaume Budé à Joseph Scaliger et à Grotius).
Du côté formel, la philologie de l’âge classique a deux ambitions : révéler la « vérité » des éléments du langage
— et c’est, par exemple, l’étymologie avec Ménage — et apprendre à lire, à déchiffrer les textes, ces monuments du passé — les bénédictins de Saint-Maur commencent en 1733 la publication de leur immense Histoire littéraire de la France.
Si Leibniz (dans les Nouveaux Essais sur F entendement humain), puis les encyclopédistes — et notamment Turgot, à qui l’on attribue le remarquable article « Étymologie » du dictionnaire de Diderot et d’Alembert — avaient déjà posé d’impressionnants jalons, c’est à la suite de Giambattista Vico (1668-1744) et de l’école allemande du début du xixe siècle que la notion moderne la plus fructueuse de la philologie se dégage.
Bien que l’histoire des termes et des notions soit infiniment plus complexe, on peut opposer, au cours du xixc siècle — et de manière très significative pour nous, après les éclaircissements de méthode apportés par Saussure et ses successeurs —, une linguistique à la recherche du fonctionnement de ces systèmes, les langues, et une philologie qui s'adresse inlassablement aux traces, aux textes, pour en établir l’exactitude, pour en lire le ou les sens, pour en tirer ce qui peut en être tiré — et cela peut se confondre avec bien des objets : ceux de la sémantique, de la linguistique, mais aussi ceux de l’herméneutique, de la critique (historique, littéraire, etc.). Ainsi Champollion, qui sut extraire de la pierre de Rosette —
«
(il
se fait sémanticien) ou cachés (il est herméneute),
des renvois culturels (il devient alors historien), cette
opposition est essentielle et multiple.
A l'intérieur de cette philologie, on distinguera un
aspect « matériel >> - pour employer la terminologie de
Champollion, qui voit là la fixation « de la valeur des
mots et des caractères qui les représentent» et l'étude
« du mécanisme des langues (antiques) » -et un aspect
historique plus large ( des disciplines à la
mode, prend alors sa dimension spécifique; alors, elle
est irremplaçable.
A.
REY.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame Bovary et la littérature sentimentale
- l'histoire de la littérature
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)
- Fiche pédagogique Littérature francophone
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?