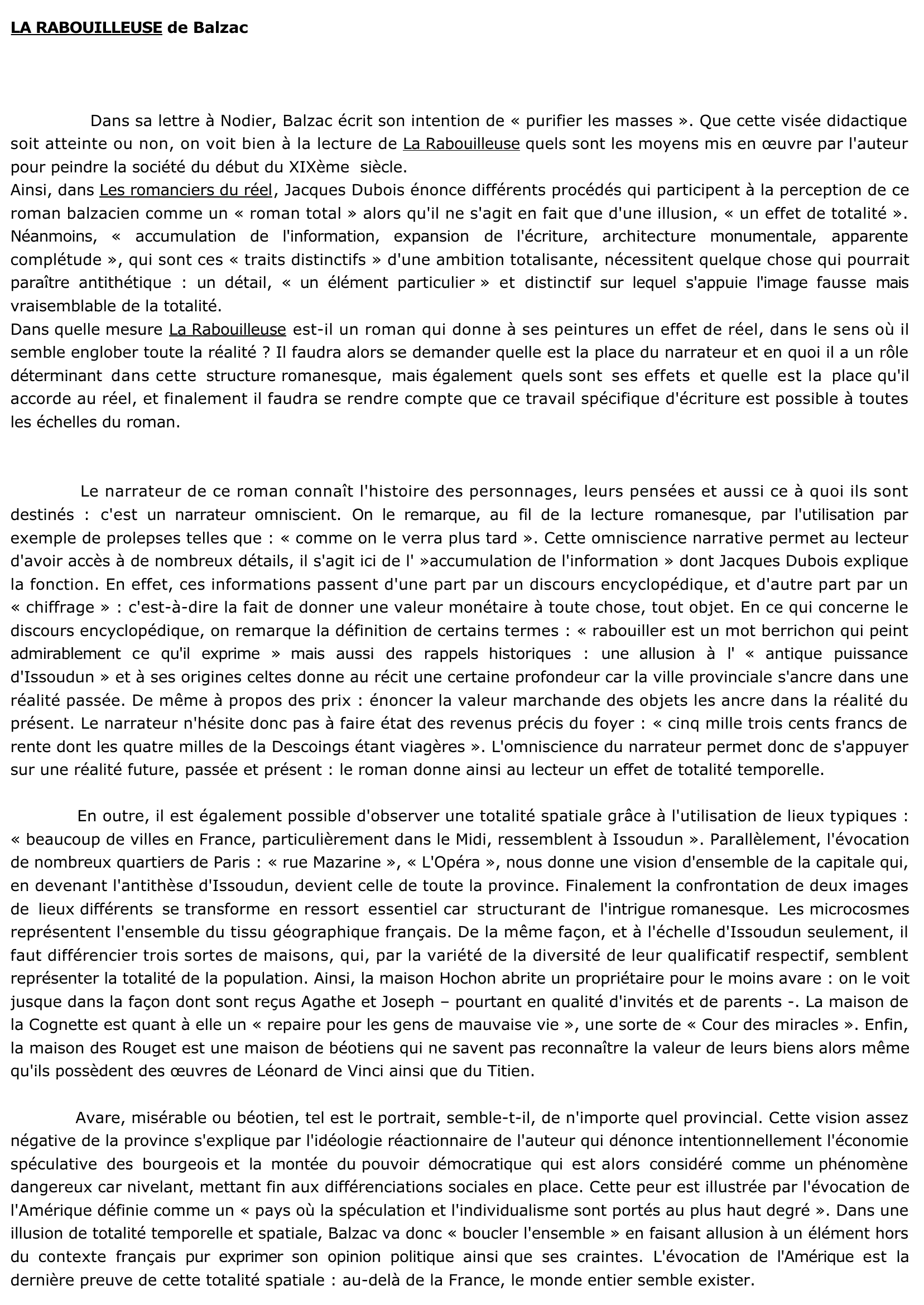Philippe Bridau. La Rabouilleuse - Balzac
Publié le 04/04/2011
Extrait du document
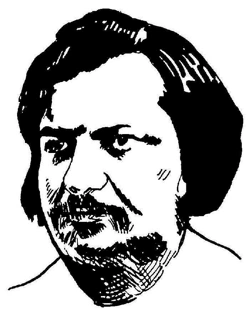
Ce personnage, que Taine admirait entre tous les « monstres « de Balzac, est typiquement de son temps. Mais ce même caractère, en d'autres temps, aurait produit le « monstre « accordé à l'époque, et il possède la même valeur universelle que les autres grands protagonistes balzaciens que nous étudions. Philippe Bridau est l'amoral par excellence. D'une très bonne famille bourgeoise de fonctionnaires, il a reçu l'éducation de règle dans son milieu, il n'a connu autour de lui qu'honnêteté, droiture, honneur.
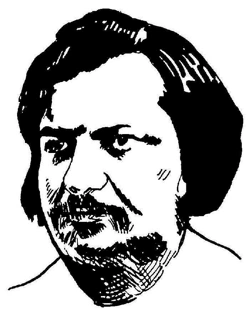
«
LA RABOUILLEUSE de Balzac Dans sa lettre à Nodier, Balzac écrit son intention de « purifier les masses ».
Que cette visée didactique soit atteinte ou non, on voit bien à la lecture de La Rabouilleuse quels sont les moyens mis en œuvre par l'auteur pour peindre la société du début du XIXème siècle.Ainsi, dans Les romanciers du réel , Jacques Dubois énonce différents procédés qui participent à la perception de ce roman balzacien comme un « roman total » alors qu'il ne s'agit en fait que d'une illusion, « un effet de totalité ».Néanmoins, « accumulation de l'information, expansion de l'écriture, architecture monumentale, apparentecomplétude », qui sont ces « traits distinctifs » d'une ambition totalisante, nécessitent quelque chose qui pourraitparaître antithétique : un détail, « un élément particulier » et distinctif sur lequel s'appuie l'image fausse maisvraisemblable de la totalité.Dans quelle mesure La Rabouilleuse est-il un roman qui donne à ses peintures un effet de réel, dans le sens où il semble englober toute la réalité ? Il faudra alors se demander quelle est la place du narrateur et en quoi il a un rôledéterminant dans cette structure romanesque, mais également quels sont ses effets et quelle est la place qu'ilaccorde au réel, et finalement il faudra se rendre compte que ce travail spécifique d'écriture est possible à toutesles échelles du roman.
Le narrateur de ce roman connaît l'histoire des personnages, leurs pensées et aussi ce à quoi ils sontdestinés : c'est un narrateur omniscient.
On le remarque, au fil de la lecture romanesque, par l'utilisation parexemple de prolepses telles que : « comme on le verra plus tard ».
Cette omniscience narrative permet au lecteurd'avoir accès à de nombreux détails, il s'agit ici de l' »accumulation de l'information » dont Jacques Dubois expliquela fonction.
En effet, ces informations passent d'une part par un discours encyclopédique, et d'autre part par un« chiffrage » : c'est-à-dire la fait de donner une valeur monétaire à toute chose, tout objet.
En ce qui concerne lediscours encyclopédique, on remarque la définition de certains termes : « rabouiller est un mot berrichon qui peintadmirablement ce qu'il exprime » mais aussi des rappels historiques : une allusion à l' « antique puissanced'Issoudun » et à ses origines celtes donne au récit une certaine profondeur car la ville provinciale s'ancre dans uneréalité passée.
De même à propos des prix : énoncer la valeur marchande des objets les ancre dans la réalité duprésent.
Le narrateur n'hésite donc pas à faire état des revenus précis du foyer : « cinq mille trois cents francs derente dont les quatre milles de la Descoings étant viagères ».
L'omniscience du narrateur permet donc de s'appuyersur une réalité future, passée et présent : le roman donne ainsi au lecteur un effet de totalité temporelle.
En outre, il est également possible d'observer une totalité spatiale grâce à l'utilisation de lieux typiques :« beaucoup de villes en France, particulièrement dans le Midi, ressemblent à Issoudun ».
Parallèlement, l'évocationde nombreux quartiers de Paris : « rue Mazarine », « L'Opéra », nous donne une vision d'ensemble de la capitale qui,en devenant l'antithèse d'Issoudun, devient celle de toute la province.
Finalement la confrontation de deux imagesde lieux différents se transforme en ressort essentiel car structurant de l'intrigue romanesque.
Les microcosmesreprésentent l'ensemble du tissu géographique français.
De la même façon, et à l'échelle d'Issoudun seulement, ilfaut différencier trois sortes de maisons, qui, par la variété de la diversité de leur qualificatif respectif, semblentreprésenter la totalité de la population.
Ainsi, la maison Hochon abrite un propriétaire pour le moins avare : on le voitjusque dans la façon dont sont reçus Agathe et Joseph – pourtant en qualité d'invités et de parents -.
La maison dela Cognette est quant à elle un « repaire pour les gens de mauvaise vie », une sorte de « Cour des miracles ».
Enfin,la maison des Rouget est une maison de béotiens qui ne savent pas reconnaître la valeur de leurs biens alors mêmequ'ils possèdent des œuvres de Léonard de Vinci ainsi que du Titien.
Avare, misérable ou béotien, tel est le portrait, semble-t-il, de n'importe quel provincial.
Cette vision asseznégative de la province s'explique par l'idéologie réactionnaire de l'auteur qui dénonce intentionnellement l'économiespéculative des bourgeois et la montée du pouvoir démocratique qui est alors considéré comme un phénomènedangereux car nivelant, mettant fin aux différenciations sociales en place.
Cette peur est illustrée par l'évocation del'Amérique définie comme un « pays où la spéculation et l'individualisme sont portés au plus haut degré ».
Dans uneillusion de totalité temporelle et spatiale, Balzac va donc « boucler l'ensemble » en faisant allusion à un élément horsdu contexte français pur exprimer son opinion politique ainsi que ses craintes.
L'évocation de l'Amérique est ladernière preuve de cette totalité spatiale : au-delà de la France, le monde entier semble exister..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le personnage de BRIDAU Philippe d’Honoré de Balzac
- RABOUILLEUSE OU UN MÉNAGE DE GARÇON EN PROVINCE (La) Honoré de Balzac
- Honoré de BALZAC : La Rabouilleuse
- Balzac, Modeste Mignon
- Philippe Breton, Histoire de l'informatique (résumé et analyse)