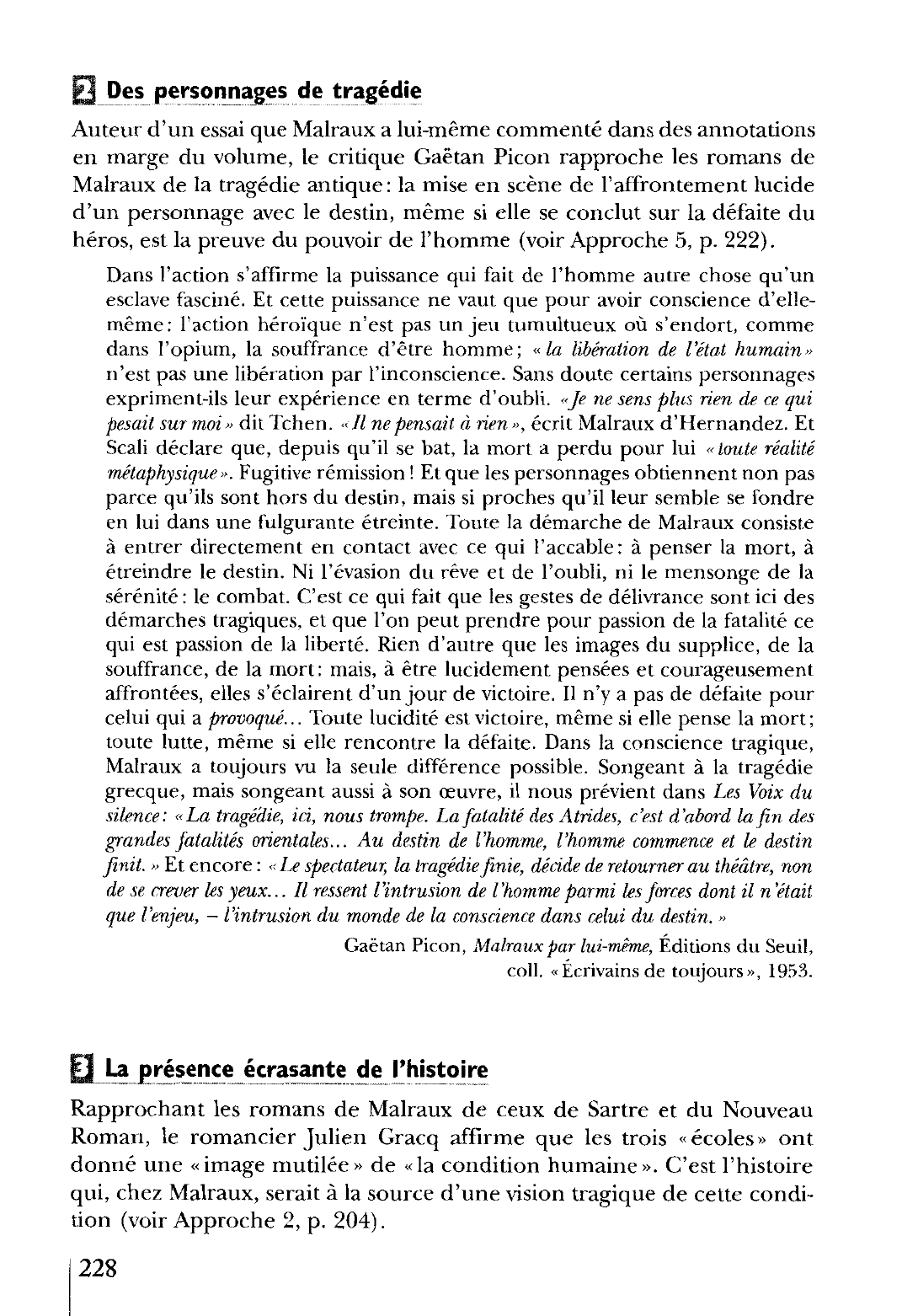Perspectives critiques
Publié le 27/03/2015
Extrait du document
Dès leur parution, les romans de Malraux ont suscité de nombreux commentaires. Les extraits présentés ici sont signés par deux critiques et deux écrivains. Ils soulignent et approfondissent quatre caractéristiques essentielles de l'oeuvre (voir Approches 4 et 5, pp. 217 et 222) : la discontinuité du style, l'héroïsme des personnages, la dimension historique des romans et le rôle des dialogues dans l'oeuvre.
L'art des ellipses
Auteur du célèbre essai L'Âge du roman américain, qui étudie le renouvellement des techniques romanesques au lendemain de la guerre, Claude-Edmonde Magny souligne ici ce qui fait, selon elle, la spécificité du style de Malraux: le refus de la continuité classique (voir Approches 2 et 4, pp. 204 et 217).
La dislocation, qui existe au plan de la phrase et dans le style, se retrouve au niveau supérieur, dans la composition des ensembles. Pour les romans, elle est évidente, et le lecteur le plus pressé ne peut manquer de s'apercevoir que la classique continuité du récit s'y trouve remplacée par une juxtaposition de scènes parfois simultanées, le plus souvent successives, mais se déroulant en des lieux divers et concernant des personnages différents. On passe sans transition de l'une à l'autre, par une suite de déclics, et ce caractère haché de la narration (qui ne contribue pas à clarifier l'enchaînement des événements) est encore accru par le découpage à l'intérieur de chaque épisode, de la scène racontée en une série de plans analogues à ceux du cinéma et sans doute inspirés par eux; découpage qui augmente le relief du récit au détriment de sa continuité, l'esprit n'étant pas apte comme l'oeil à recomposer ce qui lui est donné par saccades. Certes, il ne s'agit pas là d'un simple artifice, et la portée du roman se trouve accrue au-delà du simple récit par ce heurt des épisodes que l'auteur fait pour ainsi dire s'entrechoquer pour composer de leurs divers tintements le sens du livre, à dégager par le lecteur. Mais ce discontinuisme semble fondamental chez Malraux, incapable sans doute de dire ce qu'il veut autrement que selon les modes de la pensée aphoristique seule présente dans ses essais, ou dans ces beaux romans disloqués et véritablement décomposés que sont Les Conquérants, La Condition humaine, LEspoir et La Lutte avec l'ange, totalement dépourvus de cet abondant tissu conjonctif, de cette pulpe dense et compacte où la tradition tant française qu'anglaise du xtxe siècle nous avait appris à voir le signe d'un «vrai« roman.
C.-E. Magny, Esprit, octobre 1948.
«
Auteur d'un essai que Malraux a lui-même commenté dans des annotations
en marge du volume, le critique Gaëtan Picon rapproche les romans de
Malraux de la tragédie antique: la mise en scène de l'affrontement lucide
d'un personnage avec le destin, même si elle se conclut sur la défaite du
héros, est la preuve du pouvoir de l'homme (voir Approche 5, p.
222).
Dans l'action s'affirme la puissance qui fait de l'homme autre chose qu'un
esclave fasciné.
Et cette puissance ne vaut que pour avoir conscience d'elle
même: l'action héroïque n'est pas un jeu tumultueux où s'endort, comme
dans !'opium, la souffrance d'être homme; «la libération de l'état humain"
n'est pas une libération par l'inconscience.
Sans doute certains personnages
expriment-ils leur expérience en terme d'oubli.
«je ne sens plus rien de ce qui
pesait sur
moi" dit Tchen.
"Il ne pensait à rien'" écrit Malraux d'Hernandez.
Et
Scali déclare que, depuis qu'il se bat, la mort a perdu pour lui "toute réalité
métaphysique"· Fugitive rémission! Et que les personnages obtiennent non pas
parce qu'ils sont hors du destin, mais si proches qu'il leur semble se fondre
en lui dans une fulgurante étreinte.
Toute la démarche de Malraux consiste
à entrer directement en contact avec ce qui l'accable: à penser la mort, à
étreindre le destin.
Ni l'évasion du rêve et de l'oubli, ni le mensonge de la
sérénité: le combat.
C'est ce qui fait que les gestes de délivrance sont ici des
démarches tragiques, et que l'on peut prendre pour passion de la fatalité ce
qui est passion de la liberté.
Rien d'autre que les images du supplice, de la
souffrance,
de la mort: mais, à être lucidement pensées et courageusement
affrontées, elles s'éclairent d'un jour de victoire.
Il n'y a pas de défaite pour
celui qui a provoqué ...
Toute lucidité est victoire, même si elle pense la mort;
toute lutte, même si elle rencontre la défaite.
Dans la conscience tragique,
Malraux a toujours vu la seule différence possible.
Songeant à la tragédie
grecque, mais songeant aussi à son œuvre, il nous prévient dans Les Voix du
silence: "La tragédie, ici, nous trompe.
La fatalité des Atrides, c'est d'abord la fin des
grandes fatalités orientales ...
Au destin de l'homme, l'homme commence et le destin
finit.
» Et encore: "Le spectateur, la tragédie finie, décide de retourner au théâtre, non
de se crever les yeux ...
Il ressent l'intrusion de l'homme parmi les forces dont il n'était
que l'enjeu, -l'intrusion
du monde de la conscience dans celui du destin."
Gaëtan Picon, Malraux par lui-même, Éditions du Seuil,
coll.
«Écrivains de toujours", 1953.
D__~J~r~s~~_e__é~rasar:ite __ !!e_.fhistoire
Rapprochant les romans de Malraux de ceux de Sartre et du Nouveau
Roman, le romancier Julien Gracq affirme que les trois «écoles» ont
donné une «image mutilée» de «la condition humaine».
C'est l'histoire
qui, chez Malraux, serait à la source d'une vision tragique de cette condi
tion (voir Approche 2, p.
204).
228.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- les romans de Malraux Perspectives critiques LES ROMANS DE MALRAUX
- Fiche outil sur la critique de roman + mes critiques
- PROSES, POÉSIE ET ESSAIS CRITIQUES DE JEUNESSE de Carvel Collins (résumé)
- ESSAIS CRITIQUES Hakuchô Masamune (résumé)
- ESSAIS CRITIQUES ET HISTORIQUES de Macaulay (résumé)