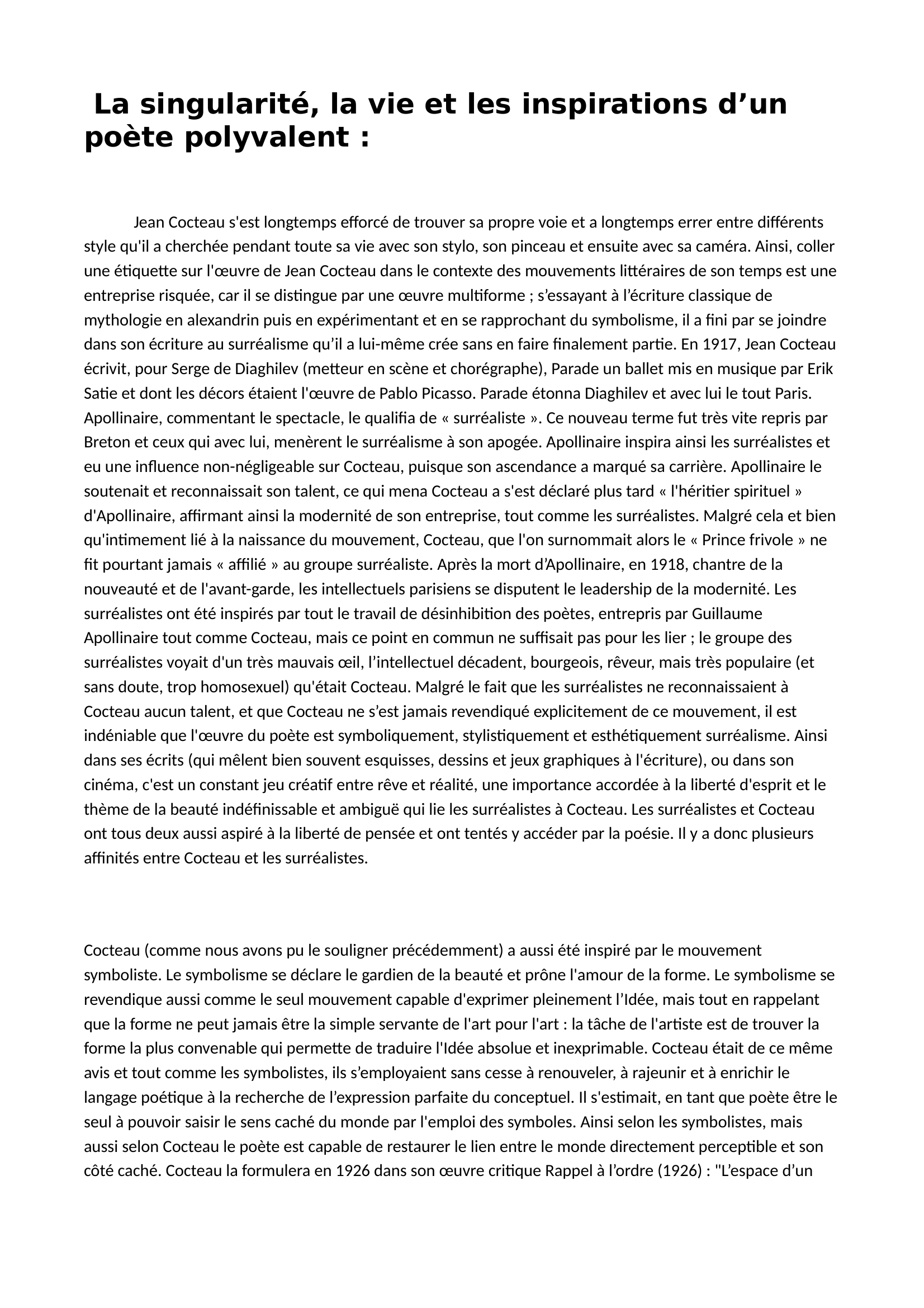Par-lui meme Jean Cocteau Analyse
Publié le 01/04/2020
Extrait du document

Jean Cocteau: le Poète
A travers son poème « Par lui-même » (1927)
Introduction :
Aujourd’hui connu, principalement, pour son œuvre théâtrale ou cinématographique, on oublie souvent que Jean Cocteau est avant tout un poète. Il le dit lui-même dans son Journal d’un inconnu « Je suis, sans doute, le poète le plus inconnu et le plus célèbre ». Ainsi artiste aux mille facettes, à la fois romancier, dramaturge, cinéaste et dessinateur, il se voulait, avant tout, poète. Son œuvre poétique, est imposante en quantité, puisqu’elle comporte environ mille cinq cents pages dans le tome de la Pléiade qui lui est consacré, mais elle est aussi d’une très grande qualité ; Mythologie, Allégories, Clair-obscur, La Crucifixion, l’Ange Heurtebise, L’incendie, Le cap de bonne Espérance, La 3e Ode… pour ne citer que les quelques traits saillants de son œuvre poétique monumentale qui sont des écrits emblématiques de la poésie du XXème. Cocteau est un poète et toute son œuvre est d’essence poétique, celle-ci s’illustre souvent dans ses créations impliquant diverses formes d’arts.
Par ailleurs, cela n’est pas étonnant puisque Cocteau est né en 1889 dans une famille de grands bourgeois où l’on aime et pratique les arts, un milieu bien propre à éveiller et développer ses talents artistiques précoces. Bien qu’intelligent, il fait des études bancales qui lui valent plusieurs échecs au baccalauréat. En 1908, sa mère l’introduit dans le monde artistique et mondain où il se fait rapidement une réputation de dandy et des relations dans le milieu littéraire qui lui organise, au théâtre « Femina » une matinée « consacrée à un tout jeune poète de dix-huit ans, Jean Cocteau » ; depuis ce jour-là, Cocteau ne cessera de s’impliquer dans les arts et la poésie. Il se lance alors très tôt, à 20 ans, dans le milieu mondain littéraire classique, mais bientôt, il opère une première mue et se réinvente en optant pour une esthétique avant-gardiste, radicale et contemporaine. C’est une conjonction d'événements et de phénomènes autour de 1912 (le cubisme en peinture, Apollinaire, les symbolistes et les débuts du surréalisme) qui lui font comprendre qu'il doit se défaire de ses repères intellectuels et artistiques classiques pour survivre en tant qu'artiste-poète. Dès lors, pour ne pas manquer le wagon de la modernité Jean Cocteau s’illustrera parmi les surréalistes et les dadaïstes. Sa poésie emboîtera le pas et à travers elle, il redéfinira à sa manière ce qu’est l’écriture poétique.
Dans ce dossier consacrer à l’œuvre poétique « Cocteauesque » nous nous interrogerons sur la singularité de sa poésie, puis sur ce qu’elle dit des mouvements l’ayant inspiré et enfin nous analyserons un de ses poèmes pour illustrer son propos au sujet du rôle du poète. Comment Jean Cocteau définit l’acte poétique à travers sa poésie ?
La singularité, la vie et les inspirations d’un poète polyvalent :
Jean Cocteau s'est longtemps efforcé de trouver sa propre voie et a longtemps errer entre différents style qu'il a cherchée pendant toute sa vie avec son stylo, son pinceau et ensuite avec sa caméra.

«
La singularité, la vie et les inspirations d’un
poète polyvalent :
Jean Cocteau s'est longtemps efforcé de trouver sa propre voie et a longtemps errer entre différents
style qu'il a cherchée pendant toute sa vie avec son stylo, son pinceau et ensuite avec sa caméra.
Ainsi, coller
une étiquette sur l'œuvre de Jean Cocteau dans le contexte des mouvements littéraires de son temps est une
entreprise risquée, car il se distingue par une œuvre multiforme ; s’essayant à l’écriture classique de
mythologie en alexandrin puis en expérimentant et en se rapprochant du symbolisme, il a fini par se joindre
dans son écriture au surréalisme qu’il a lui-même crée sans en faire finalement partie.
En 1917, Jean Cocteau
écrivit, pour Serge de Diaghilev (metteur en scène et chorégraphe), Parade un ballet mis en musique par Erik
Satie et dont les décors étaient l'œuvre de Pablo Picasso.
Parade étonna Diaghilev et avec lui le tout Paris.
Apollinaire, commentant le spectacle, le qualifia de « surréaliste ».
Ce nouveau terme fut très vite repris par
Breton et ceux qui avec lui, menèrent le surréalisme à son apogée.
Apollinaire inspira ainsi les surréalistes et
eu une influence non-négligeable sur Cocteau, puisque son ascendance a marqué sa carrière.
Apollinaire le
soutenait et reconnaissait son talent, ce qui mena Cocteau a s'est déclaré plus tard « l'héritier spirituel »
d'Apollinaire, affirmant ainsi la modernité de son entreprise, tout comme les surréalistes.
Malgré cela et bien
qu'intimement lié à la naissance du mouvement, Cocteau, que l'on surnommait alors le « Prince frivole » ne
fit pourtant jamais « affilié » au groupe surréaliste.
Après la mort d’Apollinaire, en 1918, chantre de la
nouveauté et de l'avant-garde, les intellectuels parisiens se disputent le leadership de la modernité.
Les
surréalistes ont été inspirés par tout le travail de désinhibition des poètes, entrepris par Guillaume
Apollinaire tout comme Cocteau, mais ce point en commun ne suffisait pas pour les lier ; le groupe des
surréalistes voyait d'un très mauvais œil, l’intellectuel décadent, bourgeois, rêveur, mais très populaire (et
sans doute, trop homosexuel) qu'était Cocteau.
Malgré le fait que les surréalistes ne reconnaissaient à
Cocteau aucun talent, et que Cocteau ne s’est jamais revendiqué explicitement de ce mouvement, il est
indéniable que l'œuvre du poète est symboliquement, stylistiquement et esthétiquement surréalisme.
Ainsi
dans ses écrits (qui mêlent bien souvent esquisses, dessins et jeux graphiques à l'écriture), ou dans son
cinéma, c'est un constant jeu créatif entre rêve et réalité, une importance accordée à la liberté d'esprit et le
thème de la beauté indéfinissable et ambiguë qui lie les surréalistes à Cocteau.
Les surréalistes et Cocteau
ont tous deux aussi aspiré à la liberté de pensée et ont tentés y accéder par la poésie.
Il y a donc plusieurs
affinités entre Cocteau et les surréalistes.
Cocteau (comme nous avons pu le souligner précédemment) a aussi été inspiré par le mouvement
symboliste.
Le symbolisme se déclare le gardien de la beauté et prône l'amour de la forme.
Le symbolisme se
revendique aussi comme le seul mouvement capable d'exprimer pleinement l’Idée, mais tout en rappelant
que la forme ne peut jamais être la simple servante de l'art pour l'art : la tâche de l'artiste est de trouver la
forme la plus convenable qui permette de traduire l'Idée absolue et inexprimable.
Cocteau était de ce même
avis et tout comme les symbolistes, ils s’employaient sans cesse à renouveler, à rajeunir et à enrichir le
langage poétique à la recherche de l’expression parfaite du conceptuel.
Il s'estimait, en tant que poète être le
seul à pouvoir saisir le sens caché du monde par l'emploi des symboles.
Ainsi selon les symbolistes, mais
aussi selon Cocteau le poète est capable de restaurer le lien entre le monde directement perceptible et son
côté caché.
Cocteau la formulera en 1926 dans son œuvre critique Rappel à l’ordre (1926) : "L’espace d’un.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ENFANTS TERRIBLES (Les) Jean Cocteau (résumé & analyse)
- OPIUM Jean Cocteau (Résumé et analyse)
- THOMAS L’IMPOSTEUR de Jean Cocteau (résumé & analyse)
- Enfants terribles (les). Roman de Jean Cocteau (analyse détaillée)
- OPERA Jean Cocteau (Résumé et analyse)