On chercherait en vain dans cette œuvre les signes de quelque démangeaison métaphysique : peut-être est-ce l'arrière-fond campagnard – quelque chose comme un positivisme de bon aloi – qui a préservé Gracq des affres du mysticisme et des tourments de l'intellectualisme. Il y a en lui un matérialisme heureux, paisible, qui se satisfait de ce monde, y trouve nourriture pour l'esprit comme pour le rêve, et équilibre. Si le tragique, en effet, ne prend pas, c'est parce que l'homme ne se sen
Publié le 30/07/2012

Extrait du document
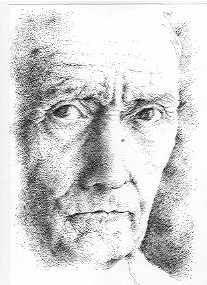
Les signes du sacré, dans ces récits, sont d'abord la marque du merveilleux et de l'enchantement, que l'on peut entendre aussi bien de façon heureuse (Mona comme fée) que malheureuse (la Sibylle, la sorcière) Pour dire les choses autrement, les signes du sacré sont moins tragiques que poétiques, au sens où ils fournissent à l'homme « toujours relié à la terre, accordé à elle « un aliment pour le songe et au récit un réservoir d'images et d'indices qui le lestent de ce pouvoir merveilleux qui, pour Gracq, est l'autre nom de la poésie. Ainsi, toutes les images issues du conte dans Un balcon en forêt (le château magique, l'armée au bois dormant, Mona en petit chaperon rouge, etc.) sont dépourvues de transcendance mais non pas de poésie. Il en va de même pour la route qui doit déboucher « sur une de ces clairières où les bêtes parlaient aux hommes « évoque un monde fabuleux (« La Route «). Il faut être sensible, dans ce fragment, aux images qui suggèrent la renaissance et l'abondance, et qui viennent compenser le sentiment d'abandon et de ruine qui domine au début. Quelque chose comme une réversibilité magique du temps est ici envisagé. Tous ces aspects de l'écriture de Gracq tendent donc vers une poétique de l'émerveillement et du sortilège.
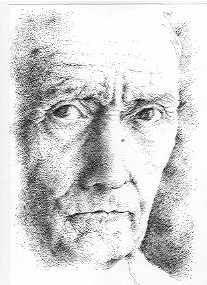
«
maintenir avec lui un contact heureux.
C'est en cela que Gracq se distingue de nombre d'écrivains contemporains, en lesquels il voyait souvent de simples « prophètesde pauvreté et de malheur » (« Le surréalisme et la littérature contemporaine », Bibliothèque de la Pléiade, p.
1031) Si l'on peut rapprocher ces récits d'une écriturepoétique, c'est précisément en ce qu'ils sont profondément affirmatifs : on y respire, alors que, selon Gracq, dans nombre de romans contemporains, on est asphyxiépar le goût du malheur, le sens du tragique et une conception trop exclusivement sombre de la condition humaine : « il n'y a pas...
de poète si sombre, si désespéréqu'il soit, sans qu'on trouve au fond de lui, tout au fond, le sentiment de la merveille, de la merveille unique que c'est d'avoir vécu dans ce monde et dans nul autre.
Lapoésie vibre par excellence dans ce sentiment du oui « porté au somment d'un instant que traversent frissons, battement d'ailes » ».
(« Pourquoi la littérature respiremal », Pléiade, I, p.1-XXXX-DV-PA-XX-09 – XXX
5
874.) Pour autant, il serait excessif de ne voir dans cette œuvre que l'affirmation du bonheur.
L'angoisse y est aussi importante que la jouissance.
En outre, si lepersonnage fait si souvent corps avec le lieu, si un sentiment tellurique fort caractérise l'œuvre, on ne saurait l'assimiler à un « matérialisme heureux ».
II.
Une écriture qu'on ne peut assimiler à un matérialisme heureux
Le terme de « matérialisme » paraît peu convenir pour qualifier l'œuvre de Gracq, tant il est associé à une écriture réaliste, voire, dans le contexte contemporain denos récits, à une littérature d'obédience plus ou moins marxiste.
Le matérialisme, et le strict souci réaliste, sont, pour Gracq, un gaz qui asphyxie la littératurecontemporaine et l'empêche de respirer.
Nul optimisme béat dans Un balcon en forêt et La Presqu'île donc : l'assentiment au monde est l'objet d'une tension.
C'est unedynamique, une perspective bien plus qu'une évidence acquise.
L'accord avec le monde est intermittent – « La Presqu'île » le montre bien – et fragile.
L'inquiétude est très souvent présente et suffit à fortement nuancer l'idée d'un matérialisme heureux.
C'est bien ce sentiment d'inquiétude, voire d'angoisse, quedéveloppe le récit de rêve dans Un balcon en forêt.
L'angoisse est le revers du bonheur, comme l'a bien noté Jean Bellemin-Noël : « au comble du bien-être puisquerien ne fait obstacle, au comble de l'angoisse puisque rien ne donne appui » (Une balade en galère avec Julien Gracq, Toulouse, Pu du Mirail, 1995, p.
120).
Dans laforêt, Grange éprouve souvent un sentiment d'étrangeté, si étrange même qu'il n'y a pas de mot français pour le nommer : « weird » (p.
141) signifiant fantastique,inquiétant, étrange.
C'est bien l'angoisse qui fissure cet accord recherché avec le monde et qui, à la fin du récit, fait que « la vie ne se rejoignait pas à elle-même »(p.251).
Dans « Le Roi Cophetua », le noir domine : la femme est inquiétante, cruelle peut-être, dominatrice en tout cas (voir en particulier p.
239).
Gracq retournecomme un gant les images qui suggèrent la pureté : la robe de celle qui évoque une Vierge d'une Visitation n'est qu'« un haillon blanc déchiré et poussiéreux »,dérisoirement une « robe de noces » (p.
224) ; elle évoque une Annonciation, mais « sordide ».
La montée de la tension dramatique structure la progression de lanouvelle et le sentiment d'étrangeté, la fascination constante du narrateur vont à l'encontre d'un matérialisme mâtiné d'optimisme.
Le sentiment panique, qui revient sisouvent dans chacun des textes (par exemple page 243 dans « Le Roi Cophetua » ; on retrouve aussi le terme dans le passage du Balcon que je vous ai proposé enÉtude littéraire) signifie une peur qui gagne tout, incontrôlable.
Elle se distingue du sentiment tragique qui suppose lui une transcendance alors que la paniquesuggère plutôt une adéquation, fût-elle douloureuse et négative, avec tout ce qui entoure, avec le tout (c'est l'étymologie du mot), au risque d'une dissolution du sujet.Enfin, si ce matérialisme heureux peut être critiqué, c'est aussi et surtout parce que l'univers de ces récits, quel que soit son ancrage réaliste et son arrière-planhistorique, est habité par des signes que les personnages perçoivent, qu'ils tentent parfois de déchiffrer, et qui, bien souvent, restent en attente d'un sens.
La forêt esttout entière présages et signes et Grange s'y montre très attentif (on peut prendre un exemple p.
70 ou p.
178 du Balcon).
La force de l'irrationnel est peut-être encoreplus grande dans « Le Roi Cophetua », où le jeu avec le pouvoir de l'image (tableau dans lequel on entre, qui a un pouvoir magique – p.
235 ; 246) est clairementrelié à des pratiques qui touchent à la fascination et à l'enchantement.
S'il n'y a pas donc de discours métaphysique ni de propension au mysticisme dans nos récits,très nombreuses sont les références au sacré (déluge, p.
210 du Balcon par exemple ; «de loin en loin, désincarnée, continuait à nous faire signe, comme ces angesénigmatiques des chemins de la Bible » (p.
12, « La Route ») , aux mythes (les bêtes de la fable », ibid.
la sybille (Mona, la servante-maîtresse) ; à la magie (le sabbatdes sorcières, dans Un Balcon et dans « Le Roi Cophetua »), etc.
.
.
Toutes ces images suggèrent puissamment que le monde tel qu'il est tend vers une signification qui certes échappe, mais qu'une approche strictement matérialiste nesuffirait en aucun cas à épuiser.
Si ces récits s'entrouvrent si souvent sur le monde du conte et de la légende, c'est bien parce que la rationalité d'un roman purementmatérialiste et rationaliste ne saurait suffire à rendre compte de l'opacité du monde, de ce que l'on y perçoit sans toujours le comprendre d'énigme et de mystère.
Pourautant, les récits de Gracq ne nous paraissent pas relever d'une écriture de la révélation ni d'une tension vers une transcendance à laquelle, précisément, ces signes etces présages renverraient.
Ne sont-ils pas bien plutôt caractérisés par une poétique du sortilège qui cherche à situer le merveilleux dans le monde et à le rendresensible à l'homme ?
III Une écriture du sortilège
Les présages et les signes, si nombreux à être remarqués par Grange dans Un balcon en forêt, par Simon dans « La Presqu'île », ne délivrent aucun sens fiable.
C'estune des caractéristiques importantes de nos récits que de suspendre le sens – ce qui confirme la résistance au discours, métaphysique ou mystique.
Si le sens esttoujours suspendu, voire déchu, c'est précisément parce qu'il n'y a aucune révélation à attendre.
Le monde est là, se suffit à lui-même et ne renvoie qu'à lui-même.
Leterme de « gloire », souvent utilisé pour qualifier le sentiment de bonheur, voire l'extase, n'ouvre pour autant sur aucune transcendance.
De même, si le sujet est sisouvent dans l'état d'attendre, cette attente est souvent sans objet.
Comme le formule Simon, il y a un « non-espoir paisible », un « monde sans promesse et sansréponse » ( p.
170).
On ne peut plus clairement exprimer un sentiment non-tragique.
Si le tragique ne prend pas, dans ces récits, c'est donc d'abord parce qu'ils ne fontpas place à une transcendance.
Or, pour qu'il y ait tragique, il faut nécessairement que le destin soit l'objet d'une intervention, d'un « daimon » au sens grec du mot,qui peut être identifié à un dieu ou à la divinité, ou encore à une force obscure.
Le sacré présent dans ces récits n'est pas l'expression d'une transcendance dont lesentiment tragique attesterait la force et la puissance.
C'est bien plus souvent, nous semble-t-il, à un sacré immanent, parfois même traité sur le mode de la dérision,que nous avons affaire.
Il en va ainsi de la comparaison des rafales de la mitrailleuse des chasseurs avec « le crissement d'une roue de loterie » (p.
193, Un Balcon enforêt).
La dérision est présente aussi lorsque le terme même de sacré est employé, avec celui d'arcanes : à la fin du Balcon, lorsque la seule attaque qui vienne dublockhaus s'abat sur une camionnette remplie de livrets matricules, c'est à une résurgence stupéfiante du sacré qu'ont affaire Hervouët et Grange : « ils avaient portéla main sur les arcanes » (p.
234)
Les références à la magie et à la sorcellerie, dans « Le Roi Cophetua », sont quant à elles, avant tout une source de théâtralisation et il est légitime de les lire ausecond degré : ce sont au moins autant des références littéraires et culturelles que des signes qui renverraient à un authentique mysticisme ou à un authentique sensdu sacré.
Il en va de même pour les comparaisons avec le cloître (p.
212) ou la sacristie : c'est à une imagerie du sacré, caractéristique du roman gothique ou de lanouvelle à la Barbey d'Aurevilly, que nous sommes d'abord renvoyés, plus qu'à un vrai mystère.
Les signes du sacré, dans ces récits, sont d'abord la marque du merveilleux et de l'enchantement, que l'on peut entendre aussi bien de façon heureuse (Mona commefée) que malheureuse (la Sibylle, la sorcière) Pour dire les choses autrement, les signes du sacré sont moins tragiques que poétiques, au sens où ils fournissent à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'homme Qui Rit l'homme de police, à ce glas de la prison où il avait été conduit, venait s'ajouter, disons mieux, s'ajuster cette chose tragique, un cercueil porté en terre.
- « Notre philosophe, écrit Diderot, ne se croit pas en exil dans ce monde; il ne croit point être en pays ennemi; il veut jouir en sage . économe des biens que la nature lui offre; il veut trouver du plaisir avec les autres; et pour en trouver il en faut faire; ainsi il cherche à convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre; et il trouve en même temps ce qui lui convient : c'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile. » Estimez-vous que cette définition pui
- Évoquant «ces ressemblances dissimulées, involontaires » qui éclatent «sous des couleurs différentes entre les chefs-d'oeuvre distincts» du même compositeur, Marcel Proust se demande dans La Prisonnière (À la Recherche du temps perdu, Pléiade, t. III, p. 761-762) où le compositeur l'a appris, «entendu», «ce chant différent de celui des autres, semblable à tous les siens», et répond : «Chaque artiste semble ainsi comme le citoyen d'une patrie inconnue, oubliée de lui-même, différente de
- Un mathématicien et homme d’esprit du XVIIIe siècle se serait écrié, après avoir vu une tragédie de Racine : « Qu’est-ce que cela prouve ? » A la lumière de cette boutade, vous vous demanderez si une œuvre littéraire doit «prouver » quelque chose pour retenir l’attention.
- Paul Valéry écrit dans le Préambule pour le Catalogue

































