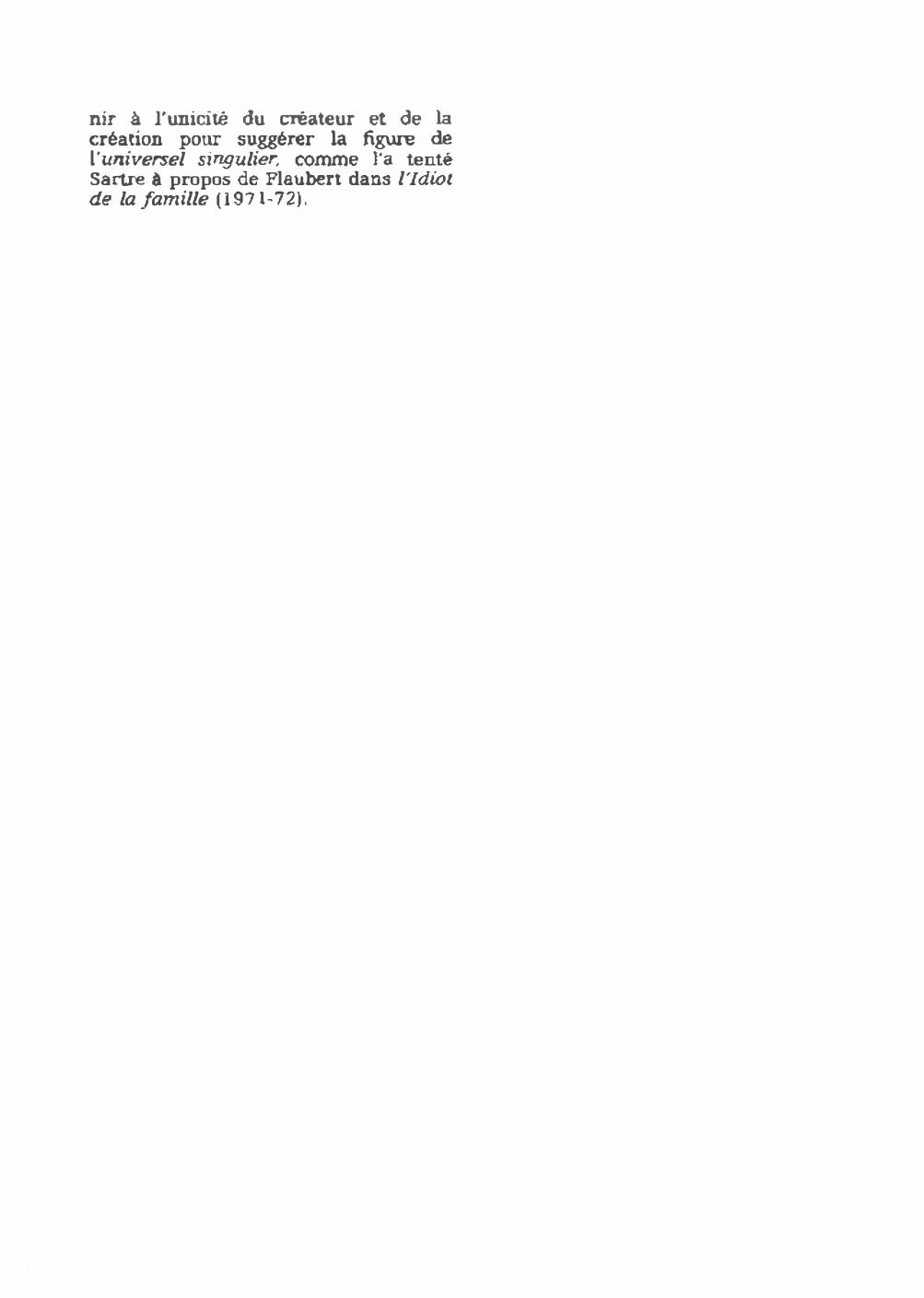NOUVELLE CRITIQUE
Publié le 10/03/2019
Extrait du document
NOUVELLE CRITIQUE. Ce mouvement d'analyse et de critique littéraires, d'inspiration essentiellement universitaire, apparu en France au début des années 1960, est ainsi dénommé parce qu'il s'opposait — ou était opposé — aux diverses méthodes et thèses de la critique universitaire traditionnelle, issues des travaux de Gustave Lanson et caractérisées par une stricte observation des données biographiques et de l'histoire des œuvres comprise suivant une causalité événementielle. La polémique entre Roland Barthes (Sur Racine, 1963 ; Critique et Vérité, 1966) et Raymond Picard, professeur à la Sorbonne, qui (Nouvelle Critique ou nouvelle imposture, 1965) mettait en cause la validité d'une interprétation des textes menée à partir des méthodes de la psychanalyse (Marie Bonaparte, Bachelard) et de la linguistique (R. Jakobson et Lévi-Strauss), fixe les termes du débat. La nouvelle critique est fille des sciences humaines, en même temps qu'elle affirme l'autonomie du littéraire ; elle traduit une convergence d'idées et de méthodes, qui trouve sa confirmation dans les premiers succès publics du Nouveau Roman. La publication rapprochée de divers travaux — L. Goldmann, le Dieu caché (1956) ; J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle, 1957; J.-P. Weber, Genèse de l'œuvre poétique, 1960 ; G. Poulet, les Métamorphoses du cercle, 1961 ; R. Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961 ; Ch. Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel (1963) ; S. Doubrov-sky. Corneille et la dialectique du héros (1964) ; G. Genette, Figures (1966), ainsi que les ouvrages de Jean Rousset — et l'édition de la revue Tel Quel, dès 1960, définissent un champ critique composite, étudié par Doubrovsky dans Pour quoi la Nouvelle Critique? (1966) et référable à quelques hypothèses simples : l'œuvre littéraire est œuvre de langage ; elle ne peut être en conséquence expliquée directement par des données externes sauf à considérer, de façon explicite, ces données comme des médiations et l'œuvre même comme une médiation. L’hypothèse linguistique ou
vre ainsi doublement l'interprétation : elle impose une étude formelle et quasi autarcique du texte ; elle indique que ce texte est pris dans une chaîne de communication, qui appelle les notations sociologiques, psychanalytiques et la lecture transversale, telle qu'elle est pratiquée par Jean-Pierre Richard (l'Univers imaginaire de Mallarmé, 1962). L'œuvre est plurifactorielle en elle-même, sans qu'il soit nécessaire de lui prêter des antécédents qui n’ont jamais force de preuve dans l'étude de la création. Prévaut ainsi le concept d'écriture défini par Roland Barthes, incertain en lui-même, mais qui permet de faire le partage entre une esthétique littéraire considérée suivant ses déterminations propres, et une doctrine littéraire rapportée à des corrélats biographiques et historiques, identifiés selon le jeu des concomitances chronologiques. Au-delà des excès de la polémique, les questions posées par Raymond Picard restent cependant pertinentes : il est difficile de déterminer ce qui peut être valablement dit de l'œuvre dès lors qu'elle se lit au gré des apports de divers systèmes cognitifs et dans l'aveu que la parole de l'auteur sur l'œuvre est au plus un témoignage parmi d'autres sur cette œuvre. Le texte est ainsi inévitablement « ouvert » et soumis à une multiplicité de parcours critiques dont aucun ne peut prétendre l'emporter. Dans son effort pour se donner une base scientifique, pour définir la littérarité de l'œuvre, suivant la suggestion des formalistes russes (Théorie de la littérature, 1966), la nouvelle critique contribue, de fait, à relativiser le concept de littérature, à caractériser l'œuvre même comme une variable des procès de lecture et d'écriture. Elle inaugure ainsi une réforme des études littéraires, qui se libèrent peu à peu de l'autorité de la tradition critique normative et se partageront entre les recherches de poétique, de narratologie, de symbolique, de sociologie et d’herméneutique, sans que la vision unitaire attachée au nom de l'écrivain soit jamais retrouvée — sauf dans quelques synthèses qui entendent faire la somme des méthodes des sciences humaines et reve-
« nir à l'unicité du créateur et de la création pour suggérer la figure de l'universel singulier, comme l'a tenté Sartre à propos de Flaubert dans l'Idiot de la famille (1971-72}.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CHABROL, Claude (né en 1930) Critique aux Cahiers du cinéma en même temps que Truffaut et Godard, il réalise en 1958 son premier film, Le beau Serge, précurseur de la Nouvelle Vague.
- Les Goncourt ont écrit dans leur journal : Voltaire est immortel et Diderot n'est que célèbre. Pourquoi ? Voltaire a enterré le poème épique, le conte, le petit vers, la tragédie. Diderot a inauguré le roman moderne, le drame et la critique d'art. L'un est le dernier esprit de l'ancienne France, l'autre est le premier génie de la France nouvelle. Expliquez, discutez, commentez ce jugement. ?
- L'une des caractéristiques centrales de la frontière, selon Turner, était la diversité de son peuplement d'origine, à la source du creuset américain, ce vaste brassage des cultures européennes d'origine en une nouvelle culture. Joseph Yvon Thériault, Critique de l'américanité, Québec Amérique
- BAZIN, André (1918-1958) Critique de cinéma, il fonde en 1951 avec Doniol-Valcroze et Lo Duca Les Cahiers du cinéma, revue de référence qui accueille les futurs auteurs de la Nouvelle Vague, notamment Godard et Truffaut, son " fils adoptif ".
- BAZIN, André (1918-1958) Critique de cinéma, il fonde en 1951 avec Doniol-Valcroze et Lo Duca Les Cahiers du cinéma, revue de référence qui accueille les futurs auteurs de la Nouvelle Vague, notamment Godard et Truffaut, son " fils adoptif ".