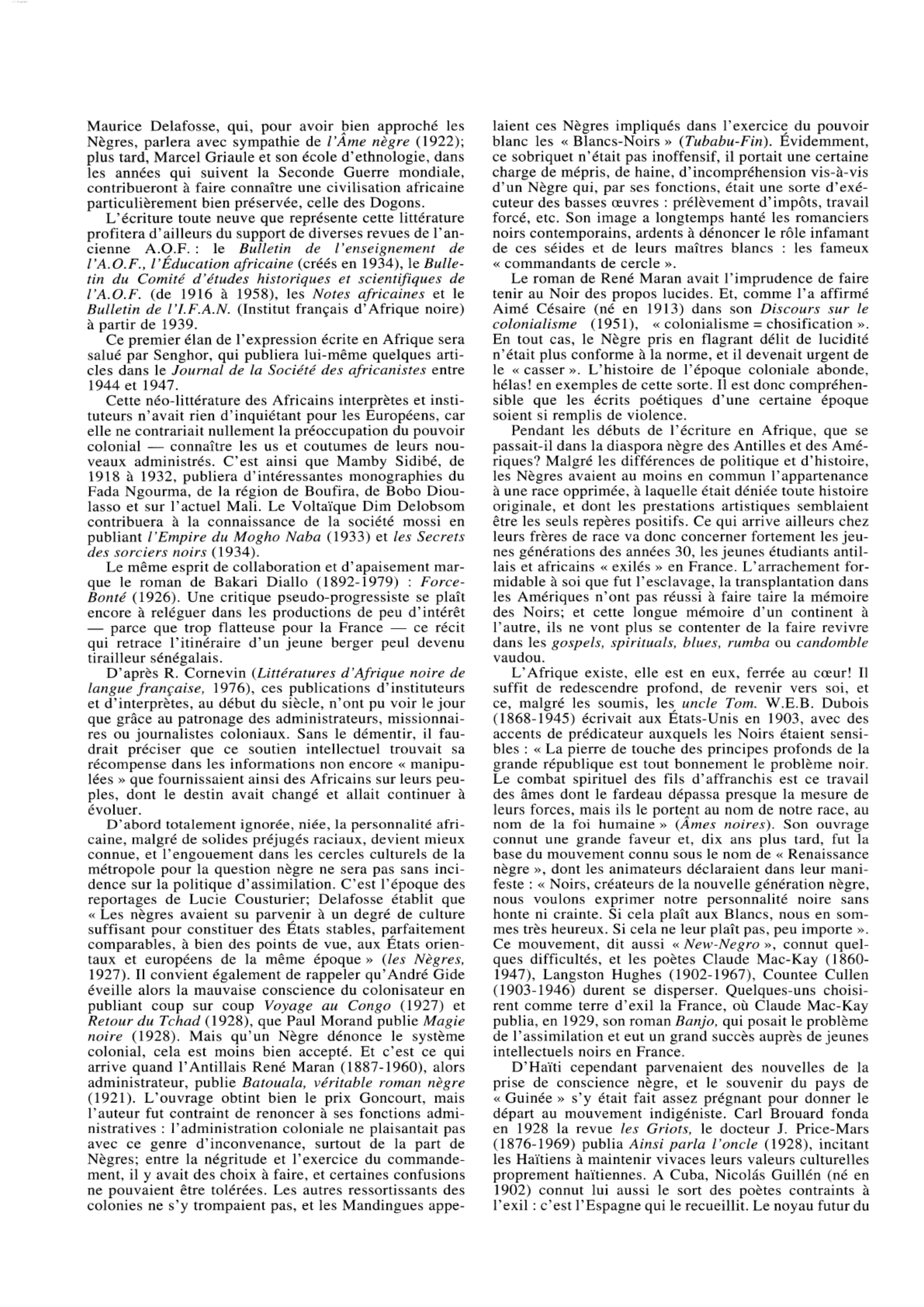NÉGRO-AFRICAINE (littérature d'expression française)
Publié le 25/11/2018

Extrait du document
Évidemment, ce sobriquet n’était pas inoffensif, il portait une certaine charge de mépris, de haine, d’incompréhension vis-à-vis d’un Nègre qui, par ses fonctions, était une sorte d’exécuteur des basses œuvres : prélèvement d’impôts, travail forcé, etc. Son image a longtemps hanté les romanciers noirs contemporains, ardents à dénoncer le rôle infamant de ces séides et de leurs maîtres blancs : les fameux « commandants de cercle ».
Le roman de René Maran avait l’imprudence de faire tenir au Noir des propos lucides. Et, comme l’a affirmé Aimé Césaire (né en 1913) dans son Discours sur le colonialisme (1951), « colonialisme = chosification ». En tout cas, le Nègre pris en flagrant délit de lucidité n’était plus conforme à la norme, et il devenait urgent de le «casser». L’histoire de l’époque coloniale abonde, hélas! en exemples de cette sorte. Il est donc compréhensible que les écrits poétiques d’une certaine époque soient si remplis de violence.
Pendant les débuts de l’écriture en Afrique, que se passait-il dans la diaspora nègre des Antilles et des Amériques? Malgré les différences de politique et d’histoire, les Nègres avaient au moins en commun l’appartenance à une race opprimée, à laquelle était déniée toute histoire originale, et dont les prestations artistiques semblaient être les seuls repères positifs. Ce qui arrive ailleurs chez leurs frères de race va donc concerner fortement les jeunes générations des années 30, les jeunes étudiants antillais et africains « exilés » en France. L’arrachement formidable à soi que fut l’esclavage, la transplantation dans les Amériques n’ont pas réussi à faire taire la mémoire des Noirs; et cette longue mémoire d’un continent à l’autre, ils ne vont plus se contenter de la faire revivre dans les gospels, spirituals, blues, rumba ou candomblé vaudou.
L’Afrique existe, elle est en eux, ferrée au cœur! Il suffit de redescendre profond, de revenir vers soi, et ce, malgré les soumis, les uncle Tom. W.E.B. Dubois (1868-1945) écrivait aux États-Unis en 1903, avec des accents de prédicateur auxquels les Noirs étaient sensibles : « La pierre de touche des principes profonds de la grande république est tout bonnement le problème noir. Le combat spirituel des fils d’affranchis est ce travail des âmes dont le fardeau dépassa presque la mesure de leurs forces, mais ils le portent au nom de notre race, au nom de la foi humaine » (Ames noires). Son ouvrage connut une grande faveur et, dix ans plus tard, fut la base du mouvement connu sous le nom de « Renaissance nègre », dont les animateurs déclaraient dans leur manifeste : « Noirs, créateurs de la nouvelle génération nègre, nous voulons exprimer notre personnalité noire sans honte ni crainte. Si cela plaît aux Blancs, nous en sommes très heureux. Si cela ne leur plaît pas, peu importe ». Ce mouvement, dit aussi « New-Negro », connut quelques difficultés, et les poètes Claude Mac-Kay (1860-1947), Langston Hughes (1902-1967), Countee Cullen (1903-1946) durent se disperser. Quelques-uns choisirent comme terre d’exil la France, où Claude Mac-Kay publia, en 1929, son roman Banjo, qui posait le problème de l’assimilation et eut un grand succès auprès de jeunes intellectuels noirs en France.
D’Haïti cependant parvenaient des nouvelles de la prise de conscience nègre, et le souvenir du pays de « Guinée » s’y était fait assez prégnant pour donner le départ au mouvement indigéniste. Cari Brouard fonda en 1928 la revue les Griots, le docteur J. Price-Mars (1876-1969) publia Ainsi parla l'oncle (1928), incitant les Haïtiens à maintenir vivaces leurs valeurs culturelles proprement haïtiennes. A Cuba, Nicolas Guillén (né en 1902) connut lui aussi le sort des poètes contraints à l’exil : c’est l’Espagne qui le recueillit. Le noyau futur du
NÉGRO-AFRICAINE (littérature d'expression française). Littérature négro-africaine, littérature noire, littérature nègre d’expression française : cette diversité de termes s’appliquant à l’écriture d’écrivains de race noire qui s’expriment dans une langue autre que leur langue maternelle indique déjà qu’une telle littérature est née dans une situation ambiguë. A une langue donnée correspond une culture spécifique : si l’on s’en tenait à cet axiome, il serait vain de parler de littérature africaine d’expression française. Mais ce serait ne pas compter avec le désir des Africains de maîtriser la langue du colonisateur, et avec la politique d’assimilation pratiquée par la colonisation française; politique, à dire vrai, qui n’a été menée qu’à une certaine époque et dans un nombre limité de pays (au Sénégal en particulier) : à partir de 1920 les autorités coloniales se montrèrent plus soucieuses d’enraciner les Africains dans leur propre culture.
Premières prises de conscience
Bien avant la conquête européenne, l’Afrique subsaharienne s’était déjà trouvée en contact avec une culture venue d’ailleurs. Depuis longtemps l’Islam avait favorisé l’éclosion de centres d’enseignement de langue arabe, de jurisprudence et de théologie, dont les plus célèbres furent Tombouctou et Djenné, au Mali, plus tard le Fouta-Djalon, en Guinée (cf. Alfiâ I. Sow, la Femme, la Vache, la Foi, 1966), et le Fouta-Toro, au Sénégal. Il est intéressant de signaler que, jusqu’à présent, les langues africaines de ces régions s’écrivent encore, dans les milieux islamisés, avec les caractères arabes. La diffusion de ce savoir écrit semble avoir été freinée par son caractère élitiste, les familles de marabouts en étant les dépositaires presque exclusifs. Quant à la rencontre linguistique franco-africaine, elle devait, au départ, servir à asseoir l’autorité coloniale en formant des exécutants capables de comprendre la langue des nouveaux détenteurs du pouvoir. Les écoles fondées à cette fin furent d’abord peu courues : l’une des premières ne s’appelait-elle pas « École des Otages » (créée en 1861, au Sénégal, par Faidherbe)? Mais la rencontre des deux mondes étant irréversible, l’Européen et l’Africain étaient condamnés à se connaître, L.S. Senghor (né en 1906) parlera plus tard de métissage culturel, et le chevalier, personnage de l'Aventure ambiguë (1960) de Cheikh Hamidou Kane (né en 1928), dira à son ami Lacroix : « ... nous n’avons pas eu le même passé, vous et nous, mais nous aurons le même avenir rigoureusement [...] car nul ne peut plus vivre de la seule préservation de soi ». Cette rencontre, cette quête du nouveau savoir marquera profondément l’aventure ambiguë de tous les jeunes intellectuels africains transplantés en Europe; elle fournira à plus d’un futur écrivain les thèmes de l’exil et du déracinement qui eux-mêmes conduiront à l’affirmation d’une identité culturelle africaine et au procès du colonialisme.
La langue française, de ce fait, devient une « parole claire », une « arme miraculeuse » permettant à ses utilisateurs de faire entendre leur voix, d’exposer leurs préoccupations, de dire haut et clair leurs revendications. La communication entre les deux mondes peut alors s’établir. Quelle responsabilité pour les premiers utilisateurs africains de la langue du pouvoir! Quand, à l’heure des indépendances, le français sera déclaré langue offi
cielle, il remplira un rôle non négligeable de communication nationale et internationale qui favorisera l’émergence d’une classe de fonctionnaires, noyau d’une bourgeoisie nouvelle et citadine.
L’emploi exclusif du français sera alors rapidement perçu comme une forme de néocolonialisme, d’aliénation culturelle, et l’idée d’un recours aux langues nationales s’imposera naturellement. Tant il est vrai que tout écrivain nègre a dû, au moins une fois, ressentir un désarroi comparable à celui qu’exprime le poète haïtien Léon Laleau :
... ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France le cœur qui m'est venu du Sénégal.
(« Trahison », Musique nègre, 1931)
Le choix d’enseigner et d’alphabétiser dans les langues nationales aura un caractère nécessairement politique, et dans tous les pays africains francophones, il sera une source de conflit entre écrivains de générations différentes mais de formation somme toute semblable. Pourtant la bibliographie des œuvres en langues nationales se réduit, à ce jour, à quelques dizaines d’ouvrages, d’un intérêt au demeurant parfois discutable. Par contre, de nombreux écrivains utilisent aujourd’hui un français décolonisé et « tropicalisé » (cf. les romans de Kou-rouma, Sony Lab’ou Tansi...) et, de leur propre aveu, estiment avoir dépassé le stade d’une prétendue « aliénation ».
Si l’on remonte aux premières publications objectives sur l’Afrique, loin d’un courant exotique au goût souvent douteux, on constate assez vite le souci d’introduire l’autre à l’essence de l’africanité par des écrits que l’on peut qualifier d’ethnologiques ou encore par des traités grammaticaux et philologiques.
Déjà, au XIXe siècle, le métis sénégalais David Boilat ou l’« abbé Boilat» (1814-1901) donne d’attachantes Esquisses sénégalaises (1853), suivies d’une Grammaire de la langue ouolof (1858), pour laquelle il reçut, parrainé par Prosper Mérimée, le 2e prix Volney, alors que le gouverneur Faidherbe n’obtenait que le 1er accessit. En 1843, il avait achevé une présentation des Mœurs et coutumes des Maures du Sénégal : prières publiques des mahométans de Sénégambie. Cet ouvrage semble avoir été parrainé par le baron Roger, un Français, qui, lui-même, avait déjà publié en 1828 des Fables sénégalaises recueillies dans FOuolof Toujours au XIXe siècle, un métis, Paul Holle, en collaboration avec Carrère, publiera une monographie sur la Sénégambie française en 1855.
Au début de ce siècle, l’interprète malien Moussa Travelé continuera cette introduction à l’univers africain en publiant, entre 1913 et 1929, un Petit Dictionnaire bambara-français et français-bambara, un recueil de Proverbes et contes bambara (1923, précédé d’un abrégé de droit coutumier) et un Manuel français-bambara. Évidemment, ses fonctions d’interprète le prédisposaient à de telles publications. La période d’avant la Première Guerre mondiale et la période de l’entre-deux-guerres furent, à cet égard, prodigues en publications ethnologiques dues à des Européens, surtout des administrateurs, mais également aux nouveaux métis culturels qu’étaient les instituteurs et les interprètes africains.
C’est à cette époque que se firent connaître les grands africanistes européens, l’un des plus marquants étant l’Allemand Léo Frobenius dont l’Histoire de la civilisation africaine (1898) fut publiée dans sa traduction française en 1936 (Gallimard). Ses travaux eurent la faveur des Africains et L.S. Senghor allait jusqu’à affirmer que Frobenius restituait aux étudiants africains de sa génération leur authenticité et leur « dignité ». Du côté français, il faut signaler Jean Paulhan, traducteur en 1913 des Hain-îenys mérinas, ballades populaires malgaches, et....
Les conteurs qui furent les plus heureux transcripteurs de textes oraux sont les poètes Birago Diop et Bernard Dadié. Diop, médecin vétérinaire, camarade d’étude du groupe Senghor-Césaire-Damas, allie dans sa prose sensibilité, humour, finesse psychologique. Ses œuvres, les Contes d’Amadou Koumba (1947), les Nouveaux Contes d'Amadou Koumba (1958), Contes et lavanes (1963), Contes d’Awa (1977), ont fait autant pour la revalorisation de la culture nègre que maint essai théorique. Bernard Dadié, poète, dramaturge (les Voix dans le vent, 1970), romancier, est l’auteur de Légendes africaines (1954) et de recueils de contes, le Pagne noir (1955), les Contes de Koutou-As-Samala (1982).
Dans les productions romanesques, certains textes sont plus difficiles à situer. Tel est le cas du roman noir de Olympe Bhely Quenum (né en 1928), Un piège sans fin (1960). Camara Laye, avec son Regard du roi (1954), si différent de son premier livre, avait dérouté, en permettant toutes les interprétations possibles de cette allégorie romanesque. Parmi les inclassables, l'Étrange Destin de Wangrin (1973), d’Amadou Hampaté Bâ, qui décrit la vie d’un interprète de l’Afrique coloniale, est un document plein de vie, éclairant les aspects cachés d'un homme qui fait fonctionner les puissants comme des marionnettes; le Devoir de violence (1968), du Malien Yambo Ouologuem (né en 1940), qui détruit tous les clichés admis sur l’Afrique précoloniale telle que certains ethnologues la décrivaient, obtint le prix Théophraste-Renaudot mais fut vivement critiqué; la Place (1967), du Sénégalais Malick Fall (né en 1920), est d’une belle écriture.
En reprenant la chronologie des publications romanesques, on constate d’une manière générale que l’époque d'après les indépendances marque un tournant décisif. Le roman, autour de 1968, va dresser un bilan peu rassurant de l’usage que font les politiques de leurs indépendances : les abus, les exactions, les répressions vont être dénoncés sans complaisance. Dans un numéro spécial de la revue Présence africaine de 1967, Mélanges 1947-1967, publié pour fêter les vingt ans de la revue, Jean Ikelle-Matiba propose : « Dans la décennie qui commence, Présence africaine devrait éviter de servir la “raison d’État”. Démocrates, nous devrions accepter l’humour, le sarcasme, détruire l’unanimisme, vestige d’un passé remis en question... ». Cette injonction, les romanciers semblent l’avoir « entendue ». Le marasme économico-culturel issu d’orientations politiques souvent peu adaptées à la réalité africaine est dénoncé sur le mode humoristique et sarcastique. Mais la qualité d’écoute de la plupart des régimes « unanimistes » paraît s’être particulièrement atténuée depuis que le verbe est écrit et n’est plus porté par le griot. Ce sont les écrivains qui en subissent les conséquences : il arrive qu’ils soient comblés de louanges, mais souvent ils font l’amère expérience de la prison ou de l’exil; parmi les récits relatant leur désillusion figure l’un des romans africains qui fait
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA LITTÉRATURE NÉGRO-AFRICAINE DE LANGUE FRANÇAISE
- ÉGYPTE. Littérature égyptienne d'expression française
- MAGHREB. Littérature d'expression française
- CARAÏBES et GUYANE. Littérature d’expression française.
- BELGIQUE. Littérature d'expression française. L'influence de la Belgique sur la littérature française