MICHAUX Henri : sa vie et son oeuvre
Publié le 24/11/2018
Extrait du document
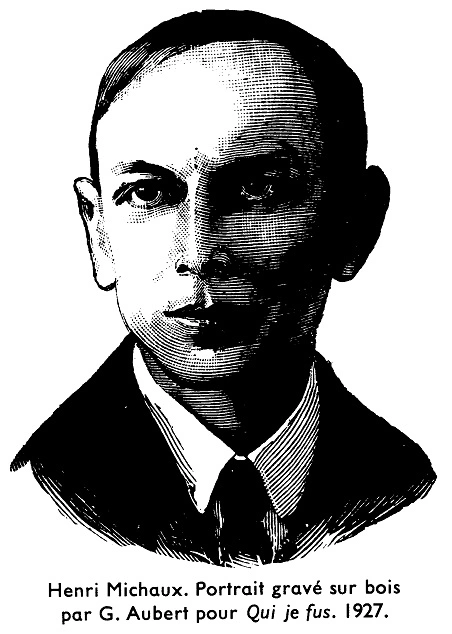
MICHAUX Henri (1899-1984). D’origine belge, ce poète à qui « son siècle portait ombrage » s’est toujours voulu « ailleurs », hors cadre et en marge des mouvements qui défrayèrent la chronique littéraire, refusant la consécration officielle du grand prix national des Lettres qui lui fut décerné en 1965. Tenace et rigoureuse, l’œuvre née de cette solitude à contre-jour laisse, d’un auteur si peu sûr de son visage qu’il tenta longtemps d’empêcher la reproduction et la publication d’une ou deux photos de lui, l’image d’un homme qui eut, selon le mot de Cioran, « la passion de l’exhaustif » : cherchant sans
cesse, en lui et hors de lui, à ses risques et périls et par tous les moyens possibles (poésie, peinture, musique, observation clinique), de l’inconnu, sans préjuger jamais de sa découverte.
Sous la faiblesse, la force
Michaux a regroupé sous le titre volontairement objectif « Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence » (1958) les données principales de sa biographie. Naissance à Namur « dans une famille bourgeoise » à la « lointaine ascendance espagnole ». Lui l’« insoumis », l’irréductible, on s’efforce en vain de le briser en l’envoyant (pour sa santé, sûrement) dans un pensionnat « pauvre, dur et froid » de petits paysans flamands. Dépaysement moins grand que celui d'être au monde : la résistance passive s’organise, il devient cet émigré de l’intérieur qu’il ne cessera d’être toute sa vie. Il rentre à Bruxelles, où il va poursuivre ses études chez les jésuites. Plus tard, en 1920, il abandonne sa médecine et embarque à Boulogne-sur-Mer comme matelot sur un schooner. Mais avec le désarmement international des bateaux, la « grande fenêtre se referme », il doit revenir «à la ville et aux gens détestés» : c’est en 1921 ce qu’il ressent comme le « sommet de la courbe du raté ». Retour au pays natal — si peu aimé pour y avoir été mal aimé — qu’il quitte définitivement pour se fixer à Paris. Il part pour l’Equateur « avec et chez son ami le poète Alfredo Gangotena ». Après la mort de ses parents, on le retrouve en Turquie, en Italie et en Afrique du Nord, où il voyage « contre », pour « expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes sortes et ce qui s’est, en lui et malgré lui, attaché de culture grecque ou romaine ou germanique ou d'habitudes belges ». Mais, le refus cédant au « désir d’assimilation », il découvre en Asie « enfin son voyage» (1930-1931). D’autres voyages suivront, et c’est l’Occupation allemande, « la seconde pour lui ». Après la mort de sa femme, « il écrit de moins en moins, il peint davantage » et, en 1956, fait sa première expérience de la mescaline. En 1957, une fracture du coude droit rend sa main inutilisable : c’est la « découverte » en lui de l’« homme gauche ».
Plus que par ses dates et les renseignements organisés en fiche d’état civil, l’autobiographie d’Henri Michaux, écrite à la troisième personne, vaut par les précisions qu’elle donne sur ce que R. Dadoun appelle ses « états énergétiques ». L’existence bruxelloise concentre les traits d’une enfance «qui n’a pas eu son compte». « Indifférence. Inappétence. Résistance... Sa moelle ne fait pas de sang, son sang ne fait pas d’oxygène. Anémie ». Déterminant son existence, l’axe de la faiblesse et de la déficience traverse tout le texte jusqu’à l’indication finale, signalant l’apparition d’une « ostéoporose », comme si les os eux-mêmes se faisaient complices du manque, de l’évidement, chez celui qui, dans Ecuador (1929), s’écrie : «Je suis né troué». D’où la difficulté d’exister évoquée en plusieurs points de cette vie qu’habite la nostalgie beckettienne de « l’anti-vie » (cf. l’éloge de la paresse, le désir d’« hiberner» et le rêve « d’être agréé comme plante »). Même lorsqu’il écrit, il se voit « toujours réticent », « partagé » : « ça empêche de rêver. Ça le fait sortir », car « il préfère rester lové ». Ce peu d'être, honteux de n’être que ce qu’il est, Henri Michaux l’entend sonner creux jusque dans son nom alors qu’il rêve « d’un pseudonyme qui l’englobe, lui, ses tendances et ses virtualités ». Mais « il continue à signer de son nom vulgaire... », pareil à une étiquette qui porterait la mention « qualité inférieure », trouvant dans la fidélité au « mécontentement et à l’insatisfaction » le moyen de se préserver « du sentiment même réduit de triomphe et d’accomplissement ». Rien d’étonnant alors si l’œuvre se donne à voir sous la menace de son propre effondrement, dans la hantise de sa propre ruine : « Je me suis bâti sur une colonne absente ».
Or, contredisant l’asthénie, l’atonie, le repli sur soi, voici les moments « chocs », les passages de lumière et de fulguration : vers douze ans, « découverte » du dictionnaire et des « mots qui n’appartiennent pas encore à des phrases, pas encore à des phraseurs, des mots et en quantité et dont on pourra se servir soi-même et à sa façon ». Lui, l’« inintéressé », il s’intéresse au latin, « belle langue qui le sépare des autres, le transplante; son premier départ... le premier effort qui lui plaise ». Quelques années plus tard, « première composition française : un choc pour lui qui a fait ses études en flamand », et bientôt « lectures en tous sens pour découvrir... ceux qui peut-être savent » (Hello, Ruysbroeck, Tolstoï, Dostoïevski). En 1922, la lecture de Maldoror, prolongée en 1925 par une étude, « le Cas Lautréamont », publiée dans la revue belge le Disque vert, « déclenche en lui le besoin longtemps oublié d’écrire ». Prolongeant le choc scriptural, le choc pictural de 1925 (« Klee, puis Ernst, Chi-rico... ») ouvre à Michaux la voie de plus en plus efficace et glorieuse de la peinture. « Sursaut », « surprise », déclenchement : ainsi la découverte des signes agit comme appel dynamogène de l’énergie, qui, mobilisée, va se mettre à produire. Du coup, cette vie appauvrie est comme soulevée par une envie à la mesure de son vide : appel d’air, appel d’être, les forces de dessaisissement (« vent terrible », « effroi », « rage », « haine », dont le forage à froid fore « inlassablement », « comme sur une solive de hêtre deux cents générations de vers ») s'entendent comme effort battant l’aire où se libèrent les formes, immenses forêts de l’être, étranges forêts de lettres.
Carnets de voyages
Lorsque, dans Passages (1950), Michaux s’interroge sur ce qui unifie la diversité de sa pratique créatrice, il recourt à des termes spatiaux pour signifier le trajet jamais achevé où, se fiant au mouvement pour mieux fuir l’acquis d’un résultat, se réalise la fusion d’un faire et d’un vivre : « J’écris pour me parcourir. Peindre composer écrire : me parcourir. Là est l’aventure d'être en vie... je fais surtout de l’occupation progressive ». L’écriture comme parcours exigeant, pour se déployer, du temps et de l’espace, entre 1920 et 1957 toute une série de voyages réels ou imaginaires et, à partir de 1956, l'exploration d’un autre monde, celui de la mescaline, témoignent de cette recherche de l’« essentiel, le secret qu’il a depuis sa première enfance soupçonné d’exister quelque part ». Les livres qui en résultent, en porte à faux sur la littérature, se présentent d’abord comme des comptes rendus d’exploration, des journaux de bord dont l’objet est de faire le point, d’inscrire les étapes d’une découverte. Dès Qui je fus (1927), malgré son cœur frêle, pompant mal, Michaux apparaît en voyageur, « la valise faite en un tournemain », choisissant, comme Rimbaud, le départ, la déliaison, même si c’est au prix d’un déchirement (« Adieu à une ville et à une femme »). Suivent des livres dont le titre renvoie à des pays réels, dont on peut lire le nom sur les cartes : Ecuador (1929), Un barbare en Asie (1933). Le premier porte le sous-titre « Journal de voyage », aussitôt contredit par la préface : « Un homme qui ne sait ni voyager ni tenir un journal a composé ce journal de voyages ». Aussi, même si elle correspond à un séjour effectué en 1927, cette découverte de l’Equateur est essentiellement une découverte de soi. Passé l’exaltation du départ, Michaux dit sa désillusion à propos du voyage : « Je n’ai écrit que ce peu qui précède et déjà je tue ce voyage »; sa déception devant l’Equateur : « l’Equateur est grand, qu’il le montre! »; son découragement face à l’effrayant duo, duel andin, sur fond nu, noir, massif de montagnes en surplomb
qu’affronte quotidiennement le « pèlerinage voûté » des Indiens écrasés, « trapus, brachycéphales », dans un mouvement d’épuisement généralisé : « voix basse, petit pas, petit souffle,/Peu se disputent les chiens, peu les enfants, peu rient »; son dépit de ne trouver que « vallée riante», «jardins japonais», «douceur d’intérieur», « abri », « site pour pique-nique », quand, galvanisé par le défi, il était « venu pour chercher du volcan » en entreprenant l’ascension de l’Atacatzho (4 536 mètres). Sous l’observateur veille un moraliste qui, dans le voyageur, condamne le touriste : « Ce voyage est une gaffe. Le voyage ne rend pas tant large que mondain “au courant”, gobeur de l’intéressant coté, primé avec le stupide air de faire partie d’un jury de prix de beauté. On trouve aussi bien sa vérité en regardant quarante-huit heures une quelconque tapisserie de mur ». Pressentant, comme Lévi-Strauss, « la fin des voyages », Michaux, cet « affamé de plus grand », voit la terre « rincée de son exotisme », « misérable banlieue » prisonnière de la « crise de la dimension ». Enfin le lecteur des « Vies » des saints, « des plus surprenants, des plus éloignés de l’homme moyen », tenté, au seuil de l’adolescence, par la vie monastique, découvre, à travers l’Indien, « un homme comme tous les autres, prudent, sans départs, qui n’arrive à rien, qui ne cherche pas, l’homme comme ça ».
Il faut attendre le voyage en Inde pour que la rencontre exaltante ait lieu. Michaux voit dans les Hindous « le premier peuple qui en bloc paraisse répondre à l’essentiel, qui dans l’essentiel cherche l’assouvissement ». Né de ce contact, Un barbare en Asie semble accorder plus de réalité au pays observé qu’à l’observateur : « Quand je vis l’Inde et quand je vis la Chine, pour la première fois des peuples sur cette terre me parurent mériter d’être réels ». Pourtant l'attention de cet observateur, qui, dans la préface de 1967, regrettera d’avoir laissé de côté « ce qui allait faire dans plusieurs de ces pays de la réalité nouvelle : la politique », révèle la même préoccupation : au-delà des faits, rejoindre l’être, remonter l’histoire à partir de « l’homme de la rue, l’homme qui joue de la flûte, l’homme qui joue dans un théâtre, l’homme qui danse et qui fait des gestes ». Déchiffrés comme autant de gestes signifiants, langues, musique, peinture, théâtre, vêtement se prêtent à la sémiologie expérimentale de Michaux. Paradoxalement, la haine de la figure, qui, dans le tatouage des Indiens, apprécie le moyen de la « faire disparaître », fait place à la fascination du visage : visages de Chinois « huilés de sagesse », par rapport auxquels les Européens paraissent asservis à la bestialité de leurs « groins de sangliers »; visages de vieillards hindous « véritables pères de l’humanité »; visage de la jeune Népalaise aperçue à Darjeeling, offrant au « voyageur émerveillé » le « premier sourire de la race jaune, le plus beau du monde », et préfigurant le visage des jeunes filles chinoises « où la Chine a toujours quinze ans... visage fragile... musical, qu’une lampe intérieurement compose plus que les traits » (Passages). Mais, dans cet Orient extrême où se situe le Japon, sans fleuve et sans espace, sagesse, spiritualité, beauté deviennent l’agressivité d’un pays qui rivalise avec l’Occident pour coloniser, conquérir, industrialiser, battre des records; la médiocrité d’une « religion d’insectes » impersonnelle et ritualisée à l’extrême; l’artifice et la sophistication d’un vêtement qui fait de la femme « cette création malheureuse d’un peuple d’esthètes et de sergents ». L’Europe encore, celle de Kant et de la Loi morale, inspire la critique du théâtre japonais, perverti par la « Voix du Peuple, sentant à mille lieues le préjugé et la vie prise par le mauvais bout... voix de l’impératif catégorique ». Pratiquant le voyage avec le décentrement des philosophes du xvme siècle, Michaux voit dans le Japon la plaque sensible de « notre mal et de notre civilisation ». L’Orient du refuge et du refus de l’Occident incite donc
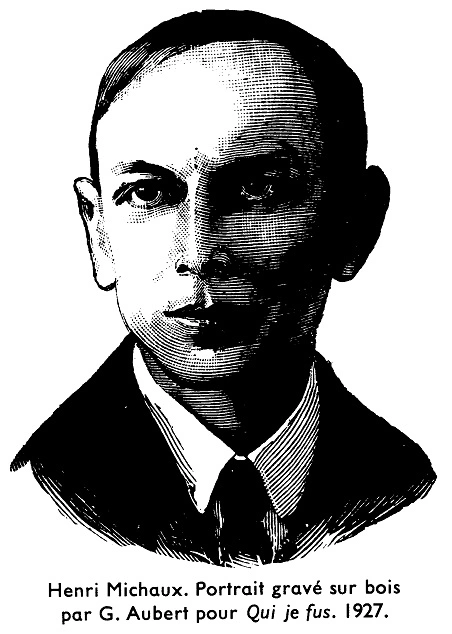
«
effondrement,
dans la hantise de sa propre ruine : « Je
me suis bâti sur une colonne absente».
Or, contredisant l'asthénie, l'atonie, le repli sur soi,
voici les moments >, il s'intéresse au latin,
« belle langue qui Je sépare des autres, Je transplante;
son premier départ...
Je premier effort qui lui plaise >>.
Quelques années plus tard, « première composition fran
çaise : un choc pour lui qui a fait ses études en flamand »,
et bientôt « lectures en tous sens pour découvrir.
..
ceux
qui peut-être savent» (Hello, Ruysbroeck, Tolstoï, Dos
toïevski).
En 1922, la lecture de Maldoror, prolongée en
1925 par une étude, « Je Cas Lautréamont >> , publiée dans
la revue belge le Disque vert, «déclenche en lui le besoin
longtemps oublié d'écrire >>.
Prolongeant Je choc scriptu
ral, le choc pictural de J 925 ( « Klee, puis Ernst, Chi
rico ...
>>)ouvre à Michaux la voie de plus en plus efficace
et glorieuse de la peinture.
« Sursaut», « surprise >>,
déclenchement : ainsi la découverte des signes agit
comme appel dynamogène de l'énergie, qui, mobilisée,
va se mettre à produire.
Du coup, cette vie appauvrie est
comme soulevée par une envie à la mesure de son vide :
appel d'air, appel d'être, les forces de dessaisissement
( « vent terrible», « effroi », «rage>>, «haine>>, dont le
forage à froid fore (( inlassablement >>, « comme sur une
solive de hêtre deux cents générations de vers ») s'enten
dent comme effort battant 1' aire où se libèrent les formes,
immenses forêts de l'être, étranges forêts de lettres.
Carnets de voyages
Lorsque, dans Passages (1950), Michaux s'interroge
sur ce qui unifie la diversité de sa pratique créatrice, il
recourt à des termes spatiaux pour signifier Je trajet
jamais achevé où, se fiant au mouvement pour mieux
fuir l'acquis d'un résultat, se réalise la fusion d'un faire
et d'un vivre: «J'écris pour me parcourir.
Peindre com
poser écrire : me parcourir.
Là est J'aventure d'être en
vie ...
je fais surtout de .l'occupation progressive>>.
L'écriture comme parcours exigeant, pour se déployer,
du temps et de 1 'espace, entre 1920 et 1957 toute une
série de voyages réels ou imaginaires et, à partir de 1956,
l'exploration d'un autre monde, celui de la mescaline,
témoignent de cette recherche de l'« essentiel, Je secret
qu'il a depuis sa première enfance soupçonné d'exister
quelque part>>.
Les livres qui en résultent, en porte à
faux sur la littérature, se présentent d'abord comme des
comptes rendus d'exploration, des journaux de bord dont
l'objet est de faire le point, d'inscrire les étapes d'une
découverte.
Dès Qui je fus ( 1927), malgré son cœur frêle,
pompant mal, Michaux apparaît en voyageur, « la valise
faite en un tournemain >>, choisissant, comme Rimbaud,
le départ, la déliaison, même si c'est au prix d'un déchi
rement («Adieu à une ville et à une femme>>).
Suivent
des livres dont le titre renvoie à des pays réels, dont on
peut lire le nom sur les cartes : Ecuador ( 1929), Un
barbare en Asie (1933).
Le premier porte Je sous-titre
«Journal de voyage >>, aussitôt contredit par Ja préface :
« Un homme qui ne sait ni voyager ni tenir un journal a
composé ce journal de voyages >>.
Aussi, même si elle
correspond _à un séjour effectué en 1927, cette décou
verte de 1' Equateur est essentiellement une découverte
de soi.
Passé l'exaltation du départ, Michaux dit sa désil
lusion à propos du voyage : « Je n'ai écrit que ce peu qui
pr�cède et déjà j� tue ce voyage>>; sa déception devant
l'Equateur : «l'Equateur est grand, qu'il le montre! >>;
son découragement face à l'effrayant duo, duel andin,
sur fond nu, noir, massif de montagnes en surplomb --·-- -·--------
qu'affronte quotidiennement Je « pèlerinage voûté >> des
Indiens écrasés, « trapus, brachycéphales >>, dans un
mouvement d'épuisement généralisé : « voix basse, petit
pas, petit souffle,/Peu se disputent les chiens, peu les
enfants, peu rient»; son dépit de ne trouver que « vallée
riante>> , «jardins japonais>>, «douceur d'intérieur>>,
« abri », « site pour pique-nique », quand, galvanisé par
le défi, il était « venu pour chercher du volcan >>en entre
prenant l'ascension de l' Atacatzho (4 536 mètres).
Sous
l'observateur veille un moraliste qui, dans le voyageur,
condamne le touriste : « Ce voyage est une gaffe.
Le
voyage ne rend pas tant large que mondain "au courant",
gobeur de 1' intéressant coté, primé avec le stupide air de
faire partie d'un jury de prix de beauté.
On trouve aussi
bien sa vérité en regardant quarante-huit heures une quel
conque tapisserie de mur».
Pressentant, comme Lévi
Strauss, « la fin des voyages >>, Michaux, cet , voit la terre «rincée de son exotisme>> ,
« misérable banlieue >> prisonnière de la « crise de la
dimension>>.
Enfin le lecteur des « Vies >> des saints,
>.
Né
de ce contact, Un barbare en Asie semble accorder plus
de réalité au pays observé qu'à l'observateur : «Quand
je vis l'Inde et quand je vis la Chine, pour la première
fois des peuples sur cette terre me parurent mériter d'être
réels >>.
Pourtant J'attention de cet observateur, qui, dans
la préface de 1967, regrettera d'avoir laissé de côté >.
Déchiffrés comme autant
de gestes signifiants, langues, musique, peinture, théâtre,
vêtement se prêtent à la sémiologie expérimentale de
Michaux.
Paradoxalement, la haine de la figure, qui,
dans le tatouage des Indiens, apprécie le moyen de la
« faire disparaître >>, fait place à la fascination du visage :
visages de Chinois «huilés de sagesse>> , par rapport
auxquels les Européens paraissent asservis à la bestialité
de leurs «groins de sangliers»; visages de vieillards
hindous > (Passages).
Mais,
dans cet Orient extrême où se situe Je Japon, sans fleuve
et sans espace, sagesse, spiritualité, beauté deviennent
l'agressivité d'un pays qui rivalise avec l'Occident pour
coloniser, conquérir, industrialiser, battre des records; la
médiocrité d'une« religion d'insectes >> impersonnelle et
ritualisée à 1' extrême; J'artifice et la sophistication d'un
vêtement qui fait de la femme « cette création malheu
reuse d'un peuple d'esthètes et de sergents>>.
L'Europe
encore, celle de Kant et de la Loi morale, inspire la
critique du théâtre japonais, perverti par la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- UN CERTAIN PLUME d'Henri Michaux (résumé et analyse de l'oeuvre)
- BLOY Léon Henri Marie : sa vie et son oeuvre
- VIE DANS LES PLIS (La). Henri Michaux (résumé)
- Julien, Henri - vie et oeuvre du peintre.
- Valenciennes, Pierre Henri de - vie et oeuvre du peintre.

































