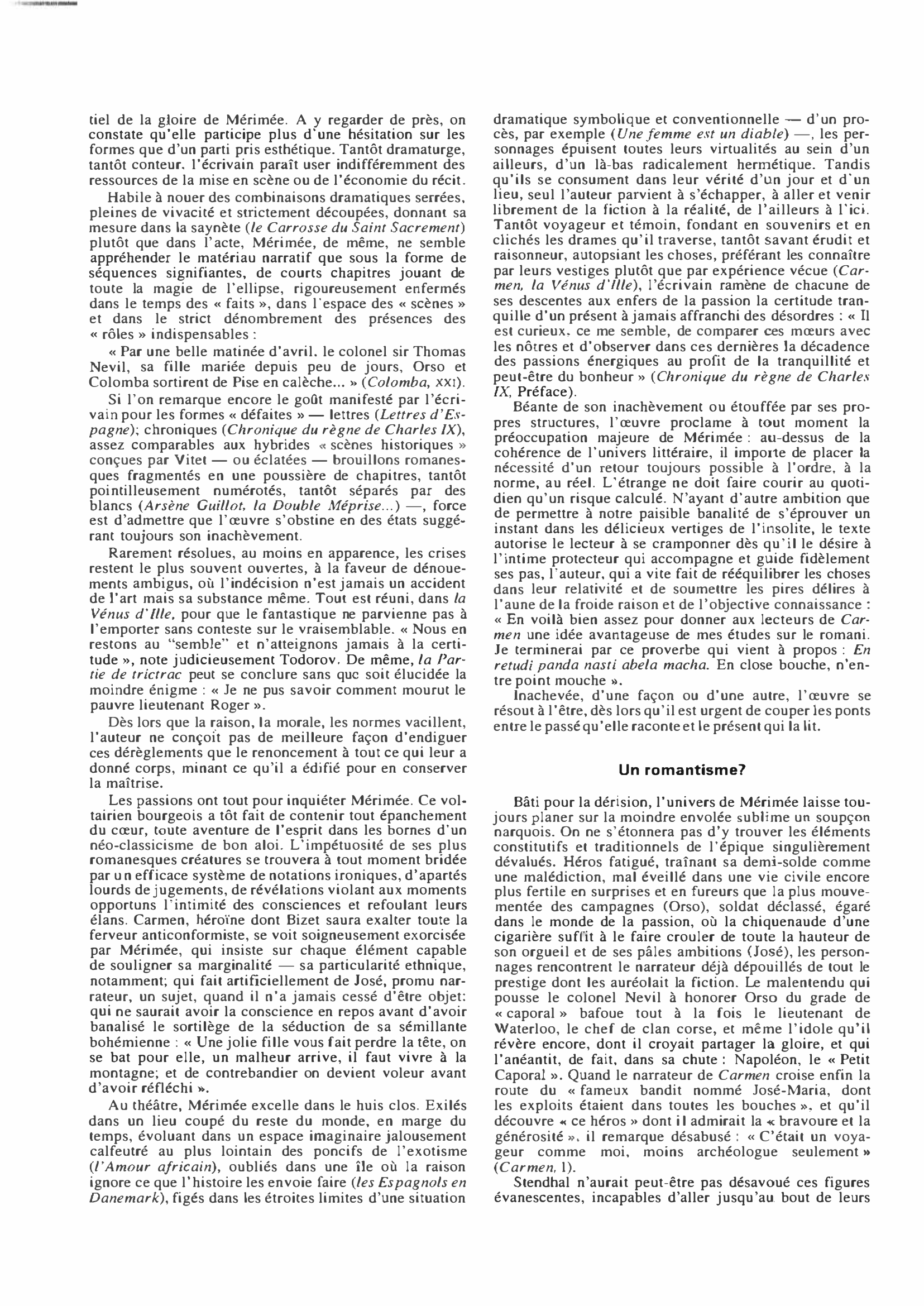MÉRIMÉE Prosper : sa vie et son oeuvre
Publié le 24/11/2018
Extrait du document
«
tiel
de la gloire de Mérimée.
A y regarder de près, on
constate qu'elle participe plus d'une hésitation sur les
formes que d'un parti pris esthétique.
Tantôt dramaturge,
tantôt conteur, J'écrivain paraît user indifféremment des
ressources de la mise en scène ou de l'économie du récit .
Habile à nouer des combinaisons dramatiques serrées,
pleines de vivacité et strictement découpées, donnant sa
mesure dans la saynète (le Carro sse du Saint Sacrement)
plutôt que dans 1' acte, Mérimée, de même, ne semble
appréhender le matériau narratif que sous la forme de
séquences signifiantes, de courts chapitres jouant de
toute la magie de l'ellipse, rigoureusement enfermés
dans le temps des «faits», dans l'espace des «scènes»
et dans le strict dénombrement des présences des
« rôles » indispensables :
« Par une belle matinée d'avril, le colonel sir Thomas
Nevil, sa fille mariée depuis peu de jours, Orso et
Colomba sortirent de Pise en calèche ...
» (Colomba, XXI).
Si l'on remarque encore le goOt manifesté par l'écri
vain pour les formes « défaites » -lettres (Lettres d'Es
pagne); chroniques (Chronique du règne de Charles IX),
assez comparables aux hybrides « scènes historiques »
conçues par Vitet -ou éclatées -brouillons romanes
ques fragmentés en une poussière de chapitres, tantôt
poi nti lleusement numérotés, tantôt séparés par des
blancs (Arsène Guillot, la Double Méprise ...
) -, force
est d'admettre que l'œuvre s'obstine en des états suggé
rant toujours son inachèvement.
Rarement résolues, au moins en apparence, les crises
restent le plus souvent ouvertes, à la faveur de dénoue
ments ambigus, oi:t l'indécision n'est jamais un accident
de l'art mais sa substance même.
Tout est réuni, dans la
Vénus d'Ille, pour que le fantastique ne parvienne pas à
l'emporter sans conteste sur le vraisemblable.
« Nous en
restons au "semble" et n'atteignons jamais à la certi
tude», note judicieusement Todorov.
De même, la Par
tie de trictrac peut se conclure sans que soit élucidée la
moindre énigme : « Je ne pus savoir comment mourut le
pauvre lieutenant Roger».
Dès lors que la �aison, la morale, les normes vacillent,
l'auteur ne conçoit pas de meilleure façon d'endiguer
ces dérèglements que le renoncement à tout ce qui leur a
donné corps, minant ce qu'il a édifié pour en conserver
la maîtrise.
Les passions ont tout pour inquiéter Mérimée.
Ce vol
tairien bourgeois a tôt fait de contenir tout épanchement
du cœur, toute aventure de l'esprit dans les bornes d'un
néo-classicisme de bon aloi.
L'impétuosité de ses plus
romanesques créatures se trouvera à tout moment bridée
par un efficace système de notations ironiques, d'apartés
lourds de jugements, de révélations violant aux moments
opportuns l'intimité des consciences et refoulant leurs
élans.
Carmen, héroïne dont Bizet saura exalter toute la
ferveur anticonformiste, se voit soigneusement exorcisée
par Mérimée.
qui insiste sur chaque élément capable
de souligner sa marginalité -sa particularité ethnique,
notamment; qui fait artificiellement de José, promu nar
rateur, un sujet, quand il n'a jamais cessé d'être objet:
qui ne saurait avoir la conscience en repos avant d'avoir
banalisé le sortilège de la séduction de sa sémillante
bohémienne : «Une jolie fille vous fait perdre la tête, on
se bat pour elle, un malheur arrive, il faut vivre à la
montagne; et de contrebandier on devient voleur avant
d'avoir réfléchi».
Au théâtre, Mérimée excelle dans le huis clos.
Exilés
dans un lieu coupé du reste du monde, en marge du
temps, évoluant dans un espace imaginaire jalousement
calfeutré au plus lointain des poncifs de l'exotisme
(l'Amour africain), oubliés dans une île où la raison
ignore ce que l'histoire les envoie faire (les Espagnols en
Danemark), figés dans les étroites limites d'une situation dramatique
symbolique et conventionnelle- d'un pro
cès, par exemple (Une femme est un diable) -, les per
sonnages épuisent toutes leurs virtualités au sein d'un
ailleurs, d'un là-bas radicalement hermétique.
Tandis
qu'ils se consument dans leur vérité d'un jour et d'un
lieu, seul l'auteur parvient à s'échapper, à aller et venir
librement de la fiction à la réalité, de l'ailleurs à 1 'ici.
Tantôt voyageur et témoin, fondant en souvenirs et en
clichés les drames qu'il traverse, tantôt savant érudit et
raisonneur, autopsiant les choses, préférant les connaî'tre
par leurs vestiges plutôt que par expérience vécue (Car
men, la Vénus d'Ille), l'écrivain ramène de chacune de
ses descentes aux enfers de la passion la certitude tran
quille d'un présent à jamais affranchi des désordres :« Il
est curieux, ce me semble, de comparer ces mœurs avec
les nôtres et d'observer dans ces dernières la décadence
des passions énergiques au profit de la tranquillité et
peut-être du bonheur» (Chronique du règne de Charles
IX, Préface).
Béante de son inachèvement ou étouffée par ses pro
pres structures, l'œuvre proclame à tout moment la
préoccupation majeure de Mérimée : au-dessus de la
cohérence de l'univers littéraire, il importe de placer la
nécessité d'un retour toujours possible à l'ordre, à la
norme, au réel.
L'étrange ne doit faire courir au quoti
dien qu'un risque calculé .
N'ayant d'autre ambition que
de permettre à notre paisible banalité de s'éprouver un
instant dans les délicieux vertiges de l'insolite, le texte
autorise le lecteur à se cramponner dès qu'il le désire à
l'intime protecteur qui accompagne et guide fidèlement
ses pas, l'auteur, qui a vite fait de rééquilibrer les choses
dans leur relativité et de soumettre les pires délires à
l'aune de la froide raison et de l'ob jective connaissance :
> dont il admirait la « bravoure et la
générosité », il remarque désabusé :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Vénus d’Ille 1837 Prosper Mérimée (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- CARMEN. Roman de Prosper Mérimée (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- CARMEN Prosper Mérimée. Nouvelle - résumé de l'oeuvre
- VASE ÉTRUSQUE (Le). de Prosper Mérimée (résumé & analyse de l’oeuvre)
- VÉNUS D’ILLE (La). de Prosper Mérimée (résumé & analyse de l’oeuvre)