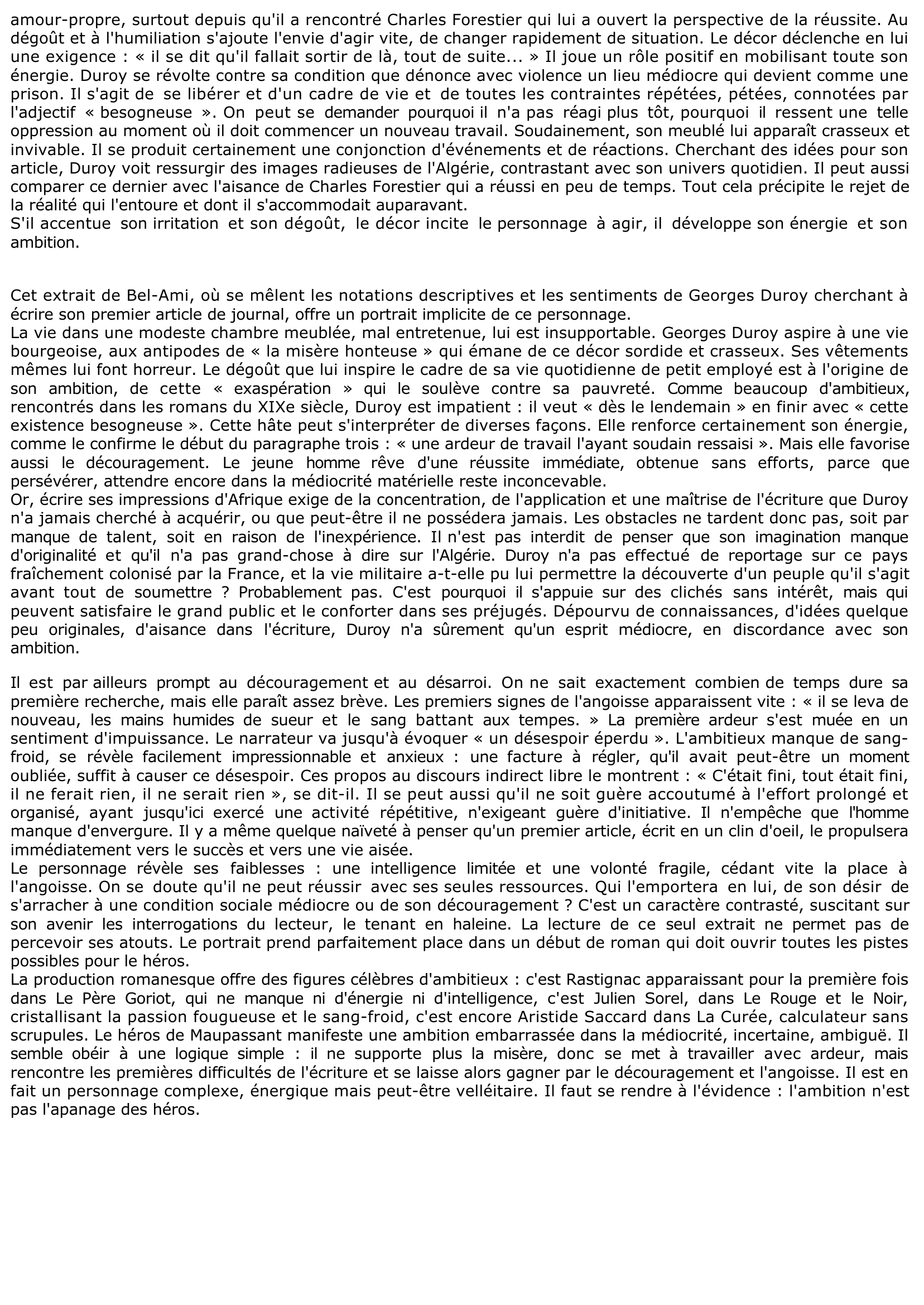MAUPASSANT, Bel-Ami, chapitre III - 3
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
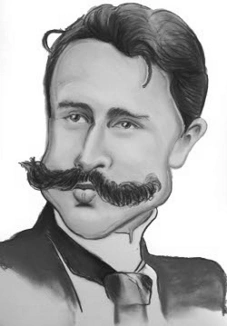
Sur son petit lit de fer, où la place de son corps avait fait un creux, il aperçut ses habits de tous les jours jetés là, vides, fatigués, flasques, vilains comme des hardes de la Morgue. Et, sur une chaise de paille, son chapeau de soie, son unique chapeau, semblait ouvert pour recevoir l'aumône. Ses murs, tendus d'un papier gris à bouquets bleus, avaient autant de taches que de fleurs, des taches anciennes, suspectes, dont on n'aurait pu dire la nature, bêtes écrasées ou gouttes d'huile, bouts de doigts graissés de pommade ou écume de la cuvette projetée pendant les lavages. Cela sentait la misère honteuse, la misère en garni de Paris. Et une exaspération le souleva contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait sortir de là, tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence besogneuse....
Le passage montre clairement les impressions de Georges Duroy promenant son regard sur sa chambre et sur ses vêtements. On peut même dire que ce décor détermine sa conduite. Nous l'avons observé, tous les détails descriptifs dénoncent la pauvreté d'un logement parisien, abritant ouvriers, domestiques ou petits employés. Les nombreux adjectifs qualifiant les vêtements du personnage en soulignent l'usure. Ces habits sont presque parlants, ainsi le chapeau évoque la mendicité : « semblait ouvert pour recevoir l'aumône «. Les murs de la chambre, maculés de taches diverses, inspirent le dégoût de Duroy et des lecteurs. Ce décor est fortement expressif.
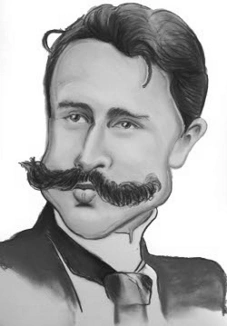
«
amour-propre, surtout depuis qu'il a rencontré Charles Forestier qui lui a ouvert la perspective de la réussite.
Audégoût et à l'humiliation s'ajoute l'envie d'agir vite, de changer rapidement de situation.
Le décor déclenche en luiune exigence : « il se dit qu'il fallait sortir de là, tout de suite...
» Il joue un rôle positif en mobilisant toute sonénergie.
Duroy se révolte contre sa condition que dénonce avec violence un lieu médiocre qui devient comme uneprison.
Il s'agit de se libérer et d'un cadre de vie et de toutes les contraintes répétées, pétées, connotées parl'adjectif « besogneuse ».
On peut se demander pourquoi il n'a pas réagi plus tôt, pourquoi il ressent une telleoppression au moment où il doit commencer un nouveau travail.
Soudainement, son meublé lui apparaît crasseux etinvivable.
Il se produit certainement une conjonction d'événements et de réactions.
Cherchant des idées pour sonarticle, Duroy voit ressurgir des images radieuses de l'Algérie, contrastant avec son univers quotidien.
Il peut aussicomparer ce dernier avec l'aisance de Charles Forestier qui a réussi en peu de temps.
Tout cela précipite le rejet dela réalité qui l'entoure et dont il s'accommodait auparavant.S'il accentue son irritation et son dégoût, le décor incite le personnage à agir, il développe son énergie et sonambition.
Cet extrait de Bel-Ami, où se mêlent les notations descriptives et les sentiments de Georges Duroy cherchant àécrire son premier article de journal, offre un portrait implicite de ce personnage.La vie dans une modeste chambre meublée, mal entretenue, lui est insupportable.
Georges Duroy aspire à une viebourgeoise, aux antipodes de « la misère honteuse » qui émane de ce décor sordide et crasseux.
Ses vêtementsmêmes lui font horreur.
Le dégoût que lui inspire le cadre de sa vie quotidienne de petit employé est à l'origine deson ambition, de cette « exaspération » qui le soulève contre sa pauvreté.
Comme beaucoup d'ambitieux,rencontrés dans les romans du XIXe siècle, Duroy est impatient : il veut « dès le lendemain » en finir avec « cetteexistence besogneuse ».
Cette hâte peut s'interpréter de diverses façons.
Elle renforce certainement son énergie,comme le confirme le début du paragraphe trois : « une ardeur de travail l'ayant soudain ressaisi ».
Mais elle favoriseaussi le découragement.
Le jeune homme rêve d'une réussite immédiate, obtenue sans efforts, parce quepersévérer, attendre encore dans la médiocrité matérielle reste inconcevable.Or, écrire ses impressions d'Afrique exige de la concentration, de l'application et une maîtrise de l'écriture que Duroyn'a jamais cherché à acquérir, ou que peut-être il ne possédera jamais.
Les obstacles ne tardent donc pas, soit parmanque de talent, soit en raison de l'inexpérience.
Il n'est pas interdit de penser que son imagination manqued'originalité et qu'il n'a pas grand-chose à dire sur l'Algérie.
Duroy n'a pas effectué de reportage sur ce paysfraîchement colonisé par la France, et la vie militaire a-t-elle pu lui permettre la découverte d'un peuple qu'il s'agitavant tout de soumettre ? Probablement pas.
C'est pourquoi il s'appuie sur des clichés sans intérêt, mais quipeuvent satisfaire le grand public et le conforter dans ses préjugés.
Dépourvu de connaissances, d'idées quelquepeu originales, d'aisance dans l'écriture, Duroy n'a sûrement qu'un esprit médiocre, en discordance avec sonambition.
Il est par ailleurs prompt au découragement et au désarroi.
On ne sait exactement combien de temps dure sapremière recherche, mais elle paraît assez brève.
Les premiers signes de l'angoisse apparaissent vite : « il se leva denouveau, les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes.
» La première ardeur s'est muée en unsentiment d'impuissance.
Le narrateur va jusqu'à évoquer « un désespoir éperdu ».
L'ambitieux manque de sang-froid, se révèle facilement impressionnable et anxieux : une facture à régler, qu'il avait peut-être un momentoubliée, suffit à causer ce désespoir.
Ces propos au discours indirect libre le montrent : « C'était fini, tout était fini,il ne ferait rien, il ne serait rien », se dit-il.
Il se peut aussi qu'il ne soit guère accoutumé à l'effort prolongé etorganisé, ayant jusqu'ici exercé une activité répétitive, n'exigeant guère d'initiative.
Il n'empêche que l'hommemanque d'envergure.
Il y a même quelque naïveté à penser qu'un premier article, écrit en un clin d'oeil, le propulseraimmédiatement vers le succès et vers une vie aisée.Le personnage révèle ses faiblesses : une intelligence limitée et une volonté fragile, cédant vite la place àl'angoisse.
On se doute qu'il ne peut réussir avec ses seules ressources.
Qui l'emportera en lui, de son désir des'arracher à une condition sociale médiocre ou de son découragement ? C'est un caractère contrasté, suscitant surson avenir les interrogations du lecteur, le tenant en haleine.
La lecture de ce seul extrait ne permet pas depercevoir ses atouts.
Le portrait prend parfaitement place dans un début de roman qui doit ouvrir toutes les pistespossibles pour le héros.La production romanesque offre des figures célèbres d'ambitieux : c'est Rastignac apparaissant pour la première foisdans Le Père Goriot, qui ne manque ni d'énergie ni d'intelligence, c'est Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir,cristallisant la passion fougueuse et le sang-froid, c'est encore Aristide Saccard dans La Curée, calculateur sansscrupules.
Le héros de Maupassant manifeste une ambition embarrassée dans la médiocrité, incertaine, ambiguë.
Ilsemble obéir à une logique simple : il ne supporte plus la misère, donc se met à travailler avec ardeur, maisrencontre les premières difficultés de l'écriture et se laisse alors gagner par le découragement et l'angoisse.
Il est enfait un personnage complexe, énergique mais peut-être velléitaire.
Il faut se rendre à l'évidence : l'ambition n'estpas l'apanage des héros..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bel-ami de Maupassant - chapitre III: les conditions de vie de Duroy (commentaire)
- Partie de Commentaire littéraire Bel-Ami de Maupassant sur l'extrait du Chapitre VII (crise d'angoisse et insomnie)
- Bel Ami, Maupassant, Deuxième partie, chapitre 2. : De « -Tu ne sais pas, nous allons travailler, ce soir (...) » à « (…) elle se mit à lui souffler ses phrases tout bas, dans l'oreille. »
- Bel-Ami Maupassant Deuxième partie, chapitre 1
- BEL AMI, Guy de MAUPASSANT Retour au pays natal Deuxième partie, chapitre 1 Depuis « C'étaient deux paysans… » à « … elle qui ne rêvait pas d'ordinaire ? »